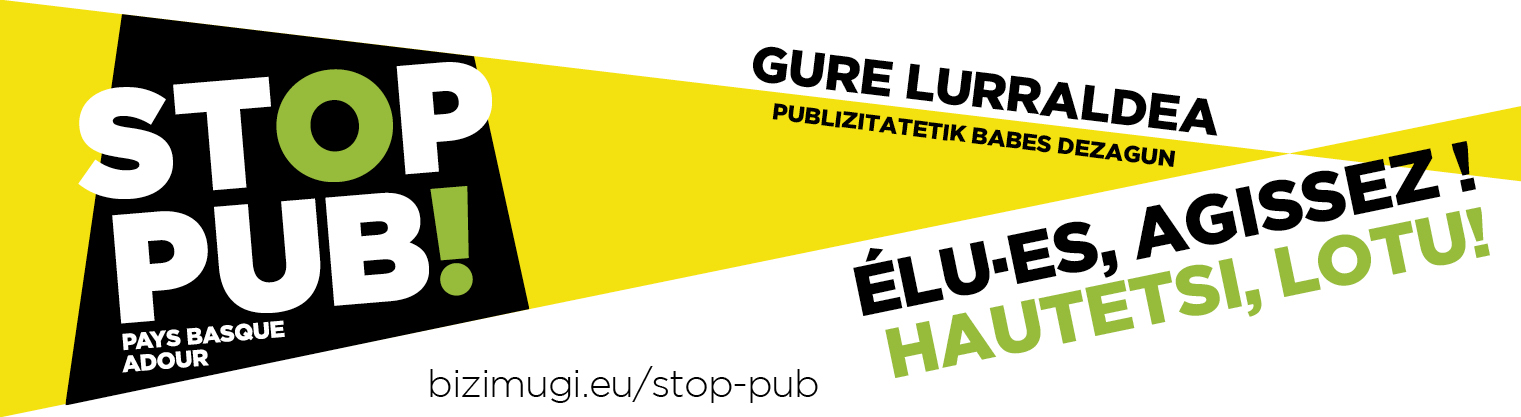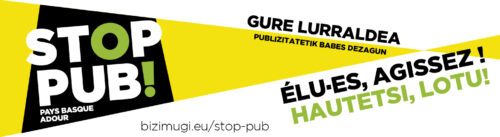Anthony Lubrano: «Berotegi efektuko gasen isurpenen %50 ere izan daitezke herrietakoak»
Leire Casamajou Elkegarai
www.berria.eus/euskal-herria/berotegi-efektuko-gasen-isurpenen-50-ere-izan-daitezke-herrietakoak_2141204_102.html
Article
Ipar Euskal Herriko herriek 2020an izenpetu zituzten ekologia itunak nola bete dituzten ikertzen ari da Bizi. Zenbait herrik ez diete daturik helarazi nahi izan, eta CADAra jo dute horien eskuratzeko.
2020ko herrietako bozen karietara, Ipar Euskal Herriko 46 herrik izenpetu zuten Bizi mugimendu ekologistak pentsatutako «eraldaketa ekologikorako itun integrala»; herri horien bilakaera aztertu dute Bizikoek, baita ituna izenpetu nahi izan ez zuten beste hamar herrirena ere. Heldu den urtean herriko bozak izanen dira berriz, eta 2020-2026ko agintaldiko puntuaren egiteko garaia iritsi da: Biziko Anthony Lubranok BERRIAri kontatu dio zer-nolako arrapostu eta eraldaketez ohartu diren azken bost urtean.
Klima aldaketa erronka handia da… Uste duzue herriek erantzuten ahal diotela?
Maila guztiak dira inportanteak, baina maila lokala eskuragarrienetakoa da. Gainera, zuzenean, berotegi efektuko gasen %15 isurtzen dira herrietan; zeharka, %50 ere izan daitezke, hirigintza antolaketarako erabakiak kontuan hartzen baldin baditugu.
Berri ona da aterabideak ere tokian-tokian landu daitezkeela. Politika publikoek behar bezala jokatu behar dute; norabidea aldatu behar da.
Beraz, hiri horietan, nola gauzatu behar da trantsizio ekologikoa?
Guk gehiago ez diogu trantsizioa deitzen. Izan ere, zientzialariek erraten dute hamarkada honetan dela dena egitekoa, eta erdia jadanik pasatu da. Zenbat eta gehiago itxaron, orduan eta gehiago dago egiteko, eta orduan gehiegi kostatzen da… Eraldaketa ekologikorako itun integrala da gure proposamena.
Itun horrekin funtzionatzen duzue, beraz.
Herriko bozen garaian proposatzen dizkiegu itunak. Badu bi agintaldi horretan ari garela, baina guk, gero, bilakaera aztertzen dugu. Azken agintaldi honi dagokionez, 2021ean egin genuen lehen txostena, 2023an agintaldi erdikoa, eta, orain, agintaldi bukaerakoa lantzen ari gara. Balioko digu gauzak nola aurreratu diren ikusteko eta, oro har, aztertzeko zertan garen lurralde mailan eta gaiaren urgentziari dagokionez.
2020-2026ko agintaldiaren bilan globalaren emaitzak irailaren 23an publikatuko ditugu, Baionan antolatuko dugun bilkura publiko batean.
«Guk gehiago ez diogu ‘trantsizioa‘ deitzen. Zientzialariek erraten dute hamarkada honetan dela dena egitekoa, eta erdia jadanik pasatu da… Eraldaketa ekologikorako itun integrala da gure proposamena»
Tokiko elkartea zarete, eta herri anitz dira, txosten anitz…
46 herrik izenpetu dute eraldaketa ekologikorako ituna. Badira ere beste hamar herri 2.000 biztanletik gora dituztenak eta izenpetu nahi izan ez dutenak: Angelu, erraterako (Lapurdi). Halere, lurralde mailan eragina baitute, horien bilakaera aztertzen egiten dugu. Azkenean, Ipar Euskal Herriko biztanleriaren %86 edo %87 da.
Tokiko elkarte bat gara, ez gara ikerketa bulego bat. Horregatik, herritarrak gurekin parte hartzera animatzen ditugu: herrietan eramaten diren proiektu positiboen berri ematen ahal digute, eredugarriak direlarik influentzia oneko izan daitezkeelako, edo, bestela, bide okerretik doazen proiektuak salatzen ahal dituzte. Herrietako kontseiluak ezagutzeko garaian ere gurekin dira, hautetsiekin harremana lantzen laguntzeko eta gure desmartxak esplikatzen ditugularik ekiten hasteko urratsa egiten laguntzeko.
Ekintzarako urrats hori zer irizpideren arabera egin behar dute herriko etxeek?
Izenpetzen duten itunak zazpi lan ardatz hartzen ditu barne: autoaz besteko garraioak, eraikinen energiaren kudeaketa, %100 energia berriztagarrietan oinarritutako lurraldea, laborantza eta elikadura biologiko eta tokikoa, tokiko ekonomiaren bultzatzea euskoa garatuz, hondarkinen gutxitzea, ekonomia zirkularra, eta osoki betetzea Ipar Euskal Herriko klima, aire eta energia plana.
Gai horien lantzeko formakuntza saioak antolatu izan ditugu, hautetsiendako eta herriko langileendako pentsatuak.
Orain, agintaldi bukaerako txostenerako, jarraipen fitxak bidali dizkiegu herriko etxeei, lan ardatz bakoitzeko. Galdegiten diegu nolakoa zen agintaldi aitzineko egoera, herriko etxeak zer lortu duen agintaldi denboran, eta zer aurreikusi duen egitea ondoko agintaldian. Zenbakiak ere galdegiten dizkiegu, eginen dugun bilana ahal bezain objektiboa izan dadin.
Baina zenbait herriko etxek ez dizkizuete dokumentuak eman nahi izan.
Horregatik, CADAra jo dugu [administrazio agirien sarbidea kudeatzen dute], eskas genituen dokumentuak eskuratzeko. Ororen buru, 44 herrik helarazi dizkigute informazioak, guk aztertzen ditugun 56ak alde batera utzirik; horietarik 39k ituna izenpetu zuten 2020an. Eta beste bost herri ere badira itunaren izenpetzaile ez direnak baina azkenean informazioak helarazi dizkigutenak. Bestalde, hamabi herrik ez dute daturik eman.
Mapa interaktibo eguneratu batek zuzen-zuzenean erakusten du nork erantzun duen, eta herritarrei aukera ematen die beren herriaren erantzuna egiaztatzeko eta hiru klik eginez erraz interpelatzeko. Legearen arabera, eskatutako datuak interes orokorrekoek dira, baina ez dira kasik inoiz argitaratzen. Herriak gardenak izatea nahi dugu, herritarrei informazioa ematea.
«46 herrik izenpetu dute eraldaketa ekologikoaren ituna. Badira ere beste hamar herri 2.000 biztanletik gora dituztenak eta izenpetu nahi izan ez dutenak. Azkenean, Ipar Euskal Herriko biztanleriaren %86 edo %87 da»
Zer motatako informazioak lortu nahi dituzue?
Adibidez: bizikletaz ibiltzeko bideen luzera, eraikin publikoen energia kontsumoa, argiztapen publikoarena, energia fosilen kontsumoaren bilakaera, energia berriztagarrien ekoizpenaren eta kontsumoaren bilakaera…
Kantinei dagokienez, zenbatekoa den erabiltzen dituzten tokiko mozkinen eta mozkin biologikoen heina, zenbat menu begetariano eskaintzen dituzten… Euskoari dagokionez, zenbat dendak onartzen duten tokiko dirua erabiltzea…
Horiek guztiak zenbakiak dira, eta, nahiz biziki mugatzaileak izaten ahal diren, biziki lagungarriak ere badira: zeren konkretua galdegiten diegularik, biziki diskurtso ederrak dituzte, eta biziki motibatuak dira denak… Baina errealitatea, usu, arrunt bestelakoa da.
Zenbakiez at, beraz, konkretuki, zer proiekturi begiratu behar zaio ingurumenean duten eragina aztertzeko —positiboa edo negatiboa—?
Eremu publikoak berriz antolatu ote dituzten partekatzea hobeki egina izan dadin, adibidez: jende gehienek autoa erabiltzen dute, bideen %80 autoei egokituak baitzaizkie. Eta badakigu ez dela jasangarria, ez ekologikoki, ez ekonomikoki edo osasunari dagokionez.
Kantinei dagokienez, ohartzen gara usu bazter utzitako ardura dela. Alta, balegoke anbiziozko hazkurri politikarik bultzatzeko… Proiektu pedagogikoak pentsatuz gero, zentzua ematen zaie elikagaiei, eta haurrei irakasten zaie jatekoari desberdinki begiratzen.
Ana Toni, directrice de la COP30 : « Plutôt que de consacrer notre énergie à Trump, on travaille avec les 197 pays qui restent dans l’accord de Paris »
Audrey Garric et Matthieu Goar
www.lemonde.fr/planete/article/2025/05/16/ana-toni-directrice-de-la-cop30-plutot-que-de-consacrer-notre-energie-a-trump-on-travaille-avec-les-197-pays-qui-restent-dans-l-accord-de-paris_6606398_3244.html
Article
La diplomate brésilienne revient, dans un entretien au « Monde », sur les enjeux de la réunion organisée à Belem en novembre, contrariée par la politique de désengagement climatique du président des Etats-Unis.
A six mois de la prochaine conférence mondiale sur le climat, la COP30, le Brésil se fait le porte-voix de la diplomatie climatique. Ana Toni, directrice exécutive de la conférence et secrétaire chargée du changement climatique au ministère de l’environnement, défend la force du multilatéralisme malgré les tensions géopolitiques et commerciales. Elle souligne les bénéfices de l’accord de Paris sur le climat, qui aura 10 ans en décembre.
Quelles sont les conséquences de l’élection de Donald Trump sur les négociations climatiques ?
La décision de l’administration Trump de quitter l’accord de Paris [signé en 2015] – de même que ses actions nationales en la matière – est évidemment une très mauvaise nouvelle. Les Etats-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre [après la Chine], et le premier d’un point de vue historique. Au cours de son premier mandat, M. Trump avait déjà quitté l’accord de Paris, mais la communauté internationale s’est montrée résiliente. Par ailleurs, les acteurs sous-étatiques américains, des gouverneurs ou entreprises, continuent à combattre le réchauffement climatique. Enfin, 197 pays sont encore dans l’accord de Paris. On travaille avec ceux qui sont restés plutôt que de consacrer notre temps et notre énergie à ce que va faire M. Trump.
La diplomatie climatique est-elle encore en vie, à un moment où les conflits, les guerres commerciales et l’austérité budgétaire font passer le climat au second plan ?
Absolument, et elle a un impact très positif. Souvenons-nous que quand l’accord de Paris a été signé, nous nous dirigions vers un réchauffement mondial de 4,5 °C à la fin du siècle. Dix ans plus tard, ce qui est une période très courte, nous sommes sur une trajectoire de + 2,5 ou 2,7 °C. Ce n’est pas suffisant, et il faut limiter le réchauffement à 1,5 °C, mais cela montre que la diplomatie climatique fonctionne.
Quelles sont vos priorités pour la COP30 ?
La première est de montrer que le multilatéralisme climatique est non seulement vivant, mais qu’il est fort et peut le devenir encore davantage. La seconde est de mettre l’accent sur la mise en œuvre [des accords]. Les solutions contre la déforestation, pour les énergies renouvelables, les transports existent déjà à différents niveaux, nationaux, entrepreneuriaux. On doit les déployer à plus grande échelle. Il faut aussi trouver comment mobiliser 1 300 milliards de dollars [1 159 milliards d’euros] par an de financement climatique à destination des pays du Sud. Cela ne viendra pas seulement de l’argent public, mais aussi du privé, des banques multilatérales de développement. Nous allons mettre autour de la table les ministres du climat et des affaires étrangères avec ceux de la finance et les banques centrales.
Quelles actions prévoyez-vous pour sauver l’accord de Paris ?
Belem n’est pas la dernière chance pour l’accord de Paris. Cette COP lance une nouvelle décennie. La première était celle de la négociation des textes et des règles. La COP29 de Bakou [en 2024] était la dernière étape, et a clos les deux derniers sujets en suspens, sur le nouvel objectif mondial de financement climatique et les marchés carbone. Cette nouvelle décennie doit accélérer la mise en œuvre des textes. Il faut réussir à mener de concert la croissance économique et la lutte contre le changement climatique. Il faut coopérer, apprendre les uns des autres.
Comment réagissez-vous au fait que l’Union européenne (UE) n’ait pas encore envoyé sa contribution déterminée au niveau national, c’est-à-dire son plan d’action climatique jusqu’en 2035 ?
L’Europe a toujours été un leader dans les négociations climatiques, c’est d’autant plus vrai dans cette période d’incertitudes géopolitiques.
Nous savons qu’il y a eu des élections [européennes] en 2024 et que les commissaires ont changé, mais nous espérons que leur contribution déterminée au niveau national pour 2035 sera envoyée le plus tôt possible. Vu le contexte, l’UE doit, dans le même temps, maintenir ses ambitions de 90 % de réduction en 2040. C’est un gage de stabilité pour la diplomatie climatique. L’objectif européen d’arriver à la neutralité carbone en 2050 est un signal important pour tous les autres pays.
Après la COP28 à Dubaï, en 2023, la COP de Belem doit-elle être le lieu pour accélérer la sortie des énergies fossiles ?
Nous avons eu un accord à la COP28 où nous nous sommes mis d’accord pour une transition hors des énergies fossiles, qui doit se faire d’une manière « juste, ordonnée et équitable », selon les termes de l’accord, pour tripler la production d’énergies renouvelables, pour arrêter la déforestation. C’était un accord puissant, notre étoile polaire, car 198 pays l’ont approuvé. Pas besoin de répéter ce que nous avons convenu, nous devons aller de l’avant. Nous devons aussi continuer à discuter sur les termes « ordonnée » et « équitable ». Les pays développés doivent-ils réaliser les efforts en premier ? Quels sont les secteurs qui doivent s’engager plus vite car ils sont plus préparés à l’électrification ? Comment impliquer aussi les pays consommateurs de pétrole ?
Votre pays prévoit d’augmenter sa production de pétrole et de gaz de 36 % jusqu’en 2035, et il soutient l’extraction de pétrole dans le delta de l’Amazone. Comment expliquer ce paradoxe ?
Pendant cette transition, beaucoup de pays doivent vivre avec leur propre paradoxe, pas seulement le Brésil. Nous sommes ambitieux : nous sommes le premier pays en développement à avoir une cible de baisse de 67 % [59 %-67 % dans la contribution déterminée au niveau national brésilienne] de ses émissions de gaz à effet de serre. C’est beaucoup plus que le Canada. Notre plus grosse part dans les émissions est la déforestation, et elle est en baisse depuis le retour du président Lula au pouvoir [en 2022] ; 90 % de notre secteur électrique proviennent des énergies renouvelables. C’est beaucoup mieux que la France.
La Norvège a de faibles émissions, mais exporte beaucoup de pétrole et de gaz. Chaque pays doit réfléchir à sa propre trajectoire de décarbonation. C’est un débat que nous avons au sein du gouvernement et de la société brésilienne, où il peut y avoir des résistances. Nous ne voulons pas laisser de côté une partie du peuple.
Le nucléaire va ruiner la France
Reporterre
https://reporterre.net/La-relance-du-nucleaire-va-ruiner-la-France
Article
Malgré le coût faramineux du tout-nucléaire, la France s’enferre dans cette impasse. Voici les bonnes feuilles du livre-enquête « Le nucléaire va ruiner la France ». Laure Noualhat y décortique les mécanismes d’une gabegie.
La relance nucléaire est-elle raisonnable ? À en croire Emmanuel Macron et tant d’autres, le « graal » nucléaire serait la seule solution pour ralentir le changement climatique et préserver notre confort. Alors que l’État fait des économies à tout-va, le secteur semble bénéficier d’un budget illimité.
On a appris lundi que le centre d’enfouissement de déchets nucléaires Cigéo à Bure, coûtera jusqu’à 37,5 milliards d’euros. Pour la relance de la filière, la facture grimpera au minimum à 80 milliards d’euros. À mesure que les retards s’accumulent, ces montants sont sans cesse revus à la hausse. Le tout alors qu’EDF est déjà lourdement endettée.
Où trouver les dizaines de milliards d’euros pour ces nouveaux EPR ? Et les investissements nécessaires au parc existant ? C’est l’État, c’est-à-dire le contribuable, qui paiera.
Voilà ce que démontre la journaliste Laure Noualhat dans un livre-enquête implacable Le nucléaire va ruiner la France. Fruit de six mois d’enquête, il paraît ce jour dans la collection Seuil-Reporterre et sera accompagné d’un documentaire diffusé sur YouTube début juin. À travers ce travail d’ampleur, Reporterre s’attaque à un sujet crucial pour l’avenir du pays, largement absent du débat public. Parce que ces choix sont opérés dans l’opacité la plus totale, Reporterre fait la lumière sur un sujet qui nous concerne tous.
Voici les bonnes feuilles de « Le nucléaire va ruiner la France » en avant-première :
Que faisiez-vous le 10 février 2022 ? Pour le petit monde de l’énergie, ce fut une journée mémorable. Ce jour-là, le président-candidat Emmanuel Macron se tient debout derrière un pupitre sous l’immense toit en tôle de l’usine General Electric de Belfort. Sa voix résonne comme dans une cathédrale. Derrière lui, les équipes de GE ont disposé une gigantesque turbine Arabelle, 300 tonnes d’acier rutilant éclairées comme s’il s’agissait d’une pièce de musée industriel.
Un parterre de salariés masqués, tous vêtus de la même veste de chantier bleu électrique, écoute doctement le président. Quatre années auparavant, ces femmes et ces hommes faisaient partie de la division énergie d’Alstom, fleuron industriel que l’ancien ministre de l’Économie Emmanuel Macron avait consciencieusement désossé lors de son passage à Bercy.
Qu’importe, en ce jeudi 10 février, le désormais Président vient annoncer la « renaissance » du nucléaire français, vanter la « souveraineté » nationale et louer les mérites de la « planification » pour faire face aux enjeux du moment : baisser de 55 % nos émissions de CO2 d’ici à 2050, assurer le développement industriel de la France, et maîtriser la facture d’énergie des Français.
Aucune loi n’encadre la volonté présidentielle
Quel que soit le milieu — écologiste, énergétique, nucléaire, militant, industriel, politique —, ce discours a fait mouche et date. En le prononçant, le président-candidat Macron vient de sortir la France de décennies de flottement en relançant la construction en série de réacteurs nucléaires. Depuis sa validation en 2003 par l’Assemblée nationale, le chantier de l’EPR de Flamanville s’enlise dans d’interminables déboires. En 2012, le président Hollande avait choisi une voie contraire en inscrivant dans la loi le fait d’abaisser la part du nucléaire à 50 % dans le mix électrique à l’horizon 2025 (contre 65-70 %) et à 30 % en 2030. Bref, le socialiste programmait une lente sortie du nucléaire, permettant à la fois de préparer les démantèlements des plus vieux réacteurs, la montée en puissance des renouvelables et d’opérer un effort inouï du côté de la sobriété.
En février 2017, le candidat Macron – ancien ministre de Hollande – reprend cette promesse à son compte. « Je garderai le cadre de la loi de transition énergétique. Je maintiens donc le cap des 50 % », confiait-il au WWF lors d’un Facebook live suivi par 170 000 personnes et interrogé par… Pascal Canfin, qui rejoindra la liste du Président pour les élections européennes de 2019.
Cinq ans plus tard, face aux salariés de General Electric, le président jupitérien opère une volte-face.
Six EPR2 vont sortir de terre, promet-il, construits par paires sur trois sites : à Penly en Normandie, à Gravelines dans le Nord, et au Bugey dans l’Ain. Et huit de plus seront à l’étude. Ni la population française, ni aucun parlementaire ou sénateur n’a eu son mot à dire, comme si le nucléaire se tenait hors-sol démocratiquement. Depuis cette annonce, le programme des six EPR2 n’est toujours validé par aucune décision légale et encore moins par une « loi de programmation sur l’énergie et le climat » (PPE) qui aurait dû être révisée pour l’occasion.
À ce jour, en 2025, aucune loi n’encadre la volonté présidentielle façonnée par de longues années de lobbying (de la part d’associations comme le Cérémé de Xavier Moreno ou Patrimoine nucléaire & climat de Bernard Accoyer mais aussi les Voies du nucléaire ou la Société française de l’énergie nucléaire) depuis son arrivée au pouvoir.
Un coût colossal
Abattre des cloisons ou cacher la misère, isoler ici ou repeindre là, déplacer la tuyauterie, changer la porte… difficile de demander à un artisan un devis pour des travaux si vous ne savez pas ce que vous allez faire. Avec les réacteurs nucléaires, c’est pareil.
À l’heure où sont écrites ces lignes, en mars 2025, soit trois ans après le discours de Belfort, personne ne sait combien vont coûter les EPR2. C’est normal : leur conception détaillée n’est pas achevée en dépit des 10,5 millions d’heures d’ingénierie déjà consacrées au projet.
En février 2022, le gouvernement avait avancé un coût de construction de 51,7 milliards (euros de 2020). En 2023, EDF a opéré deux mises à jour du chiffrage, relevées par la Cour des comptes dans son rapport consacré à la filière EPR en janvier 2025 : « Le coût de construction overnight [comme si le réacteur était réalisé en une seule nuit] de trois paires d’EPR2 est passé de 51,7 à 67,4 milliards d’euros [euros de 2020], soit une augmentation de 30 % à conditions économiques inchangées et hors effet de l’inflation. » En euros de 2023, la facture atteint 80 milliards. À titre de comparaison, ce chiffre de 80 milliards représente déjà quatre fois le déficit annuel de la Sécurité sociale…
Planification écologique : une bonne idée toujours pas mise en œuvre
Jade Lindgaard
www.mediapart.fr
Planification écologique : une bonne idée toujours pas mise en œuvre
Jade Lindgaard
www.mediapart.fr/journal/ecologie/140525/planification-ecologique-une-bonne-idee-toujours-pas-mise-en-oeuvre
Article
Un rapport confidentiel de la Cour des comptes que Mediapart a obtenu critique les incohérences et insuffisances de la politique gouvernementale de transition écologique.
Un objectif indispensable mais des moyens insuffisants et contradictoires pour y parvenir : les conclusions du premier rapport de la Cour des comptes consacré à l’ensemble des politiques de transition écologique sont sévères pour l’exécutif.
Mediapart a eu accès à la version quasi définitive de ce document, en cours de contradictoire avec les administrations concernées. Contactée, la Cour des comptes ne communique pas sur le calendrier de sa publication, encore à ce jour confidentiel.
L’empilement des dispositifs pour réduire les émissions de CO2 ne suffit pas à créer une politique cohérente, et les trajectoires de financement ne sont pas suffisamment claires à long terme, expliquent les auteurs, qui estiment que « les politiques publiques de transition souffrent encore d’un manque de lisibilité, de cohérence et de pilotage opérationnel ».
Symbole de ces injonctions contradictoires : le secrétariat général à la planification écologique (SGPE), créé en 2022 et rattaché au cabinet d’Élisabeth Borne quand elle était première ministre. Le sort de cette instance se joue ces jours-ci autour du profil de sa nouvelle directrice ou directeur.
Stratégie sur le court terme
Si ses travaux ont été utiles, en démontrant l’écart entre les besoins d’action et les moyens disponibles, ils n’ont pas vraiment été suivis d’effets. Le SGPE « n’a pas encore trouvé complètement sa place dans l’écosystème des instances et des démarches préexistantes ». Sans pouvoir d’arbitrage, il joue un rôle d’analyse des politiques engagées et d’aide à la décision et non d’organisation concrète de la planification. Si les mots ont un sens, il conviendrait donc que « la mission de préparation des arbitrages par le SGPE [soit] renforcée », car en l’état sa capacité « à assurer une mise en cohérence de l’action publique n’est pas garantie ».
Le coût pour les ménages n’est pas assez étudié. Ils sont pourtant les premiers financeurs de la réduction des gaz à effet de serre.
Plus généralement, les nombreuses politiques de lutte contre le dérèglement climatique, les pollutions ou la protection des écosystèmes sont trop organisées « en silos ». Résultat : il existe une « dissymétrie » entre les politiques d’atténuation et les autres (eau, pollution, biodiversité, adaptation, biomasse…). C’est contraire à ce que demande une approche écosystémique, et cela ne permet pas non plus d’agir assez pour le climat puisque la réduction des émissions de CO2 s’est ralentie en France en 2024 – avec une baisse de seulement 1,8 %.
La Cour des comptes pointe l’urgence de fixer des objectifs chiffrés de réduction de l’empreinte carbone, c’est-à-dire prenant en compte les émissions émises à l’extérieur par les biens et services consommés sur le territoire national. C’est ce qu’avait prévu la loi « énergie et climat ». Mais le projet actuel de la « stratégie nationale bas-carbone » (SNBC) se limite à annoncer qu’un chiffre sera donné, sans formuler de proposition précise.
Des ministères clés exclus
Autre problème majeur : les financements ne sont pas assez établis sur le long terme. Et cela crée des incertitudes qui nuisent à l’efficacité des politiques. La stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique et de la politique énergétique nationale (SPAFTE), qui a été présentée en octobre 2024 par le gouvernement pour réunir sous un même intitulé les fonds concernant le climat, l’adaptation, la gestion de l’eau, les déchets, les risques technologiques et les pollutions, concentre plusieurs problèmes.
D’abord, elle traite séparément la baisse du CO2, la protection de l’eau et de la biodiversité, et elle n’intègre pas l’adaptation au dérèglement climatique, alors que tous ces enjeux sont liés – comme le démontrent cruellement les inondations dans les Hauts-de-France à la fin de l’année 2023 et au début de l’année 2024, notamment.
Ensuite, elle se concentre sur le court terme, puisqu’elle annonce des financements d’ici à 2027, alors que tous les objectifs de décarbonation et de biodiversité sont calés sur 2050 et après. Enfin, et c’est le plus croustillant, elle a été préparée et décidée en « excluant des ministères clés » : l’écologie, l’agriculture et la recherche. Elle n’est pas non plus incluse dans le périmètre du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, un document qui fait l’objet d’un suivi parlementaire chaque année.
Tout cela est fort peu démocratique. Les auteurs du rapport en profitent pour regretter que le gouvernement ait renoncé à déposer un projet de loi de transition écologique, qui « serait de nature à mieux répondre aux enjeux et modalités de long terme ».
Or cela représente au total beaucoup d’argent. Les nombreuses politiques censées lutter contre le dérèglement climatique, les pollutions ou la protection des écosystèmes ont coûté 164 milliards d’euros entre 2022 et 2024, soit 6 % du PIB français.
Cependant, certaines aides publiques consacrées à ces politiques demeurent « dommageables » pour les écosystèmes – et elles atteignent 11,8 milliards d’euros en 2024. C’est beaucoup – même si ce montant reste inférieur aux dépenses dites favorables à l’écologie, autour de 40 milliards d’euros.
Par ailleurs : le coût pour les ménages n’est pas assez étudié, selon les rapporteurs. Ils sont pourtant les premiers financeurs de la réduction des gaz à effet de serre – ce que l’administration appelle l’atténuation du changement climatique. La décarbonation des bâtiments (remplacements d’une chaudière fioul ou gaz par une pompe à chaleur, travaux d’isolation…) et des transports routiers (remplacement d’une voiture Diesel ou essence par un véhicule électrique par exemple) leur coûte cher : 30 milliards d’euros de surcoût chaque année jusqu’en 2030.
« Les ménages modestes, manquant de patrimoine ou de trésorerie, ont des difficultés à financer le reste à charge » des investissements requis par la transition écologique. Si l’on veut que la transition écologique soit « juste », il faudrait donc prendre en compte cet objectif dès la conception des mécanismes de soutien à la transition. Ce qui n’est aujourd’hui pas assez le cas.
Géopolitique municipale
David Lannes
www.enbata.info/articles/geopolitique-municipale
Article
L’Edito du mensuel Enbata – Le dilemme du prisonnier illustre l’absurdité des stratégies non coopératives. Deux cambrioleurs sont arrêtés et on leur propose un marché. Si l’un des deux avoue et que l’autre nie sa participation, ce dernier est libéré, et le premier écope de dix ans de prison. Si les deux avouent, ils sont condamnés à un an chacun, et à cinq ans s’ils nient tous les deux. Chaque prisonnier se dira : si l’autre nie, il faut que je fasse de même sinon je prendrai dix ans au lieu de cinq ; et s’il avoue, je vais nier pour être libéré au lieu de faire un an de prison. Les deux sont donc condamnés à cinq ans, alors que leur peine n’aurait été que d’un an s’ils avaient coopéré.
Alors que nous nous heurtons de plein fouet à la finitude de notre planète et aux conséquences des crises climatique et de biodiversité, les logiques prédatrices se développent au détriment des stratégies de coopération. Comme les deux prisonniers évoqués plus haut, les États adoptent une stratégie, optimale de leur point de vue, qui consiste en l’occurrence à ne pas vouloir souffrir d’un déficit stratégique en étant le premier à s’affranchir des fossiles.
En plus de cette énième instance du dilemme du prisonnier, un autre dilemme s’impose à nous. La crise énergétique fait en effet vaciller la « paix de carbone » qui s’est construite après la seconde guerre mondiale en dopant les forces industrielles et commerciales grâce au développement massif des infrastructures pétrolières et gazières. Comme l’explique Pierre Charbonnier dans « Vers l’écologie de guerre », la paix et la sécurité se sont construites sur l’abondance. Or, les énergies fossiles qui rendent possible cette abondance sont précisément celles qui font peser une menace existentielle inédite sur l’humanité.
On choisit souvent de combattre l’un de ces deux maux en négligeant l’autre. Ainsi, à droite, on propose de sabrer dans les dépenses sociales et de transition écologique pour financer les milliards nécessaires au plan de réarmement de la France. Inversement, le Green New Deal européen ou les ZFE ne prennent pas toujours la mesure des implications sociales d’une modification des soubassements de la « paix de carbone ».
Les objectifs de sécurité et de transition écologique ne sont pourtant pas forcément antagonistes. La dépendance énergétique de l’Union européenne aux énergies fossiles en provenance de Russie ou des États-Unis fragilise son aptitude à leur résister. En éliminant cette dépendance, la transition écologique substitue à la « paix de carbone » un nouveau paradigme de paix soutenable et permet aussi de limiter l’effort d’armement : selon une étude de l’Institut Kiel, chaque euro en moins dépensé pour les fossiles prive la Russie de financements pour son armée, ce qui permet de baisser de 37 centimes les budgets de défense de l’Europe.
S’il est difficile d’avancer dans ce processus de substitution de manière socialement acceptable, c’est en partie parce que les ramifications de la « paix de carbone » sont si complexes qu’elles en deviennent illisibles depuis Bruxelles ou Paris. Les municipalités, en revanche, en ont une connaissance fine et pratique.
C’est donc à cette échelle que l’on peut le mieux comprendre quelles infrastructures peuvent être remplacées, et comment accompagner efficacement les personnes qui seront impactées par ces changements.
« Nous pouvons agir efficacement à l’échelle communale pour nous affranchir de nos dépendances subies, qu’elles soient énergétiques, alimentaires, culturelles, linguistiques, etc. »
Les rencontres municipalistes organisées par EHBai le 22 mars ont réuni plus d’une centaine de militant.e.s de tout le Pays Basque nord afin de réfléchir aux meilleurs moyens d’activer l’échelle communale pour nous affranchir de nos dépendances subies, qu’elles soient énergétiques, alimentaires, culturelles, linguistiques, etc. Des élu.e.s de tout Euskal Herri, engagé.e.s depuis quelques années déjà dans des démarches innovantes, ont partagé leur expérience. A moins d’un an des élections municipales, ce temps de rencontre a confirmé que la résistance à la déferlante réactionnaire actuelle pouvait s’organiser efficacement à l’échelle communale.