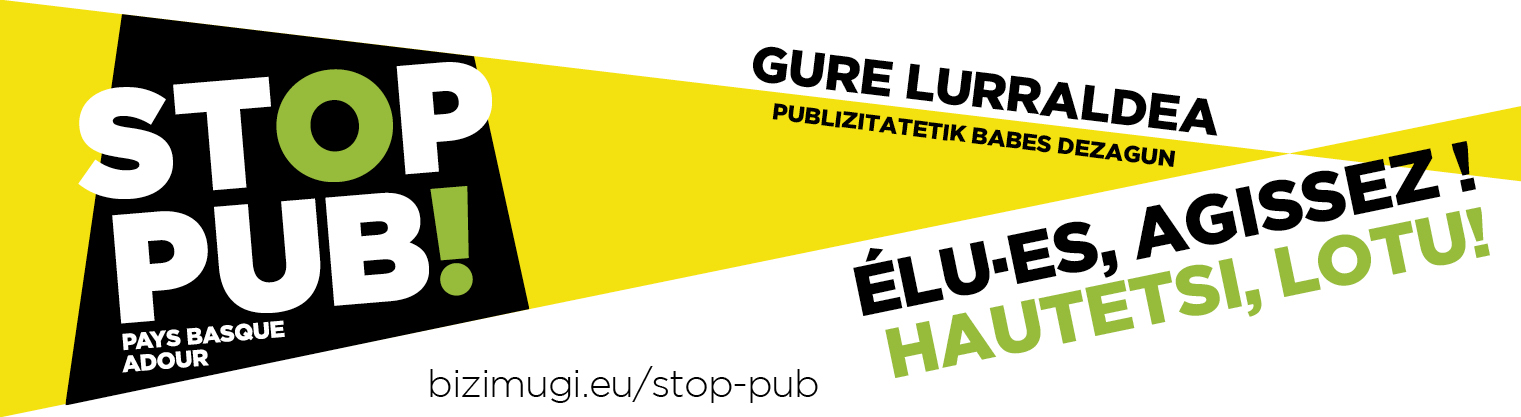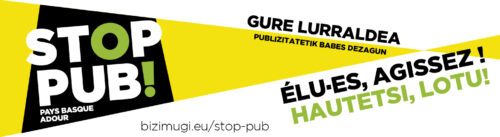« Justice climatique » de Sébastien Mabile : combattre les inégalités liées au réchauffement de la planète
Stéphane Foucart
www.lemonde.fr/idees/article/2025/01/30/justice-climatique-de-sebastien-mabile-combattre-les-inegalites-liees-au-rechauffement-de-la-planete_6523432_3232.html
Article
Dans son essai, l’avocat spécialiste du droit de l’environnement démêle l’intrication des injustices causées par la destruction du climat et plaide pour une répartion équitable de la quantite finie de gaz à effet de serre entre les pays du Nord et du Sud.
Livre. De quelle injustice – ou plutôt de quelles injustices – le changement climatique est-il le nom ? L’avocat Sébastien Mabile, spécialiste de droit de l’environnement, explore la question sous toutes ses facettes, en partant d’un constat fondamental de la science climatique : si l’on veut respecter les termes de l’accord de Paris et limiter l’élévation de la température terrestre au mieux à 1,5 °C (et en tout cas en deçà de 2 °C) de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle, la quantité de gaz à effet de serre qu’il est possible d’émettre est limitée.
Le propos de Justice climatique. Pour une nouvelle lutte des classes (Actes Sud, 176 pages, 14,90 euros) est de tirer tous les enseignements de ce constat qui, pour peu qu’on le prenne au sérieux, redéfinit profondément les rapports de classe et la notion même de justice sociale. A l’aune du réchauffement, le partage de la richesse ne devient plus le seul enjeu de la « lutte des classes », expose Sébastien Mabile. Il s’agit aussi, et surtout, de répartir de manière équitable la quantité finie de gaz à effet de serre qu’il demeure possible d’émettre sans remettre en cause l’habitabilité de la Terre.
Vif et percutant, bouillonnant de colère et d’indignation, l’essai de Sébastien Mabile a tous les traits d’une plaidoirie. Il fourmille de chiffres et d’exemples pour démêler l’intrication des injustices liées à la destruction du climat.
Injustice historique entre les pays du Nord et du Sud, les premiers ayant contribué de manière démesurée à la situation actuelle, avant qu’une classe émergente d’ultra-riches – sans distinction de nationalité – n’adopte, dans une sorte d’escalade, des comportements toujours plus destructeurs.
Injustice géographique, aussi : ici et ailleurs, non seulement les pauvres sont les moins responsables du réchauffement, mais ce sont eux qui en souffrent au premier chef. Injustice générationnelle, enfin, puisque les plus pénalisés sont ceux qui ne sont pas encore nés.
Instauration d’un rapport de force
Réduites à leurs dimensions économiques, les inégalités sociales choquent, mais aussi fascinent. Lorsqu’elles sont libellées en prélèvements sur le budget du carbone de l’humanité, leur caractère spoliateur apparaît de manière bien plus aiguë. Les richesses sont infinies, les émissions autorisées ne le sont pas. Pour compenser une année d’émissions du yacht de Bernard Arnault, le patron de LVMH, il faudrait, par exemple, explique Sébastien Mabile, que 54 000 personnes réparties dans 107 rames renoncent à un trajet Paris-Marseille en avion pour lui préférer le train. Mille illustrations de cet ordre, distillées au fil des pages, permettent de prendre la pleine mesure de ce que Sébastien Mabile nomme le « séparatisme climatique ».
Pour « empêcher les riches », l’avocat plaide pour le recours au droit et à l’instauration d’un rapport de force, sans quoi aucun des changements systémiques nécessaires à la préservation du climat terrestre ne sera possible. « La crise des “gilets jaunes” nous l’aura violemment rappelé et le besoin de justice sociale alors exprimé relève aussi du champ de la justice climatique, écrit-il. Le problème posé par la catastrophe climatique n’est pas technique, ni financier. Il est politique et le partage équitable des efforts doit devenir la clé de toute politique de décarbonation. »
« Justice climatique. Pour une nouvelle lutte des classes », de Sébasten Mabile, Actes Sud, 176 p., 14,90 €.
Face à l’utilisation « inéluctable » de la géo-ingénierie solaire, des scientifiques appellent à une gouvernance mondiale
Audrey Garric
www.lemonde.fr/planete/article/2025/01/26/face-a-l-utilisation-ineluctable-de-la-geo-ingenierie-solaire-des-scientifiques-appellent-a-une-gouvernance-mondiale_6516278_3244.html
Article
Nombre d’experts considèrent désormais inévitables ces technologies très controversées visant à modifier, de manière volontaire, le climat de la Terre en vue d’atténuer le réchauffement climatique, mais dont les conséquences demeurent imprévisibles.
Face à une crise climatique qui s’aggrave, une option présentée comme celle de la « dernière chance » par ses promoteurs gagne du terrain dans le monde scientifique, politique et économique : la géo-ingénierie solaire. Soit l’ensemble des procédés qui visent à modifier de manière volontaire le climat de la Terre en vue d’atténuer le réchauffement climatique.
Ces techniques très controversées, qui vont de l’injection d’aérosols dans la stratosphère à l’installation de miroirs géants dans l’espace, pourraient y renvoyer une partie du rayonnement solaire et donc refroidir le climat de la Terre. Mais elles s’avèrent hautement incertaines et font courir le risque de créer une nouvelle catastrophe climatique ainsi que des conflits géopolitiques.
Pour les uns, la géo-ingénierie solaire permettrait de gagner du temps, une option de dernier recours à ne pas négliger. « La première chose à faire, c’est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais atteindre la neutralité carbone est difficile et, quand on y parviendra, la température globale ne baissera pas. Il faudra peut-être utiliser des solutions plus drastiques et rapides », explique Jean-François Lamarque, scientifique en chef de SilverLining, une association américaine qui « soutient des programmes de recherche sur toutes les solutions contre le réchauffement », dont la géo-ingénierie. Il estime « très risqué d’éliminer certaines options aujourd’hui ».
Pour les autres, ces technologies ne constituent qu’une « folie d’apprentis sorciers ». La climatologue Valérie Masson-Delmotte, coautrice d’une étude sur les menaces de la géo-ingénierie dans les régions polaires, y voit une « dangereuse distraction » qui détourne des financements de la décarbonation et « fait miroiter une solution pour ne rien changer ». La géo-ingénierie ne s’attaque qu’à une partie des symptômes, et pas aux causes du réchauffement : les émissions de gaz à effet de serre.
Mais nombre d’experts, opposés ou favorables, considèrent désormais la géo-ingénierie comme inévitable. « On ne va pas empêcher que ces techniques soient mises en œuvre dans les dix ou quinze prochaines années. C’est aujourd’hui ma plus grande inquiétude », confie le climatologue Jean Jouzel. « A mes yeux, son utilisation par certains pays ou acteurs est désormais inéluctable, estime également Marine de Guglielmo Weber, chercheuse à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire et autrice de Géopolitique des nuages (Bréal, 184 pages, 13,90 euros). On est dans un système socio-économique qui verrouille une fuite en avant. On va préférer changer l’atmosphère que nos modes de vie. »
Théories du complot
Les financements ont augmenté en faveur de ces techniques ces dernières années, les programmes de recherche se multiplient, surtout aux Etats-Unis, et les débats prennent de l’importance au sein de la communauté scientifique. L’assemblée annuelle de l’Union américaine de géophysique, le plus grand rassemblement de chercheurs en sciences de la Terre, qui s’est tenue du 9 au 13 décembre 2024, y a consacré une trentaine d’interventions en partenariat avec SilverLining.
La géo-ingénierie était présentée sous le vocable d’« intervention climatique », un euphémisme témoignant d’une volonté de la normaliser. « Cela donne l’impression d’une intervention chirurgicale temporaire, passant sous silence qu’une fois lancée la géo-ingénierie doit être déployée pendant des siècles », prévient Valérie Masson-Delmotte.
Les observateurs guettent désormais un positionnement de Donald Trump de retour au pouvoir et qui ne s’est jamais exprimé sur le sujet. « Il y a un très grand risque que la géo-ingénierie solaire s’accélère sous cette nouvelle administration », prévient Prakash Kashwan, chercheur à l’université Brandeis, à Waltham, près de Boston, aux Etats-Unis, qui a signé une lettre ouverte aux côtés de plus de 500 chercheurs contre ces techniques. Le président américain, qui tourne résolument le dos à la transition écologique, pourrait être tenté par ces technologies afin de « limiter les vulnérabilités du territoire américain au réchauffement tout en préservant la source de son hégémonie, c’est-à-dire les hydrocarbures », détaille Marine de Guglielmo Weber.
Soutenir la géo-ingénierie impliquerait toutefois que Donald Trump reconnaisse la menace du réchauffement climatique, qu’il considère, pour l’instant, comme un « canular ». Ces technologies véhiculent en outre beaucoup de théories du complot auxquelles adhère une partie de l’électorat d’extrême droite américain, notamment celle des chemtrails, soit l’idée fausse que les traînées de condensation des avions masqueraient des épandages chimiques répandus à l’insu de la population. « On ne sait pas de quel côté va pencher le gouvernement américain », nuance Jean-François Lamarque.
« Polarisation croissante des pays »
L’urgence reste, dans tous les cas, de réglementer ce secteur qui ne jouit d’aucunes règles précises. En décembre 2024, le groupe des conseillers scientifiques de la Commission européenne a appelé Bruxelles à adopter un moratoire sur l’usage de la géo-ingénierie à l’échelle des Vingt-Sept. Il la pousse également à lancer la négociation d’un accord international pour encadrer ces technologies, dans laquelle l’Union européenne prônerait le non-déploiement « dans un futur proche ».
« Les risques de ces techniques sont très élevés et les incertitudes énormes sur les dommages qu’elles pourraient entraîner mais aussi sur le fait de réussir à éviter un climat dangereux », explique Eric Lambin, géographe à l’Université catholique de Louvain, en Belgique, et l’un des scientifiques qui ont rédigé l’avis.
Au mieux, leur déploiement réduirait temporairement une partie des effets du changement climatique (fonte des glaces, élévation du niveau de la mer, fréquence et intensité des événements extrêmes). Mais la géo-ingénierie solaire pourrait aussi, selon les technologies, réduire les précipitations dans certaines régions, diminuer les rendements agricoles, augmenter les pluies acides, détériorer la couche d’ozone et accroître les conflits.
Les pays ont, pour l’instant, échoué à s’accorder sur un cadre de gouvernance. « La possibilité d’un accord international consensuel et démocratique est illusoire, car on observe une polarisation croissante des pays, assure Marine de Guglielmo Weber. Il y a une forte chance que l’on ait des déploiements unilatéraux de certains Etats ou acteurs privés. » Alors que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni sont favorables à la recherche sur ces technologies, l’Afrique s’oppose à leur usage, soutenue par d’autres pays du Sud global, comme le Mexique ou le Vanuatu. La France n’a, pour le moment, pas adopté de position officielle sur la question.
Les clivages portent également sur l’opportunité de mener des recherches dans ce secteur. Pour l’instant, les projets en cours aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Suisse ou en Afrique du Sud restent majoritairement confinés dans des laboratoires. Quelques rares expériences ont eu lieu grandeur nature : des chercheurs australiens ont mené des tests d’éclaircissement des nuages marins sur la Grande Barrière de corail, en 2020 et en 2021, tandis que l’entreprise américaine Make Sunsets affirme avoir envoyé 124 ballons remplis de dioxyde de soufre dans la stratosphère, depuis 2022, suscitant de vives critiques.
Prendre des « décisions éclairées »
En juin 2024, la ville d’Alameda (Californie) avait également refusé la poursuite d’une expérience visant à éclaircir les nuages marins menée par l’université de Washington. Sarah Doherty, la directrice du programme, affirme explorer d’autres localisations « pour des études de terrain à petite échelle ». « Il est essentiel que la recherche scientifique commence dès maintenant, afin que des décisions éclairées puissent être prises à l’avenir concernant la géo-ingénierie solaire – s’il faut l’utiliser et comment », plaide-t-elle. « Sans quoi d’autres acteurs que des scientifiques répondront à ces questions, et c’est nettement plus risqué », souligne Jean-François Lamarque.
Les conseillers scientifiques de la Commission européenne préconisent également de n’autoriser « que des expériences scientifiques à l’extérieur de taille limitée ». « Etre dans l’ignorance en Europe affaiblirait notre position dans les négociations et nous empêcherait de détecter des expérimentations ou un déploiement non déclarés », argumente Eric Lambin.
Mais il met en garde : ouvrir la porte à la recherche présente un « risque de pente glissante » : « Une fois que l’on aura mené des expériences à petite échelle, on risque d’envoyer un signal que cela pourrait fonctionner et que cela peut entraîner un usage à grande échelle. »
Éric Daniel-Lacombe, urbaniste : « On n’arrête pas une inondation, on s’y adapte »
Lucie Delaporte
www.mediapart.fr/journal/ecologie/280125/eric-daniel-lacombe-urbaniste-n-arrete-pas-une-inondation-s-y-adapte
Article
Nos villes vont être de plus en plus exposées au risque d’inondations. Comment s’y adapter ? Entretien avec un urbaniste pionnier sur le sujet, Éric Daniel-Lacombe.
Tous les modèles scientifiques nous le disent : les inondations vont être à la fois plus fréquentes et plus violentes dans les années à venir en raison du dérèglement climatique. Comment adapter nos villes et nos villages à cette nouvelle réalité ? Peut-on empêcher les inondations ou faut-il vivre avec ce risque ?
L’architecte et urbaniste Éric Daniel-Lacombe, professeur titulaire de la chaire « nouvelles urbanités » face aux risques naturels à l’école d’architecture de La Villette, travaille depuis vingt ans sur le sujet. Il a accompagné les élu·es dans des territoires durement touchés comme la vallée de la Roya ou Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes-Maritimes.
Mediapart : Après l’Ille-et-Vilaine, c’est le Morbihan et la Loire-Atlantique qui sont aujourd’hui en alerte rouge inondation. Rennes et les communes alentour sont sous les eaux depuis dimanche. Est-ce que ce sont des territoires que vous aviez identifiés comme particulièrement vulnérables aux crues ?
Éric Daniel-Lacombe : Oui, ces territoires sont, comme un quart de la France, vulnérables aux inondations. Cela touche quand même un habitant sur quatre. Tous les cours d’eau français sont aujourd’hui concernés, et là, avec la proximité de la mer, il y a le phénomène de submersion qui vient s’y ajouter.
Mais ce qu’il faut tout de suite distinguer, c’est l’hétérogénéité des crues. Ici, on est en crue lente, c’est-à-dire qu’on a le temps, en principe, d’être alerté. Alors qu’à Mandelieu-la-Napoule, par exemple [territoire des Alpes-Maritimes frappé en 2015 par des inondations qui ont fait neuf morts – ndlr], ce fut une crue rapide. C’est beaucoup plus compliqué de se protéger. Et dans les vallées de la Vésubie ou de la Roya, au-dessus de Nice, ce sont des crues torrentielles qui ont charrié des cailloux et des rochers, et renversé des maisons et des ponts.
Pour les départements aujourd’hui touchés, on est face à des crues lentes, avec une décrue qui va intervenir assez rapidement, contrairement à des territoires comme le Pas-de-Calais, où l’eau ne se retirait pas.
Je tiens à préciser d’emblée cela parce que le phénomène « inondations » est très hétérogène et qu’on n’apporte pas les mêmes réponses selon ces réalités. Il faut faire du sur-mesure.
Face à ce type d’inondation, à crue lente, quelles peuvent être les réponses ?
Il faut noter que sur ces territoires qui sont amenés à être régulièrement inondés, comme ceux des bords de la Marne ou de la Loire, les gens sont attachés à leur lieu de vie et ne vont pas partir. Même à Valence, 1,8 million de personnes vont rester sur place. Donc le sujet est bien celui de l’adaptation.
Ma première réponse, c’est qu’on n’arrête pas une inondation, on s’y adapte. Et il faut le faire pour le court et le long terme. L’important est de ne pas reconstruire à l’identique, comme je le vois encore trop souvent, parce que les inondations vont revenir et provoquer les mêmes ravages, et avec des assurances qui ne voudront plus assurer…
Bien sûr que c’est difficile de vivre dans une maison lorsqu’elle est inondée, mais ce n’est pas tragique quand on y est préparé. Il y a des adaptations assez simples qui pallient les plus graves désagréments à la prochaine crue. Par exemple, le frigo et la chaudière doivent être mis à l’étage. Se nourrir, se chauffer, c’est vital. Quand l’eau arrive, on s’est aperçu que c’était très utile de mettre des filtres – des grillages fins –, cela évite de faire rentrer les rats, les ordures, les matières fécales. Quand il faut nettoyer derrière, vous êtes quand même mieux. Installer les WC à l’étage permet de prévenir de gros désagréments. C’est le court terme.
Et à plus long terme ? Comment rendre nos maisons moins vulnérables ?
Tout le monde nous dit qu’il faudrait que la maison soit imperméable. Et tout ce que j’ai appris en vingt ans, c’est que c’est l’inverse. Pour qu’une maison réagisse mieux après l’inondation, elle doit être perméable parce que c’est comme ça que vous allez la laver et c’est ainsi qu’elle va sécher.
Une maison ne peut jamais être « étanche » : l’eau arrive par les nappes phréatiques, par les réseaux. Plutôt que du béton étanche, mieux vaut une chaux qui respire. J’entends parfois dire qu’il faut chauffer après pour que la maison sèche : pas du tout. Chauffer, ça pousse l’humidité dans les murs. Au bout d’un mois, vous avez toujours votre maison pourrie. Il faut au contraire ouvrir les fenêtres et tout aérer.
Dans certaines zones très à risque, il faudrait développer un accès à plus de bateaux à fond plat, c’est ce que j’ai conseillé dans le cadre de ma mission pour une ville du Grand Paris. Cela peut éviter des morts, donc ce n’est pas un petit sujet. Et pour ceux qui vivent près d’un fleuve ou d’une rivière, cela peut avoir un intérêt. Les pratiques avec l’eau – aller à la pêche, faire de la barque – doivent être réintroduites. En Floride, tout le monde a son bateau pour les inondations.
Face au risque d’inondations, qui vont être plus fréquentes et plus fortes, faut-il complètement repenser nos villes ?
Encore une fois, cela dépend des réalités territoriales. À Mandelieu-la-Napoule, je dessine la ville pour qu’elle soit métamorphosée pour supporter des inondations rapides, parce qu’il y a eu des morts en 2015 et en 2019. Il faut savoir renoncer : il y a là-bas des terrains qui devaient être construits et qui ne le seront pas. Il fallait complètement revoir l’organisation de la ville.
À Romorantin [ville du Loir-et-Cher touchée par des inondations à répétition – ndlr], nous avons modelé le terrain. Nous avons par exemple surélevé de 1 mètre deux rues parallèles à la rivière. C’est cela qui a permis à des gens, lors de la grande crue de 2016, de rentrer et sortir de leurs habitations, parce qu’ils étaient un peu plus protégés. Le quartier Matra de Romorantin est d’ailleurs le premier quartier à résister à plus de 1,50 mètre d’eau sans dégâts.
Une grande partie de mon travail consiste à dessiner des creux et des bosses. Des creux pour laisser de la place à la rivière et des bosses pour protéger les habitations. C’est mieux que de raser les maisons et mieux que de construire une digue autour du village.
Mais justement, n’y a-t-il pas des ouvrages à réaliser en amont des villes pour empêcher les inondations ? On pense à des digues, des barrages… Pour le Bassin parisien, il y a le projet de grandes retenues.
Les digues pour empêcher les inondations, c’est fini. On y a cru au XXe siècle et on a vu le résultat. Une digue, ça cède et ça fait des morts, comme à La Faute-sur-Mer [29 morts lors de la tempête Xynthia en 2011 – ndlr], à Fukushima ou en Louisiane. Les gens pensaient être à l’abri pour toujours face à l’aléa mais c’est cela qui tue. C’est de ça qu’il faut sortir.
Les projets Seine Bassée, avec des retenues en amont de Paris, c’est très bien, mais cela ne permet d’écrêter le niveau de l’eau en cas d’inondation que de 10 à 15 centimètres, pas plus. Cela n’empêchera pas les crues à Paris, il y aura un peu moins d’eau.
Il faut développer notre culture de l’aléa. Et cela, aucun service de l’État et aucun élu ne peut vous l’apporter.
Dans les villes où vous avez pu intervenir, vous dites qu’il faut « laisser la place à la rivière ». Mais quand on est dans un contexte urbain dense, qu’est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire qu’il faut sortir du mouvement inventé par la modernité de séparation entre la ville et la nature. Il faut en réalité revenir à ce que j’appelle des régulations naturelles. C’est un mouvement qui va prendre encore bien plus de temps…
En 2021 ont eu lieu de très graves inondations en Europe qui ont touché la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, avec des effondrements de terrain et des dégâts monstrueux. Le pays des trois qui s’en est le mieux sorti est les Pays-Bas parce que, depuis 2004, ils ont un programme qui s’appelle tout simplement « Laisser plus de place aux rivières ». Ce pays, qui a finalement bâti son urbanité avec l’eau et des polders, a compris que c’est en laissant de la place à la rivière qu’on obtiendra des résultats de réduction de vulnérabilité. Réduire la vulnérabilité, ce n’est pas arrêter l’eau. Il vaut mieux travailler en amont pour que la rivière coule moins vite et mieux.
C’est aussi ce que j’ai appris des territoires des vallées de la Roya. La rivière de la Vésubie avait un espace de 5 mètres quand les terribles inondations sont arrivées. Aujourd’hui, on lui a donné à peu près 100 mètres pour se déplacer. C’est un énorme progrès.
Vous insistez aussi sur le rôle des habitants en plus de celui de l’État et des collectivités.
Il y a des mesures de sécurité évidentes à connaître : ne pas se déplacer, ne pas prendre sa voiture, laisser les enfants à l’école, se mettre à l’étage, couper le gaz… Là-dessus, beaucoup de progrès ont été faits en France. Si on compare à l’Espagne, on voit tout ce qui n’a pas fonctionné à Valence sur ces points.
Mais je défends, bien plus largement, le développement d’une culture de la prudence parmi les habitants. Je n’en peux plus d’entendre le maire engueuler l’État, et l’État engueuler le maire après de telles catastrophes. Se renvoyer sans cesse la balle, cela provoque des rancœurs pour toujours, et ça ne fait pas avancer le chemin de l’adaptation.
Je travaille bien sûr avec l’État et les élus locaux. Mais une fois que ces deux acteurs sont impliqués, qui faut-il transformer en même temps que les maisons ? Ce sont les habitants.
Comme un pêcheur sait lire la mer et ne sort pas certains jours, comme un guide de montagne est plus prudent qu’un Parisien qui vient faire le tour du mont Blanc, il faut développer notre culture de l’aléa. Et cela, aucun service de l’État et aucun élu ne peut vous l’apporter.
Selon son territoire, il faut connaître les courants de la Loire, maîtriser les baïnes des Landes ou les ressacs des Alpes. Il y a du travail avec une population majoritairement urbaine qui ne sait plus lire ces signes et à laquelle on continue de vendre l’idée d’une ville « étanche » aux phénomènes naturels.
Intervenir auprès des habitants en ce sens est d’ailleurs l’aspect le plus agréable de mon métier. Il y a des débats, des retours d’expériences… c’est dialectique. Ce n’est pas à l’architecte de dire comment il faut vivre, on n’en est plus là. Chacun est acteur de son territoire.
Bien manger sans se ruiner : un village expérimente la Sécurité sociale de l’alimentation
Sophie Bourlet
https://reporterre.net/Bien-manger-sans-se-ruiner-un-village-experimente-la-Securite-sociale-de-l-alimentation
Article
Un village du Vaucluse imagine comment garantir l’accès à une nourriture de qualité pour tous. Une proposition de loi pour élargir l’expérience a été déposée.
« C’est bien meilleur que le premier prix ! » s’exclame Annie, 62 ans, en sortant un jus de poire de son placard. Produit par une ferme biologique de Cavaillon, à quelques kilomètres de chez elle, le jus rentre dans le dispositif de Sécurité sociale alimentaire (SSA) de Cadenet (Vaucluse). Celui-ci permet à 33 habitants de ce village qui en compte 5 000 de bénéficier de 150 euros par mois pour acheter des produits locaux et de qualité. Annie, encouragée par une voisine, s’est inscrite dans le dispositif à la fin de l’année 2023 et a été tirée au sort.
Elle explique le fonctionnement : « J’ai acheté ce jus au magasin de producteurs. Ils me font une note et je suis ensuite remboursée, comme avec une feuille de soins. » Elle le confesse, elle n’avait auparavant jamais mis les pieds là-bas, rebutée par les prix. « Il faut aider les producteurs locaux, mais c’est trop cher… » regrette-t-elle. En racontant qu’un autre membre l’a invitée à cuisiner un poulet local, elle constate que le dispositif lui a permis de découvrir certains produits dont elle n’avait pas l’habitude, mais aussi « de participer à une aventure humaine pour aller vers quelque chose de commun ».
Cette initiative, portée par le Collectif local de l’alimentation de Cadenet (Clac), a été initiée en 2020 par l’association Au Maquis, qui organise des actions sur l’alimentation, en milieu rural, comme dans les quartiers populaires des villes environnantes, Pertuis, Apt ou Cavaillon. Elle est financée par une subvention de 60 000 euros de la Fondation de France et la Fondation Carasso pour une deuxième année d’expérimentation.
« Faire découvrir le goût des tomates, c’est bien, mais qu’est-ce qui se passe dans mon quotidien si je n’ai pas les moyens, ni l’offre locale, ni un accès facile à cette alimentation ? » questionne Éric Gauthier, salarié de l’association et l’un des premiers à s’être mobilisé sur le sujet. Pendant le confinement, il a découvert les travaux sur l’alimentation de l’économiste Bernard Friot, de la Confédération paysanne et du Réseau salariat.
Rapidement, un comité de pilotage a rassemblé des citoyens, des élus, des agriculteurs et des acteurs de l’aide alimentaire pour réfléchir aux contours du projet autour de la question d’« un avenir alimentaire désirable en 2052 ». Le Clac est né et formule rapidement un objectif : faire une expérimentation locale de sécurité sociale alimentaire. « C’était hyper enthousiasmant de se retrouver à penser notre futur de l’alimentation et de décider ensemble », s’exclame Thomas Hourquet, bénévole des premières heures devenu salarié.
Le collectif se réunit deux fois par semaine depuis 2022 pour décider du conventionnement des produits. Les habitants définissent ensemble les critères des produits éligibles à la prise en charge et à quel taux, comme pour les médicaments. À Cadenet, cinq critères ont été retenus : l’impact environnemental, les conditions de travail des producteurs, la proximité, la taille de l’exploitation et l’indépendance vis-à-vis de l’agro-industrie. Chaque produit est évalué, puis classé dans l’un des trois niveaux de remboursement (30 %, 70 % ou 100 %) en fonction de son adéquation avec l’avenir alimentaire désirable.
Ceux qui sont remboursés en intégralité sont les « produits exemplaires », comme les légumes locaux ou le pain du paysan-boulanger ; à 70 %, on retrouve par exemple ceux en amélioration comme la viande en conversion bio ; et à 30 %, des produits importants mais non conformes à tous les critères, tels que les fromages fermiers non locaux ou des produits issus du commerce équitable.
« Le conventionnement démocratique est l’un des piliers de la SSA », explique Sarah Cohen, ingénieure à l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae), qui pilote une expérimentation similaire à Toulouse, Caissalim, comptant plus de 250 adhérents, pilotés par quatre comités indépendants. Elle explique que dans le nord de cette ville de Haute-Garonne, les fruits et légumes de la Biocoop sont conventionnés, car il n’y a pas d’alternative, alors que le comité du sud a choisi de privilégier la vente directe auprès des producteurs des nombreux marchés locaux, bio ou non.
À Cadenet, les produits sont disponibles à travers le magasin de producteurs, une Amap et l’épicerie du village. Les producteurs sont enthousiastes et notent le lien qui se crée avec le client : « Ça nous donne de la visibilité vis-à-vis des personnes qui n’auraient pas forcément le réflexe de venir au marché ou qui ont déjà du mal à finir les fins de mois », dit Alexis Mathieu, 38 ans, producteur de légumes bio et d’œufs, rencontré sur le marché du lundi à Cadenet.
Une expérience en autogestion
Et si la maigre retraite d’Annie ne lui permet pas d’acheter en temps normal des produits locaux et bio, la sélection des bénéficiaires n’est pas basée sur les revenus des personnes, contrairement à de nombreuses aides alimentaires, déjà existantes. Là encore, la Clac tente une expérience démocratique avec la mise en place du tirage au sort pour sélectionner les trente-trois personnes en octobre 2023, parmi une cinquantaine de motivés, cinq places étant réservées aux membres fondateurs et cinq autres sélectionnés par l’épicerie solidaire du village.
Elle est par ailleurs complètement autogérée par ses usagers. « Quand on a pensé à la sécurité sociale en 1946, elle était universelle, car elle visait à créer un droit pour tous ! » remarque Sarah Cohen, qui explique que l’universalité est un autre pilier du projet.
L’expérimentation vauclusienne n’a cependant pas vocation à grandir trop vite. « Fournir 150 euros d’alimentation par mois rien qu’à tous les habitants de Cadenet exigerait des moyens colossaux, à la hauteur de 8 millions d’euros, soit le budget global de la commune », souligne Éric Gauthier. Le financement de cette potentielle sixième branche de la Sécu est estimé entre 120 et 170 milliards d’euros pour l’ensemble de la population selon les scénarios.
« Aujourd’hui, la sécu est en partie financée par les impôts, ce qui la rend dépendante du gouvernement. Entre 1946 et 1967, c’était les caisses locales qui décidaient des cotisations, en fonction des dépenses de santé prévues, et elles étaient constituées en majorité par les travailleurs », explique la chercheuse, qui planche avec d’autres sur la possibilité de faire participer des entreprises — en cotisant comme elles le font pour la santé ou les retraites — ou les professionnels qui bénéficient du conventionnement, en attendant une loi nationale.
« On pourrait imaginer un système alimentaire socialisé »
En octobre, Charles Fournier, député écologiste de l’Indre-et-Loire, a d’ailleurs déposé une proposition de loi pour élargir l’expérimentation, qui est fédérée au niveau national par un mouvement national intercollectifs, qui partage les apprentissages.
Plus d’une trentaine d’initiatives similaires ont essaimé à Montpellier, Toulouse, Paris ou encore dans la Drôme. Si l’ambition est commune, chacune a des spécificités liées à son contexte, comme l’utilisation de monnaie locale ou la valorisation des circuits courts.
Éric Gauthier s’inquiète, lui, qu’une mise en œuvre nationale trop rapide favorise les grands acteurs agro-industriels, mais surtout dilue l’essence démocratique du projet : « Le sujet de l’alimentation peut très facilement être récupéré de manière populiste. Il est crucial que cela reste une question populaire, démocratique et pas partisane. »
Profondément convaincu du modèle, il voit même plus loin : « En s’inspirant de la manière dont on a construit notre politique publique de santé, on pourrait imaginer un système alimentaire socialisé, où l’outil de production n’appartiendrait plus à des individus endettés, mais aux caisses primaires d’alimentation gérées de manière démocratique », dit le salarié du Maquis, pour qui le projet revêt des atours révolutionnaires et une vraie proposition de société future.
Biziola, bizitzaren fabrika
GOGOETA
www.enbata.info/articles/biziola-bizitzaren-fabrika
Article
Biziola irabazi asmorik gabeko eta gizarte ekimeneko kooperatiba da, Lazkaon (Goierri eskualdea, Gipuzkoa) kokatua. Besteak beste, Goierri eskualdeko herritarrak eta ekonomia sozial eraldatzaileko eragileak saretu nahi ditu, eskualde burujabeago, iraunkorrago eta orekatuago baten bidean proiektu zehatzak gauzatzeko. Bizitzarako funtsezkoak diren ahal bezainbat eremutan burujabeago izateko prozesu eta proietuak garatzea du xede bizitzaren fabrika adieraren laburdura den Biziolak! Enbataren galderei hainbat zehaztasunekin erantzun die Biziola kooperatibaren bazkide eta Kontseilu Errektoreko kidea den Andoni Mikelarena Urdangarin Beasaindarrak.
Enbata: Goierri eraldatzeko egitasmoa den Biziolaren erronkak ulertzeko, zuen eskualdearen azken hamarkadetako ezaugarriak kontuan hartzea komeni da…
Andoni Mikelarena Urdangarin: Goierri, Gipuzkoan kokatuta dagoen 45.000 biztanle inguruko eskualdea da, herri txikiz, ertainez eta handiz osatua (handienak 14.000 biztanle ditu). Ekonomiari dagokionez industria izan da azken hamarkadetan eskualdeko ekonomiaren motorra. Industriaren baitan azpimarratzekoa da kooperatibismoak duen pisua. Azken urteetan ordea, industriaren pisua pixkanaka bada ere jaisten ari da eta zerbitzuen sektorea indartzen. Bitartean, landa eremuan kokaturiko eskualdea izan arren, lehen sektoreak beherakada larria izan du azken urteetan.
Horiek horrela, Biziolatik hiru helburutan egin nahi dugu ekarpena eskualde hobea lortzeko. Alde batetik Goierri burujabeagoa nahi dugula diogu, bizitzarako funtsezkoak diren eremu ekonomikoetan kanpoko dependentziak murrizten joango dena pixkanaka. Hor azpimarra berezia egiten dugu elikaduraren eta energiaren arloetan. Bestetik, Goierri orekatuagoa nahi dugula diogu. Herri txiki eta handien arteko, klase, arraza zein genero arloko desorekak murriztuko dituena. Eta azkenik eskualde iraunkorragoa. Gure jardun ekonomiko eta soziala lurraren mugekin bateragarri egingo duena. Azken arlo horretan berebiziko erronka dugu gurea bezalako eskualde industrialean, gure ekonomiaren oinarria oso intentsiboa baita materialetan eta energian.
Helburu horiek erdiesteko berriz, lanerako hiru ardatz finkatu ditugu. Ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuen arteko interkooperazioa lehenik. Ez soilik dagoeneko existitzen diren proiektuen artean elkarlanean aritzeko, elkarrekin dimentsio handiagoko proiektu eta erronkei heltzeko baizik. Bestetik, erronka edo hutsune zehatzei erantzuteko proiektu kolektiboak martxan jartzea. Ekintzailetza neoliberalaren markoari aurre egin, eta norbaiti nonbait ideia zoragarri bat sortu arte itxaron beharrean, gure gizartearen erronkak identifikatu, erronka horiekin lotura duten eragileak saretu eta elkarrekin proiektu eraldatzaileak sortu. Hirugarrenik heziketan jarri dugu begirada. Ekonomia ulertzeko eta bizitzeko modu bizigarriagoak daudela ikustarazteko eta gaur egungo eredu ekonomikoaren izaera ulertzeko ezinbestekoa baita pertsonak heztea epe luzeko ikuspegiarekin. Eremu estrategikoa da hau, epe luzera sakoneko eraldaketak lortu nahi baditugu.
Nolaz etorri zitzaizuen Goierri burujabeago, iraunkorrago eta orekatuagoaren bidean proiektu zehatzak martxan jartzeko egitasmo baten sortzeko ideia?
Biziola proiektua deialdi herritar baten bidez sortu zen. Goierrin Ekonomia Sozial Eraldatzailearen lehen topaketak antolatu zituzten, arlo horretan lanean zebiltzan bi kidek Olatukoop sarearen babesarekin. Topaketa horietan ia 40 lagun elkartu ginen, baita Goierrin dagoeneko lanean zebiltzan ekonomia sozial eta eraldatzaileko proiektu ugari ere. Ikusirik bazela jendea, gogoa eta ilusioa eskualdean etorkizunera begira funtsezkoak ziren auzietan burujabetzen ikuspegitik ekarpena egiteko, sare gisa funtzionatzen hastea erabaki genuen. Bi urteko jardunaren ostean, sare horrek Biziola Kooperatiban hartu zuen gorputza.
Prozesu hori posible egin duten sakoneko baldintzak ere baziren ordea. Lehen aipatu dugu gure eskualdeko industrian kooperatibismoak pisu berezia duela. Bada, gure eskualdean duela 50 urte inguru egon zen bulkada komunitario eta kooperatibo handi bat, neurri handi batean gaur garen eskualdea izatea posible egin duena. Bulkada horretan sortu ziren kooperatibak, sindikatuen indartzea, euskalgintza… eta ordutik eskualde izaera sendoa du Goierrik. Nolabait Biziolaren sorrera prozesuan orduko bulkada horren gaurkotze bat planteatzen da. Gure eskualdeak dituen erronka berriei, autoeraketa komunitarioaren bidez erantzutea.
Zein izan ziren irabazi asmorik gabeko eta gizarte ekimeneko kooperatibaren lehen pausu eta lorpenak?
Biziola Kooperatiba sortzeko bi prozesu paralelo gertatu ziren. Batetik, aurrez azaldu bezala eskualdeko ekonomia sozial eraldatzaileko eragileak, mugimendu sozialak eta herritarrak batzen zituen sarea osatzen joan ginen pixkanaka. Eta bestetik, eskualdean elikadura burujabetzaren arloan erronka itzela genuela ikusita, elikadura kateko dozenaka pertsona eta eragilerekin prozesu bat abiatu genuen arlo horretan zeuden erronkei erantzuteko proiektuak elkarrekin martxan jartzen hasteko. Hortik sortu zen irabazi asmorik gabeko kooperatiba integral bat martxan jartzeko beharra, zeinak herritarrak, eskualdeko elikagai ekoizleak eta ekonomia sozial eraldatzaileko eragileak egitura beraren baitan antolatuko zituen. Elikadura burujabetzaren erronkatik abiatu eta pixkanaka bizitzarako funtsezkoak diren esparru gehiagotan burujabeago izan gaitezen proiektuak martxan jartzeko. Gaur egun 500 bazkide baino gehiago ditu kooperatibak: eskualdeko 30 elikagai ekoizle, ekonomia sozial eraldatzaileko 8 eragile, 5 erakunde laguntzaile eta 470 herritar bazkide inguru.
Biziolak bere aktibitateak kokatzen dituen gunea osoki erosteko xedearen nondik norakoak aurkez diezazkigukezu, baita erronka berri horren lortzeko jorratzen dituzuen bide berriak ere?
Biziolaren egoitza Lazkaoko fabrika ohi batean kokatuta dago. Orain arte denda, banaketarako biltegia, gozogintzarako obradorea eta hitzaldi zein aurkezpenetarako plaza kokatuta zeuden bertan. Orain, Koop57 finantza zerbitzuak lantzen dituen kooperatibarekin, Biziolaren egoitza erosteko apustua egin dugu. Epe ertainera nahi dugu Biziola Fabrika eskualdean lanean dabiltzan ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuen topaleku bihurtu. Elkarrekin lanerako espazioak ere partekatuta, eskualdean egin dezakegun ekarpena indartsuagoa dela uste baitugu.
Zer egiteko molde berezi praktikatzen du Biziolak lurraldearen eraldatzeko herritar gero eta gehiago kolektiboki eta eraginkorki ekitera animatzeko?
Anbizioa eta interkooperazioa. Bi osagai horiek funtsezkoak dira, Biziola gisako proiektuak aurrera eramateko. Alde batetik, komunitate zabal bat antolatzeko funtsezkoa da komunitate zabal horren kezka edo desioekin konektatzea, eta horiei erantzuteko moduko alternatiba edo zerumuga sinesgarri bezain anbiziotsuak proposatzea. Bestetik, funtsezkoa da ere, irudikatutako zerumuga horietarantz pausoak eman ahal izateko interkooperazioa estrategiaren erdigunean kokatzea. Horrek ematen baitu aukera, ezagutza eta esperientziak partekatu eta elkarrekin proiektua modu eraginkorragoan garatzeko. Gainera, proiektuaren parte ere sentiarazten gaitu, eta hori funtsezko osagaia da proiektuak epe luzera arrakasta izango badu.
Horrelako proiektu kolektibo baten oinarrian, militantzia ezinbestekoa da. Biziolan ere horrela izan da sorreratik. Gaur egun proiektuan lan egiten duten zenbait bazkide baldin badaude ere, proiektuaren hastapenetatik milintantziak garrantzi berezia izan du. Baina badakigu ez dela erraza jendea proiektua kolektiboetan engaiatzea, horregatik funtsezkoa izan da zenbait aldagai kontuan izatea. Alde batetik, ulertzea konpromiso maila ezberdinak egongo direla proiektuan, eta bakoitzak bere aukera eta desioen araberako ekarpena egiteko bideak antolatu zein aitortzea.
Bestetik, bazkide komunitatea proiektuaren urrats garrantzitsuen parte sentiaraztea eta urrats horiek berak komunitatearekin batera ematea. Hor barne komunikazioak funtsezko funtzioa betetzen du. Baina proiektuaren identitate kolektiboa sortzea ere oso garrantzitsua da. Bazkide bakoitzak sentitu dezan bere ekarpen eta laguntzarekin proiektu eraldatzaile garrantzitsua ari dela garatzen.
2025. urtean zehar Biziolaren proiektuen ondorioen ezagutzeko parada ukaiteko Goierri bisitatuz, zein gune, iniziatiba edo hitzordu azpimarratuko zenieke Ipar Euskal Herriko herritarrei?
2025eko agenda oraindik lantzen ari gara. Hala ere ekain aldera Bazkideon batzar orokorra egin ohi dugu urtero eta aukera interesgarria izan daiteke, proiektua bere osotasunean ezagutu ahal izateko. Ildo horretan bereziki aipatzekoa da Itsason bertako herritar talde batek sustatuta eta Biziolarekin lankidetzan martxan jarri duen proiektu berritzailea. Herrian denda bat falta zutela ikusirik eta denda hori bideragarri egiteko une oro dendan egongo zen langile bat asumitu ezin zela ikusita (dendaren bolumenengatik), autogestioan oinarritutako denda bat jarri da martxan. Dendak, prozesuak ahalik eta automatizatuenak ditu. Alegia erosketa bat egiten duenean dendako bazkide den norbaitek bere kasa, aplikazio informatiko baten bidez zer erosi duen erregistratzen da, eta horrela astean behin denda hornitzen dute Biziolak eta ondoko herriko beste denda batek, falta diren edo gastatu diren produktuekin. Herri txikietara zerbitzuak eramateko eredu interesgarria da. Eta gainera herri horietan janariaren edo bestelako zerbitzuen inguruan komunitatea antolatzeko aukera ona eskaintzen du.