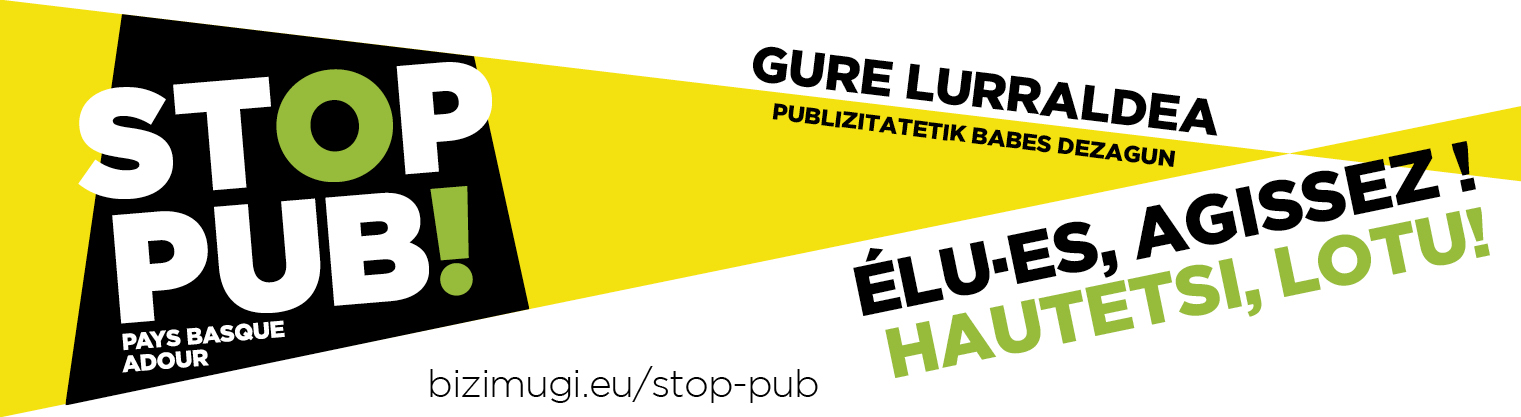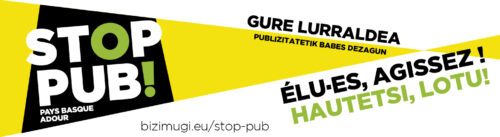Météo-France décrit une France à +4 °C apocalyptique
Hortense Chauvin
https://reporterre.net/Meteo-France-decrit-une-France-a-4oC-apocalyptique
Article
Records de chaleurs, de pluies, de sécheresses… Dans un rapport, Météo-France décrit le climat d’une France à +4 °C, soit la hausse des températures prévue pour 2100.
Des canicules s’étendant de mi-mai à mi-septembre, et pouvant durer deux mois continus ; des épisodes de sécheresse durant des années ; une multiplication par dix des jours de vagues de chaleur et de nuits tropicales ; des montagnes privées de neige pendant la majorité de l’hiver…
Dans un rapport publié jeudi 20 mars, Météo-France décrit le climat d’une France à +4 °C. Il s’agit de la hausse du thermomètre attendue en 2100 (par rapport à l’ère préindustrielle) si les politiques climatiques poursuivent leur trajectoire actuelle. La France se réchauffe plus vite que le reste du monde. Sans changement majeur de l’action climatique internationale, la température moyenne devrait y être supérieure de 2 °C aux moyennes préindustrielles en 2030, et de 2,7 °C en 2050. Les États qui ont signé l’Accord de Paris s’étaient pourtant engagés, en 2015, à limiter le réchauffement à 1,5 °C.
« C’est un autre pays qui nous est raconté. Les extrêmes seront tellement intenses et fréquents qu’il ne s’agira plus de vivre mais de survivre à de tels bouleversements », a décrit le climatologue et directeur de recherche au CNRS Davide Faranda aux journalistes du Monde. « Dans de nombreux cas, les moyennes du futur pourront ressembler aux extrêmes des dernières années », ajoute Jean-Michel Soubeyroux, directeur adjoint à la climatologie à Météo-France et auteur principal de l’étude, qui appelle à se préparer « dès maintenant ».
Records de chaleur jusqu’à 50 °C
Ainsi, à la fin du siècle, une année telle que 2022 — la plus chaude jamais enregistrée en France — pourrait sembler exceptionnellement fraiche. Des records de chaleur jusqu’à 50 °C seraient possibles localement dès l’horizon 2050 et deviendraient « probables » lors des canicules en 2100. Les habitants du sud de la France, mais aussi du centre, de l’est et de la région parisienne seraient touchées par ces chaleurs extrêmes, dont les conséquences sanitaires peuvent aller jusqu’à la mort.
La ressource en eau s’amenuiserait drastiquement, ce qui promet d’augmenter le nombre et l’intensité des incendies. En 2100, les sols de la moitié nord du pays pourraient rester secs pendant quatre à cinq mois, et ceux des régions méditerranéennes et de l’Occitanie, plus de sept mois. Les épisodes de pluie intense devraient néanmoins s’aggraver, entraînant inondations et pertes agricoles. La neige, elle, deviendra de moins en moins présente dans notre paysage. Les Alpes du Sud, à 1 800 mètres d’altitude, ne seraient par exemple plus enneigées que 52 jours par an, contre 132 jours dans les années 1990.
Notre santé, notre économie, nos activités sociales, touristiques et culturelles… Tous les domaines promettent d’être bouleversés par cette modification rapide du climat.
Parmi les secteurs les plus affectés : l’agriculture. « Aucune culture française ne survit à des températures [de 45-50 °C] », réagit Serge Zaka sur le réseau social Linkedin. Selon l’agroclimatologue, de telles chaleurs réduiraient à néant les champs de maïs et de tournesol, tueraient massivement les vaches laitières, brûleraient les cultures maraîchères. « Quelqu’un a une solution ? fait mine de s’interroger le chercheur. Je veux bien proposer des stratégies d’adaptation, mais à +4 °C, il n’y en a plus. »
Inaction gouvernementale
Le gouvernement a justement présenté son troisième plan d’adaptation le 10 mars dernier. Malgré quelques maigres avancées, le texte « reste un brouillon inabouti, un assemblage de mesures floues », selon Oxfam.
« En plus d’être dépourvu d’objectifs ambitieux, le plan national d’adaptation au changement climatique prévoit de financer ces politiques avec des fonds que [le gouvernement] vient tout juste de supprimer, comme la coupe dans le fonds vert », soulignait également l’ONG, en dénonçant un « bricolage budgétaire aberrant ».
Seule solution : diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, insiste Météo-France dans son rapport. Or, au fur et à mesure que les pouvoirs publics mettent l’accent sur l’adaptation, la lutte contre le changement climatique — afin d’éviter une hausse du thermomètre de 4 °C — paraît reléguée à l’arrière-plan.
Un paradoxe souligné par le chercheur Thierry Ribault : « Le gouvernement déclare que nous devons nous adapter à 4 °C supplémentaires en 2100, mais dans le même temps, il continue, voire accélère, l’industrialisation de l’agriculture, l’extractivisme et tous les délires technophiles responsables de la catastrophe, analysait-il sur Reporterre. Il nous dit de nous préparer au pire et à un futur catastrophique, mais il ne fait absolument rien ici et maintenant. »
La baisse des émissions de gaz à effet de serre marque un net ralentissement en France
Audrey Garric
www.lemonde.fr/planete/article/2025/03/28/climat-la-baisse-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-marque-un-net-ralentissement-en-france_6587076_3244.html
Article
Les rejets carbonés ont diminué de 1,8 % en 2024 par rapport l’année précédente, selon des données provisoires. Un chiffre très inférieur à la réduction de 5,8 % enregistrée en 2023.
La lutte contre le réchauffement climatique marque le pas en France. La baisse des émissions de gaz à effet de serre a fortement ralenti en 2024 dans le pays. Elles ont diminué de 1,8 % par rapport à 2023, selon les données provisoires publiées par le Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique (Citepa), vendredi 28 mars. Un chiffre très inférieur à la réduction de 5,8 % atteinte entre 2022 et 2023.
Le respect des objectifs climatiques nationaux implique d’aller presque trois fois plus vite, puisqu’il s’agit de réduire les émissions de 4,7 % par an en moyenne entre 2022 et 2030. « La trajectoire de nos émissions en 2024 marque un tournant net (…) alors que le plan prévoit d’accélérer », s’inquiétait déjà fin février le secrétariat général à la planification écologique, dans une note interne destinée à l’exécutif et consultée par Le Monde.
« Les émissions continuent à baisser, ça, c’est la bonne nouvelle, nous sommes toujours sur la bonne trajectoire, assure Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition écologique, interrogée sur TF1 vendredi. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il y a deux secteurs où c’est compliqué : les transports et les bâtiments. Il ne faut pas baisser la garde. » « C’est un vrai signal d’alarme », réagit de son côté Anne Bringault, la directrice des programmes au Réseau Action Climat, qui appelle à « un sursaut ».
Pourquoi un tel ralentissement ? La réduction des émissions lève le pied dans tous les secteurs entre 2023 et 2024, à l’exception de celui de la production d’énergie. Elles baissent de seulement 0,7 % dans les transports, le premier émetteur en France (qui pèse pour 33 % des rejets du pays). Cette légère décrue est liée à la diminution des ventes de carburants (− 0,5 %). Les émissions du transport aérien domestique décroissent plus rapidement en revanche (− 4,3 %), contrairement à celles des vols internationaux (+ 5 %), lesquelles ne sont pas incluses dans le bilan national. « Globalement, le secteur s’écarte de la trajectoire », prévient le Citepa.
Hausses limitées des prix de l’énergie
Les émissions du secteur du bâtiment enregistrent une « faible diminution » de 1,1 %, selon le Citepa. En cause : l’important reflux du nombre de rénovations énergétiques en 2024 (− 40 % comparé à 2023), ainsi que la chute du nombre d’installations de pompes à chaleur et de chaudières à biomasse, tandis que celles au fioul et au gaz connaissaient un léger rebond. Les hausses limitées des prix de l’énergie et à la consommation ont pu également jouer, en incitant moins à la sobriété. A l’inverse, les températures douces de 2024 ont quelque peu réduit le besoin de chauffage.
Dans l’industrie, les émissions diminuent de 1,8 %, sous l’effet d’une baisse de la production dans le secteur des matériaux de construction et des ressources minérales (ciment, verre, etc.). En revanche, les émissions de la métallurgie ont augmenté, notamment liées à la hausse de la production d’aluminium. Les bons résultats dans le secteur de la production d’énergie (− 11,6 %) découlent du moindre recours aux centrales à gaz, grâce à la reprise de l’activité des réacteurs nucléaires arrêtés en 2022 et à une forte production hydraulique. Les émissions 2024 de l’agriculture et des déchets ne sont pas encore connues.
Au total, hors importations, les activités sur le territoire français ont émis 366 millions de tonnes équivalent CO2 en 2024. Avec ce résultat, l’objectif indicatif pour l’année inclus dans la deuxième stratégie nationale bas carbone, actuellement en vigueur, est tenu. Mais il est raté de peu si l’on regarde la troisième stratégie, qui devrait être publiée au deuxième semestre. Cette nouvelle stratégie est plus ambitieuse pour s’aligner sur les nouveaux objectifs de réduction des émissions de 50 % en brut d’ici à 2030 par rapport à 1990 et de 55 % en net.
« Stop and go »
Sur le long terme, le budget carbone (plafond d’émissions) sur la période 2019-2023 est « en voie d’être respecté » pour les émissions brutes, précise le Citepa. En revanche, le Haut Conseil pour le climat prévenait en 2024 qu’il devrait être dépassé pour les émissions nettes, qui incluent les puits naturels (forêts, etc.), en mauvais état. Surtout, le respect du budget carbone 2024-2028 et des objectifs pour 2030 sera impossible sans une « accélération forte de la baisse des émissions », rappelle le Citepa.
Dans l’immédiat, la transition écologique menace de dérailler, victime de nombreux renoncements et attaques. « Dès que l’on lève le pied sur les mesures politiques, l’effet est immédiat », juge Anne Bringault, dénonçant les coupes budgétaires dans des secteurs essentiels à la transition, les « stop and go » au soutien à la rénovation énergétique ou l’absence de nouvelles politiques dans les transports. Elle appelle à soutenir les véhicules électriques, dont le déploiement stagne et accuse du retard, reconduire le leasing social – un des leviers pour permettre aux ménages à bas revenus d’accéder à ces voitures –, investir dans les transports en commun ou encore relancer les trains de nuit.
Pour tenter de redresser la barre, le gouvernement a annoncé la tenue d’un conseil de planification écologique lundi 31 mars, présidé par Emmanuel Macron en présence de ministres. Ce rendez-vous, qui n’avait pas eu lieu depuis un an et demi, doit être l’occasion de rappeler que la planification écologique, et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, est « une opportunité, sinon une nécessité pour protéger la France des crises extérieures », indiquait la note du secrétariat général à la planification écologique. Un choix stratégique et de souveraineté énergétique dans le chaos géopolitique entraîné par l’arrivée au pouvoir de Donald Trump et la guerre en Ukraine.
Ce rendez-vous permettra de « regarder quelles mesures nous pouvons prendre pour aller plus vite », indique Agnès Pannier-Runacher. Face à la fronde qui monte contre d’autres aspects de la transition, comme les zones à faibles émissions (ZFE), elle l’assure : il ne s’agit « pas que de mesures d’interdiction », mais aussi de développer « des transports en commun plus confortables », et de trouver des pistes pour « aider à rénover le bâtiment ». « Il ne s’agit pas que d’une question de budget », précise-t-elle encore, dans le contexte d’austérité budgétaire, mais de « faciliter des dispositifs d’aides qui sont parfois trop compliqués ».
Bientôt des « fermes HLM » pour permettre aux paysans de bien se loger ?
Nolwenn Weiler
https://basta.media/Bientot-des-fermes-HLM-pour-permettre-aux-paysans-de-bien-se-loger
Article
La pénurie de logements en milieu rural accentue les difficultés d’installation des agriculteur·ices et entame la durabilité des fermes. L’habitat social pourrait être une solution. Reportage à Notre-Dame-des-Landes.
Le mois de mars commence tout juste à Notre-Dame-des-Landes, les hirondelles arrivent déjà de leur migration hivernale.
À l’extrême est de l’ancienne Zad de Loire-Atlantique, Anne-Claire et Gibier sont occupé·es à planter des petits pois. Leur exploitation maraîchère, installée depuis 2016 à proximité du lieu collectif de la Noé verte, fait partie de la quinzaine de fermes qui ont vu le jour dans le sillage de la lutte contre l’aéroport.
« La question des terres a été peu à peu réglée depuis 2018, expliquent-iels. Des conventions d’occupation précaire ont été signées avec le conseil général [propriétaire des terres, ndlr], et se sont ensuite transformées en baux ruraux environnementaux. » Les baux ruraux environnementaux permettent aux agriculteurs de payer des loyers modestes en échanges de pratiques agricoles qui préservent l’eau et la terre. Sur l’ancienne Zad, tout le monde est installé en agriculture biologique. Et plus de 500 hectares sont aujourd’hui protégés via ces baux. Les bâtiments agricoles, historiques ou construits au fil de la lutte devraient bientôt être intégrés aux baux ruraux. Reste donc la question du logement, cruciale pour stabiliser les installations, et sur laquelle se penchent cinq des fermes de l’ancienne Zad.
Sans logement, des installations difficiles
« Je suis arrivé en 2014 dans le contexte de la lutte contre l’aéroport », explique Greg, qui a peu à peu constitué un troupeau de vaches allaitantes « nantaises », une race locale, à Bellevue, haut lieu de la lutte contre l’aéroport. « Ces dernières années, le gros de mon engagement, ça a été de recréer une ferme fonctionnelle. Mais je suis à peu près sûr que sans logement, personne ne va jamais la reprendre. » Pour le moment, il vit dans une petite maison de terre qu’il a agrandie avec un mobil-home.
Sa collègue Amalia partage cette inquiétude à propos de la transmissibilité de sa ferme qui abrite des ovins allaitants et des ruches. « Je me suis installée peu après les expulsions de 2018 et suis aujourd’hui associée avec mon conjoint. Nous vivons dans un habitat léger, à proximité de la ferme. Cela fonctionne tant que nos enfants sont petits, mais quand ils vont grandir ce sera plus compliqué… Et rien ne dit que des repreneur·ses seraient d’accord pour vivre ainsi. » Corentin, qui vit dans un vaste camion qu’il a aménagé en studio, se pose les mêmes questions. Arrivé en 2015 sur la zone, il a des ovins et de grandes cultures, dont du sarrasin transformé sur place en galettes.
Anne-Claire et Gibier habitent de leur côté dans un logement social situé à plusieurs kilomètres de leurs cultures. Les deux évoquent les difficultés d’organisation que cette distance leur impose, en particulier quand la saison estivale bat son plein.
Les incertitudes météorologiques dues au changement climatique augmentent largement ces difficultés, car il faut parfois arroser la nuit ou venir précipitamment protéger les cultures de la grêle.
Bref, habiter sur place, ou pas trop loin apparaît nécessaire… mais compliqué, voire impossible. « À l’échelle de nos petites fermes, la capacité à investir dans des logements est très faible », expliquent Anne-Claire et Gibier. « La moindre baraque dans le coin coûte plus de 400 000 euros. On n’a pas de quoi se payer ça », appuie Amalia. « Il faut sortir l’habitat paysan du marché sinon nos fermes seront intransmissibles », estime Corentin. La situation est particulièrement tendue dans les territoires qui se situent près des grandes villes, comme Notre-Dame-des-Landes, proche de Nantes, qui ont pourtant un besoin crucial de paysan·nes pour les nourrir…
Mobilisation paysanne pour le logement
Fidèles à leurs habitudes collectives, les paysan·nes de l’ancienne Zad ont décidé de se mobiliser ensemble pour défendre la construction de logements sociaux. Les communes, le conseil général et le bailleur social départemental – Habitat 44 – se sont peu à peu associés à leur réflexion. « Si on regarde les fiches d’impôts des paysans, on voit qu’ils sont nombreux à avoir droit à des logements sociaux, remarque Kathleen Boquet, de l’association Renouveau paysan, qui s’intéresse à la pénurie d’habitats agricoles. Pourtant, les bailleurs sociaux s’investissent rarement en zones rurales. Et quasiment jamais pour des paysan·nes »
Ce problème du logement paysan est soulevé depuis dix ans par les associations de terrain comme Relier, le réseau Civam ou Terre de liens. Il inquiète désormais la Cour des comptes et le Conseil économique, social et environnemental (Cese), dans un contexte d’urgence absolue de renouvellement des générations agricoles : d’ici dix ans, 43 % des agriculteur·ices partiront à la retraite.
Question négligée
La question de l’habitat reste pourtant un angle mort des projets d’installation agricole. « C’est déjà tellement compliqué de trouver du foncier abordable, disponible, au bon endroit et au bon moment que ce point du logement est souvent minimisé par les candidat·es à l’installation », remarque Alessandra Miglio, qui commence une thèse sur les enjeux actuels du logement agricole.
À cette question du foncier, s’ajoutent les efforts à fournir pour trouver les investissements nécessaires au lancement de l’activité. « Les gens se disent “on verra plus tard, on va s’arranger entre temps, vivre en caravane sur place”, par exemple », constate la chercheuse. « La difficulté à se loger est un frein à l’installation qui est peu conscientisé, précise Kathleen Boquet. Cela peut pourtant entraîner une fragilisation des projets sur le long terme, avec des risques de burn-out. » L’absence de solutions de logement accélère finalement le rythme de disparition des fermes, déjà très inquiétant : environ 200 fermes sont gommées du paysage rural français chaque semaine.
« Quand une ferme est candidate à la transmission, on a souvent une dissociation entre les terres et la maison d’habitation, décrit Alessandra Miglio. Ce n’est pas toujours facile pour les cédant·es de quitter un domicile où iels ont passé toute leur vie, et les conditions de retraite très précaires des agriculteur·ices rendent leur relogement hors de la ferme particulièrement compliqué. » Il peut être tentant, voire simplement nécessaire, de vendre sa maison à des non-agriculteur·ices, au prix du marché immobilier périurbain ou de la résidence secondaire.
Avantages de l’habitat social
Celles et ceux qui reprennent la ferme se retrouvent alors sans solution de logement sur place. Iels peuvent avoir un projet de nouvelle construction sur une partie des terres agricoles, mais c’est de plus en plus compliqué d’obtenir des autorisations, car les mairies se battent contre la dispersion de l’habitat rural et contre l’artificialisation du sol agricole… « Les impératifs de sobriété foncière peuvent ainsi entrer en contradiction avec les besoins de logement des agriculteur·ices et, par conséquent, avec la nécessité de maintenir le nombre de fermes sur nos territoires », analyse Alessandra Miglio.
Restent alors les habitats légers. Souvent précaires, et parfois trop petits, ces habitats ne sont pas toujours bien vus, quand ils ne sont pas carrément combattus par les voisin·es et communes. « C’est une possibilité qu’il faut défendre, commente Kathleen Boquet. Nous travaillons d’ailleurs sur l’acceptation de ces habitats légers. Mais cela ne peut pas être la seule solution. On sait que pour des vies de famille par exemple, les tiny houses sont trop exiguës. Elles ne permettent pas non plus d’héberger les gens de passages, proches ou venant travailler sur les fermes. L’enjeu, vital, de résilience alimentaire des territoires ne peut pas reposer sur des héros et héroïnes qui accepteraient de vivre dans des habitats inconfortables ou indécents. »
Pour Amalia, les logements sociaux offrent plusieurs avantages : « Les loyers correspondent à nos revenus, on pourrait les assumer. Et les transmissions seraient plus faciles : les repreneur·ses n’auraient pas besoin de débourser 100 000 euros juste pour la maison. » Sur l’ancienne Zad de Notre-Dame-des-Landes, la construction de nouveaux logements à destination des paysan·nes permettrait de conserver les anciennes maisons comme lieux d’organisation et d’activités collectives.
« On a besoin de conserver ces lieux pour accueillir les personnes capables de nous remplacer ou les saisonnier·es », décrit Corentin. C’est aussi dans ces lieux collectifs que se montent des structures telles qu’Abrakadabois, au sein de laquelle travaillent notamment des charpentier·ères, aux connaissances précieuses pour les agriculteur·ices. Même chose pour les forgeron·nes, par exemple. « Je suis content d’avoir ces personnes à proximité, et ne pas être obligé d’aller dans une zone artisanale à 20 kilomètres quand j’ai des travaux à faire sur la ferme », explique Corentin.
« Les bailleurs sociaux sont mieux placés que les acteurs agricoles pour réhabiliter des fermes et les louer, intervient Kathleen Boquet. Ils ont des compétences sur ces sujets et des capacités financières, avec des accès aux crédits facilités. Cela permet en plus d’avoir un tiers neutre entre les communes et les agriculteur·ices. » Pour passer du rêve à la réalité, il faut rebattre une partie des cartes du logement social, très encadré.
Logement de fonction ou contrat d’occupation
Le premier projet de Renouveau paysan, dans le Pays basque, s’était ainsi heurté au principe du « droit au maintien », qui protège les locataires des expulsions dans les logements sociaux. Ce droit peut entrer en contradiction avec le fait que, dans le cas d’un logement social paysan, l’exploitant·e puisse être obligé·e de quitter son habitat social si iel décide d’arrêter son activité agricole. Divers montages juridiques ont donc été imaginés pour abriter les paysan·nes dans des logements sociaux sans détricoter le droit au maintien, si important par ailleurs. Un nouveau projet de logements sociaux paysans pourrait voir le jour prochainement en Gironde.
Impulsés par Kathleen Boquet et sa collègue Linda Rieu ces travaux de réflexion incluent des collectivités, chercheur·euses et bailleurs sociaux. Pour le moment, un « contrat d’occupation » accolé au bail semble la piste la plus prometteuse. Mais les réflexions se poursuivent.
Ailleurs en France, d’autres initiatives ont vu le jour : sur le territoire de Nantes métropole, la Ferme du bois olive a été sauvée par un savant montage associant la collectivité, Terre de liens et un bailleur social. À Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), qui salarie des agriculteurs, on parle de logements de fonction.
Sur le même sujet
De la nourriture prise en charge à 100 % : un village expérimente une sécurité sociale alimentaire
Et sur le plateau de Saclay (Essonne), l’association Terres et cités évoque un quota de logements sociaux réservés aux travailleurs et travailleuses de la terre, paysan·nes ou saisonnier·es. « Ce qui est décisif, essentiel dans ces formes d’habitat agricole émergentes, souligne Alessandra Miglio, c’est que les agriculteur·ices ne se retrouvent plus en concurrence avec les urbain·es ou les vacancier·es pour l’accès au logement, comme c’est le cas actuellement dans le marché immobilier. »
Ekologismoaren kontrako oldarraldia AEBetan: Greenpeace 660 milioi euro ordaintzera zigortua
Urko Apaolaza Avila
www.argia.eus/albistea/ekologismoaren-kontrako-oldarraldia-aebetan-greenpeace-660-milioi-euro-ordaintzera-zigortua?mtm_campaign=HariaBuletina
Article
Dakota Access oliobidearen kontrako protestengatik zigortu du Ipar Dakotako epaimahai batek erakunde ekologista, Energy Transfer Partners enpresak salaketa jarri ostean. Standing Rockeko sioux tribuak protesten erantzukizuna bere gain hartu du.
Greenpeacek 660 milioi euro ordaindu beharko dizkio Energy Transfer Partners petrolio konpainiari, Dakota Access oliobidearen kontrako protestetan « jokabide kriminala » izateagatik eta « difamazioagatik ». Standing Rockeko sioux tribua bete-betean kaltetzen zuen azpiegitura horrek, eta milaka lagunek manifestazioak eta ekintzak egin zituzten, batez ere 2016. eta 2017. urteen artean. Geroztik, enpresak auzitara jo du Greenpeacen kontra eta, orain, epaimahai batek zigor milioiduna jarri dio erakunde ekologistari.
Greenpeacek AEBetan duen egitura arriskuan jarri du epaiak, baina hortik harago, Gobernuz Kanpoko Erakundeek zein adierazpen askatasunean aditu direnek kezka handiz ikusi dute auzia, protesta sozialetan eta aktibismoan izan dezakeen eraginagatik.
Slapp bezala ezagutzen den bidea erabili dute Greenpeacen kriminalizazioa aurrera eramateko, « Parte Hartze Publikorako Salaketa Estrategikoa » esan nahi dute sigla horiek ingelesez, eta multinazionalek gero eta gehiagotan erabiltzen dute ekintzaileen, kazetarien edo sindikalisten kontra. Azken batean, helburua ez da epaiketa justu bat izatea baizik eta salatua beldurtzea eta ahultzea.
Energy Transferrek helburu bezala du « protesta baketsurako eskubidea deuseztatzea », salatu du Greenpeacek, The Guardian egunkariak jaso duenez. Hain justu, petrolio konpainia horrek diru-ekarpen oso handiak egin dizkio Donald Trumpi AEBetako presidentetza lortzeko.
Ipar Dakotako Mandan herriko kideek osaturiko epaimahai batek epaitu du auzia, eta hasieratik bere inpartzialtasuna zalantzan jarri dute, herri horretako komunitateak eskuineko joera kontserbatzaileak dituela eta oliobidearen alde dagoela egotzita. Egunkari britainiarraren arabera, epaimahaierako aukeraturiko herritarren erdiak baina gehiagok loturak ditu erregaien negozioarekin.
Sioux herriak erantzukizuna bere gain
Enpresa saiatu da Greenpeace oliobidearen kontra izandako sabotaje ekintzekin lotzen. Baina Standing Rockeko sioux tribuak komunikatu baten bidez bere gain hartu du protesten gidaritza. Saltatu dute Energy Transferrek Standing Rockeko komunitatea babesten duen ahots oro « isilarazi » nahi izan duela epaiketa horrekin.
Greenpeacek ohar bidez jakinarazi du epaiari helegitea jarriko diola eta « garaipena lortu arte borrokatuko » duela.
Fracking-a eta BBVA
2008a frackingaren eztanda urtea izan zen AEBetan, herrialdea munduko petrolio ekoizlerik handiena bihurtu zen, eta industriak metodo errazagoa behar zuen produktua petrolio-findegietara eta munduko merkatuetara eramateko. Horrela, 2014ean DAPL oliobidearen proiektua proposatu zuen, petrolio gordina Ipar Dakotatik Illinoiseraino eta gero golkoko kostalderaino eramango zuena. Gaur egun, lurpeko 1.900 kilometroko oliobide horrek 750.000 petrolio upel petrolio garraiatzen ditu egunero.
2017an Rafael Gonzales oliobidearen aurkako ekintzailea elkarrizketatu zuen ARGIAk, Europan egin zuen bira baliatuta. Besteak beste, salatu zuen BBVA bankua zela azpiegitura bultzatzen ari zen ankuetako bat: »BBVAk 120 milioi dolar inbertitu ditu Standing Rockeko proiektuan. Hori da gu orain hemen egotearen arrazoietako bat. Salatu nahi dugu BBVA eta Credit Suisse banku europarrak milaka milioi dolar inbertitzen ari direla Dakota Access proiektuan. Europako banku horiek kolonizazioari eta herri indigenen zapalkuntzari jarraipena ematen diote. Nekatuta gaude eta ez dugu gehiago jasango, borrokan eta haiek lotsarazten jarraituko dugu ».