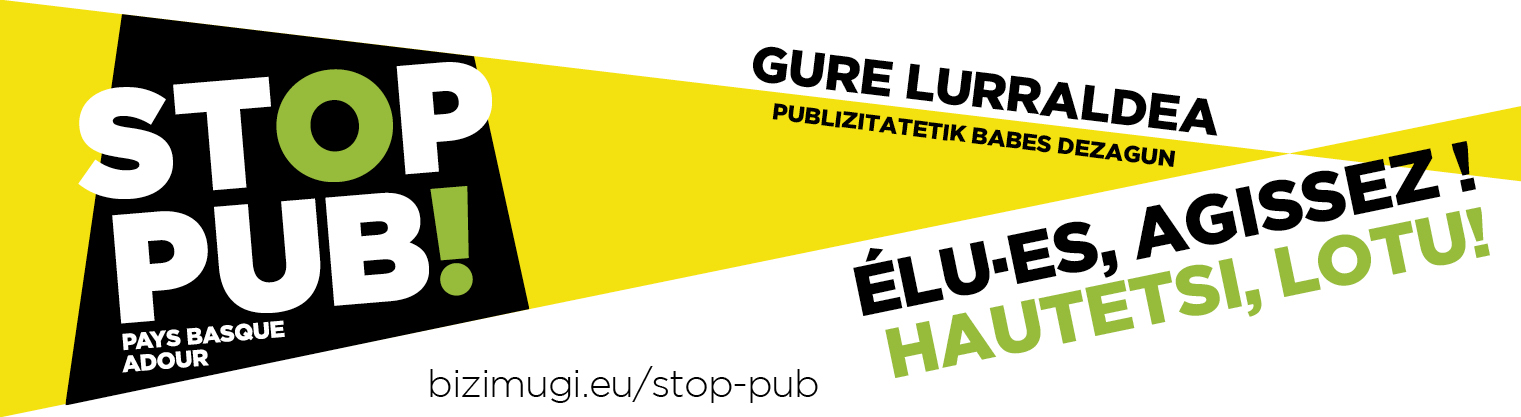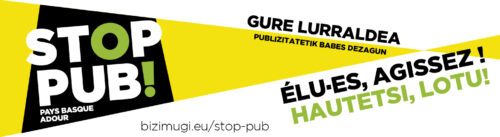Donald Trump s’attaque à la science du climat et sème l’effroi parmi les chercheurs
Raphaëlle Besse Desmoulières et Audrey Garric
www.lemonde.fr/planete/article/2025/02/17/donald-trump-lance-une-attaque-contre-la-science-du-climat-et-de-l-environnement-qui-seme-l-effroi-parmi-les-chercheurs_6550211_3244.html
Article
Références au changement climatique supprimées, censure d’informations sur l’état de l’environnement, menaces sur des agences reconnues au niveau mondial… L’administration Trump mène une offensive sans précédent.
« Erreur 404 ». Voici ce que l’internaute découvre quand il arrive sur la page consacrée au changement climatique de la Maison Blanche, aux Etats-Unis. Il n’a pas plus de chance quand il clique sur les portails et sections liés à cette thématique sur les sites du département d’Etat, de la défense, des transports ou de l’agriculture. Ils sont évaporés. Sur le site de l’Agence de protection de l’environnement (EPA), la partie sur le changement climatique n’est plus accessible sur la page d’accueil, ni dans les onglets sur les « sujets environnementaux ».
Ces exemples sont loin d’être isolés. Subventions gelées, rapport sur la nature censuré, coupes budgétaires… En moins d’un mois, Donald Trump a frappé vite et fort. Le 47e président des Etats-Unis, un climatosceptique qui met régulièrement en doute la réalité et la gravité du réchauffement, a multiplié les fronts et fait pleuvoir les attaques contre la science du climat et de l’environnement, lui déclarant une « guerre », selon le terme de l’historien des sciences américain Robert Proctor.
« Nous entrons dans un âge d’or de l’ignorance », prévient le professeur à l’université Stanford (Californie), tandis que la climatologue Valérie Masson-Delmotte, ex-coprésidente du groupe 1 du GIEC, y voit de l’« obscurantisme ». « Pour cette administration, les faits scientifiques sont dangereux, il faut les faire taire », observe-t-elle. Et de peser ses mots : « C’est l’héritage des Lumières qui est menacé. C’est sans précédent dans un pays démocratique, en dehors de périodes fascistes. »
La National Science Foundation (NSF), une agence fédérale indépendante et l’un des principaux bailleurs de fonds de la recherche universitaire académique, s’est retrouvée en première ligne quand le gouvernement a décidé de suspendre toutes les subventions fédérales. Après avoir annoncé leur mise en pause, la NSF a finalement rouvert le site Web qui distribue l’argent aux scientifiques à la suite d’une décision de justice. Mais, depuis, son personnel passe en revue tous les projets de recherche pour vérifier que ces derniers sont conformes à différents décrets présidentiels, notamment celui qui met fin aux politiques de diversité, équité et inclusion et de justice environnementale dans l’administration.
« Les gens sont terrorisés »
C’est par mail que, le 27 janvier, Gabriel Filippelli, professeur des sciences de la Terre à l’université de l’Indiana, a appris l’interruption du financement pour ses travaux visant à aider un pays d’Asie du Sud à améliorer la qualité de son air, accordé par le département d’Etat. Le chercheur a cependant bon espoir de voir la suspension levée s’il enlève les références à la diversité de son projet. « J’aurais envisagé d’y renoncer si les composantes de la diversité avaient été significatives, mais elles faisaient à peine partie du programme au départ », explique-t-il.
Symbole de cette offensive tous azimuts, le National Nature Assessment, la première évaluation systématique sur l’état des terres, de l’eau et de la biodiversité, a vu sa production stoppée par l’administration Trump. Ses 180 auteurs étaient sur le point d’achever une première version, après des milliers d’heures de travail. Faute d’explication officielle, Howard Frumkin, l’un d’entre eux, en est réduit à des conjectures.
« C’est peut-être parce que nous abordons la question de l’équité sociale et montrons que certains groupes, comme les personnes pauvres ou âgées, ont moins d’accès à la nature que les privilégiés », suppute ce professeur émérite à l’université de Washington.
L’Agence de protection de l’environnement fait, elle aussi, les frais de cette purge. Son nouveau patron, Lee Zeldin, a clairement énoncé sa volonté de rationaliser cette structure dont le rôle est central. Dernière annonce en date, jeudi 13 février : il entend annuler 20 milliards de dollars (soit un peu plus de 19 milliards d’euros) de subventions accordées sous l’administration Biden pour des projets liés au climat. En attendant, 171 employés de l’EPA, travaillant pour des programmes de diversité ou de justice environnementale, ont été placés en congé administratif – avant un probable licenciement – et 388 travailleurs arrivés il y a moins de deux ans ont vu leur contrat s’arrêter. « Je n’ai jamais vu ça à l’EPA en plus de trente ans de carrière, s’indigne Nicole Cantello, présidente de l’AFGE dans le Midwest, un syndicat qui représente le personnel de l’EPA. Les gens sont terrorisés. »
« Trump avance bien plus vite » qu’en 2017
D’autres organisations fédérales comme l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA), qui a déjà reçu la visite du Department of Government Efficiency (« département de l’efficacité gouvernementale ») d’Elon Musk, pourraient subir le même sort. Le Project 2025, ce vade-mecum d’inspiration ultraconservatrice qui a servi de feuille de route à la campagne de Donald Trump, appelait à « démanteler » cette agence et à privatiser certaines de ses branches, comme le National Weather Service, la météo nationale.
Un ancien haut gradé de la NOAA sous l’administration Biden se dit « très inquiet » face à « des attaques qui pourraient nuire à la vie des Américains, au commerce et à l’industrie ». Lui aussi décrit un « climat de peur » au sein de la NOAA, alors que certains agents, selon plusieurs médias outre-Atlantique, ont été sommés, début février, de cesser tout contact avec les ressortissants étrangers.
Pour tous les observateurs, la casse est pire qu’en 2017, lors du premier mandat du républicain. « Donald Trump avance bien plus vite, il avait tout préparé et a placé des alliés partout, dans les agences fédérales mais aussi dans les tribunaux, ce qui lui permettra de contrer les procès », estime Robert Proctor, alors que des premiers recours en justice ont été déposés. « L’administration Trump teste les limites de son pouvoir, considère Lourdes Vera, sociologue à l’université de Buffalo (New York). Sachant que la Cour suprême est fortement conservatrice et que la Chambre des représentants est également majoritairement républicaine, je pense qu’ils pourront aller beaucoup plus loin qu’en 2017. »
Le but de ces attaques est de « favoriser l’industrie des énergies fossiles », qui a financé la campagne du président, rappelle Rachel Cleetus, de l’ONG Union of Concerned Scientists. Dès le premier jour de son mandat, Donald Trump a entrepris de revenir sur la transition écologique lancée par son prédécesseur, Joe Biden, et a engagé, pour la deuxième fois, la sortie de son pays de l’accord de Paris sur le climat.
La résistance s’organise
L’impact de cette campagne antisciences de l’environnement s’annonce majeur. « Cela décimera la science aux Etats-Unis et nuira au progrès scientifique au niveau mondial » en raison du leadership américain en la matière, prévient le climatologue Michael Mann (université d’Etat de Pennsylvanie), qui se dit « horrifié ». Si l’administration Trump réoriente la NASA vers Mars et affaiblit la NOAA, deux agences de renommée mondiale, les « implications seront dramatiques » pour le suivi international du climat et de la météo, met en garde Valérie Masson-Delmotte. De quoi amoindrir la compréhension du public mais aussi « menacer sa santé et sa sécurité », ajoute Rachel Cleetus, en supprimant des informations factuelles sur les catastrophes.
La résistance des scientifiques s’organise – timidement à ce stade. Une marche pour la science est prévue à travers le pays le 7 mars.
L’Environmental Data & Governance Initiative (EDGI), un groupe de chercheurs qui documente les modifications apportées en ligne aux données fédérales sur l’environnement, indique avoir archivé 37 bases de données sur 57 identifiées comme prioritaires et recréer des programmes informatiques, également supprimés, qui permettaient d’analyser ces data. « Cette sauvegarde est essentielle car la démocratie exige un engagement civique significatif, qui dépend de la disponibilité et de l’accessibilité de l’information », juge Lourdes Vera, membre de l’EDGI.
Quant aux auteurs du National Nature Assessment, ils ont unanimement décidé de le publier en tant que document non gouvernemental. « De nombreux éditeurs de revues et de livres nous ont proposé de l’héberger. On pourra produire un rapport sans restrictions et donc avec plus d’impact », avance Howard Frumkin. Une manière de garder de l’espoir.
Pour une nouvelle stratégie du choc
Gaby Arestegui
www.enbata.info/articles/pour-une-nouvelle-strategie-du-choc
Article
Les récentes catastrophes à Valence, Mayotte et Los Angeles révèlent la vulnérabilité de notre monde face à la crise climatique. Plutôt que de sombrer dans l’inaction, ces crises peuvent devenir des opportunités pour une bifurcation écologique, à condition de raviver des récits d’un avenir désirable.
Inondations à Valence, cyclone à Mayotte, incendies à Los Angeles : autant de signes de la vulnérabilité d’un monde qui peine à anticiper ses crises et à se réinventer. Alors que l’inaction climatique dessine peu à peu notre trajectoire vers le scénario catastrophe d’un réchauffement de +4°C à la fin du siècle, il ne s’agit plus de savoir si les territoires seront affectés, mais plutôt quand et avec quelle ampleur. Ce constat pousse à nous demander pourquoi ces crises sont des accélérateurs de la crise climatique et comment on peut en faire des moments de bifurcation vers un nouveau modèle. Selon Hannah Arendt, aguerrie aux périodes de bouleversement social, une crise devient catastrophe lorsqu’elle est abordée par des idées toutes faites, étouffant toute réflexion nouvelle.
L’inaction, le choix des catastrophes
La vérité, c’est que dans notre société occidentale, une très grande majorité d’entre nous n’est pas prête, aujourd’hui, à sacrifier individuellement son confort pour réduire drastiquement son empreinte carbone. Même ceux qui s’efforcent sincèrement d’agir font face à des limites : peut-on vraiment vivre sans avion, sans voiture, à quatre dans 50 m², en se nourrissant de produits locaux de saison bio, sans café ni chocolat, tout en limitant Internet, les appareils numériques et ménagers ? Pourtant, nous n’avons jamais décidé collectivement que, tant pis, nous ferions face aux conséquences de la crise environnementale. C’est un choix par défaut, inscrit dans des habitudes collectives et des structures que nous n’avons pas encore eu la force de transformer.
Les responsables politiques doivent simultanément mener des politiques de décarbonation et anticiper les catastrophes. Pourtant, alors qu’agir en amont pour ralentir le réchauffement climatique devrait être une priorité au coeur des débats, les discours antiécologiques décomplexés, abusant des fake news, prennent de l’ampleur. Dans le même temps, au lendemain des crises, la pression populaire pour une meilleure gestion de ces crises devient de plus en plus forte, à l’image des protestations massives à Valence, où la réponse insuffisante du gouvernement face aux inondations a enflammé les rues.
Business as usual
Les incendies en Californie ont révélé ce à quoi il fallait s’attendre dans une société inégalitaire et profondément individualiste et libérale, avec l’exemple caricatural que peut être Los Angeles. Face à l’ampleur des feux et des secours débordés, certains ultra-riches ont fait appel à des pompiers privés pour protéger leurs villas des flammes. Et comme dans toute crise, cela a aussi été l’occasion d’observer des comportements opportunistes.
Les prix du logement ont flambé dans une région où ils sont déjà élevés, devant la demande accrue de relogement de ces déplacés climatiques.
À l’inverse, un véritable système de résilience collective et solidaire devrait reposer sur des services et infrastructures publiques solides. Mais il est vrai que les politiques d’austérité les mettent à mal et fragilisent notre capacité à faire face collectivement aux crises. Pour ce qui est des hôpitaux par exemple, pourra-t-on encore compter sur les services publics pour répondre à une nouvelle crise majeure, ou faudra-t-il y payer cash pour espérer être soigné ? Comment réagiront les structures de santé en Iparralde, déjà surchargées ? Grâce à nos écosystèmes locaux, un réseau de solidarité pourrait efficacement prendre le relais des services débordés. Cette légitimité collective permettrait de contester toute reconstruction rapide qui ne correspondrait pas à nos aspirations et la nécessité de changement.
Stratégie du choc 2.0
La biologiste Raïma Fadul déplorait ainsi que le plan « Mayotte debout » ignore la destruction de la biodiversité par le cyclone et fasse l’impasse sur des mesures ambitieuses, comme le reboisement, pourtant crucial pour préparer le territoire aux bouleversements climatiques à venir. Si demain sur la Côte Basque par exemple, des zones gravement sinistrées étaient à reconstruire, on pourrait en profiter pour en redéfinir la destination, quitte à revenir en arrière en termes d’urbanisme. Dans sa célèbre thèse de « la stratégie du choc » , Naomi Klein affirme que les crises sont souvent utilisées pour renforcer des politiques néolibérales, au détriment du bien-être collectif. Une dynamique qu’il nous est possible d’inverser, en transformant ces crises répétées en leviers pour initier une bifurcation écologique. Et si… on ravivait ces récits de changement et de solidarité, forgés pendant la crise du COVID ?
« La Sécurité sociale alimentaire permettrait un changement total de la société »
Hervé Kempf
https://reporterre.net/La-Securite-sociale-alimentaire-permettrait-un-changement-total-de-la-societe
Article
Le député écologiste Boris Tavernier promeut une loi sur la Sécurité sociale de l’alimentation. Dans ce Grand entretien, il décrit le projet comme « le plus enthousiasmant depuis des décennies ». Le texte sera étudié jeudi 20 février à l’Assemblée.
Boris Tavernier est député écologiste du Rhône depuis juillet 2024. Il est aussi le cofondateur du réseau Vrac (Vers un réseau d’achat en commun) et porte une proposition de loi sur la Sécurité sociale de l’alimentation (SSA), déposée par le député Charles Fournier et qui sera discutée à l’Assemblée nationale jeudi 20 février.
Reporterre — La Sécurité sociale de l’alimentation que vous proposez est-elle une sorte d’extension de l’association Vrac, que vous avez cofondée en 2013 et qui lutte contre la précarité alimentaire ?
Boris Tavernier — Vrac est une réponse à l’urgence autour de l’alimentation aujourd’hui, mais ce n’est pas cela qui va complètement changer le système. Le projet de SSA, qui est porté depuis six ans par des chercheurs, des syndicats agricoles, mais aussi des acteurs locaux, est pour moi le plus enthousiasmant depuis des décennies. Il permettrait un changement total de la société, tout en touchant à la notion importante de plaisir.
La SSA repose sur trois piliers. Le premier est d’ajouter une branche à la Sécurité sociale, en imaginant par exemple que, sur sa carte Vitale, chacun ait chaque mois 150 euros pour se nourrir. Cela permettrait que l’alimentation ne soit plus la variable d’ajustement dans un budget. La notion de cotisation est le deuxième pilier : tout le monde cotise selon ses moyens pour recevoir ces 150 euros.
Enfin, et c’est l’aspect le plus passionnant de ce projet, la SSA prévoit un conventionnement démocratique : chaque territoire choisit collectivement dans quelles structures et dans quelle agriculture utiliser cet argent et, a fortiori vers quelle alimentation se tourner.
Depuis plusieurs années, il existe une trentaine d’expérimentations de la SSA en France et force est de constater que cela fonctionne. Elles ont souvent un point commun : la création d’une assemblée citoyenne de l’alimentation, comme à Montpellier. Cela fait bientôt deux ans qu’ils mènent l’expérience et cela a changé la vie des mangeurs et des paysans, tout en permettant que l’argent dépensé reste sur le territoire. Par ailleurs, la Sécurité sociale de l’alimentation permet, sur le moyen et long terme, de réduire nos dépenses de santé et d’éviter nombre de coûts liés à notre mauvaise alimentation.
Voilà pourquoi, avec le groupe écologiste et social, nous portons une loi d’expérimentation qui sera dans notre niche parlementaire du 20 février. Nous demandons 15 millions d’euros pour expérimenter pendant cinq ans ce projet sur une vingtaine de territoires. Cela s’annonce compliqué : nous évoluons dans une Assemblée — le Rassemblement national en tête — qui veut faire disparaître le milieu associatif et l’économie sociale et solidaire, qui veut faire disparaître tous ces « assistés ».
Mais, malgré ce sombre tableau, j’y crois : nous avons la chance d’avoir des milliers de projets et de personnes hyper créatives qui se bagarrent partout en France pour réinventer notre système. Il faut que l’on se soutienne : en s’impliquant dans ce genre de projets, on peut réussir à changer des choses.
Qu’est-ce que l’association Vrac, dont vous êtes cofondateur ?
Tout est parti du constat qu’il est difficile de bien se nourrir quand on n’en a pas les moyens ou lorsque l’offre est inexistante sur son territoire — je suis fils d’ouvrier et viens du Pas-de-Calais, où la diversité alimentaire était limitée. Au début des années 2000, j’ai monté avec deux amis un bar-café-concert à Lyon, où tous les produits étaient bio et en circuit court. Nous avions aussi monté la première Amap lyonnaise.
Vrac, créée à Lyon en 2013, s’inscrit dans la continuité de ces projets et est née d’une rencontre avec des bailleurs sociaux qui, comme nous, se demandaient comment améliorer la vie des gens. Le but de l’asso est de soutenir l’agriculture paysanne et biologique tout en rendant cette bonne alimentation accessible aux habitants des quartiers populaires. Il s’agit de groupements d’achats, d’épiceries éphémères, que l’on crée chaque mois avec les habitants d’un quartier.
Aujourd’hui, nous sommes implantés dans une centaine de quartiers, avec des milliers de personnes qui viennent. C’est un cercle vertueux, mais qui reste pour l’heure à l’état d’alternative, la volonté politique n’étant pas là pour que cela devienne une norme.
Pourquoi vous êtes-vous à l’époque centré sur l’alimentation ?
Parce que c’est le sujet central pour toucher les gens : ça crée du lien social, ça donne du plaisir… et ça touche à l’enjeu de la biodiversité et à l’agriculture. Pour lancer Vrac, je suis parti pendant trois mois vivre dans les quartiers pour construire ce projet avec les habitants. Et, contrairement à tous les préjugés les visant, est ressorti le fait qu’ils avaient envie de bien se nourrir et de bien nourrir leurs enfants.
L’objectif était de convaincre par le goût : j’organisais des dégustations d’huile d’olive, de fromage de chèvre… au pied des immeubles, avec tout un réseau de paysans avec qui je travaillais depuis longtemps. Les habitants venaient goûter, ce qui a cassé cette première barrière du goût. Ensuite, on parlait de prix, et nous avions choisi à l’époque de revendre au prix d’achat, qui était celui du juste prix paysan.
Aujourd’hui, Vrac regroupe vingt-trois associations en France et en Belgique et propose environ 150 références de produits bio. Nous sommes habilités à l’aide alimentaire, sans être liés à l’industrie agroalimentaire : nous ne récupérons pas d’invendus, mais achetons des produits.
Et désormais, via notamment des financements du ministère des Solidarités, nous pouvons proposer aux habitants des prix plus bas que ceux d’achat.
Karine Jacquemart, directrice de l’ONG Foodwatch, explique que les associations d’aide alimentaire reçoivent des aliments de la grande distribution qui ont dépassé la date de péremption et doivent pour une bonne partie être jetés. Pire : les distributeurs touchent une déduction fiscale pour cela…
Pour mon livre Ensemble pour mieux se nourrir [Actes Sud, 2021], j’ai visité une banque alimentaire : on y trouvait nombre de produits ultratransformés, ou encore des calendriers de l’Avent, alors que l’on était au mois d’avril ! Il faut savoir que les banques alimentaires ne peuvent pas refuser ce que leur donne une grande surface, sinon elles ne reçoivent plus rien, et que les associations ne peuvent pas refuser ce que leur donne la banque alimentaire. Treize mille tonnes de produits ont ainsi été jetés l’année dernière.
Il y a donc beaucoup de gaspillage, mais ces produits sont défiscalisés et la grande surface gagne de l’argent. Les plus pauvres d’entre nous sont les poubelles, les méthaniseurs de notre société. Au fond, il existe un business du pauvre. Il est urgent de changer ce modèle : la question de la qualité des produits et de la dignité des personnes est très importante. Un rapport de l’Igas [Inspection générale des affaires sociales] publié en 2019 fustigeait d’ailleurs l’aide alimentaire telle qu’elle fonctionne aujourd’hui.
Cela dit, il ne s’agit pas d’attaquer les milliers de bénévoles qui, partout en France, préféreraient donner de meilleurs produits. Voilà pourquoi il vaut mieux arrêter de financer la grande distribution et donner de l’argent directement aux structures qui vont choisir l’alimentation qu’elles proposent aux personnes en difficulté. La création en 2023 du fonds Mieux manger pour tous a ainsi été une amélioration : il permet aux associations caritatives d’acheter des produits de meilleure qualité directement auprès de producteurs locaux.
Les associations ne pourraient-elles pas s’organiser entre elles afin de refuser ce système ?
Cela pourrait bien sûr être une solution. Mais, si demain, elles arrêtent toutes leurs distributions pendant plusieurs jours, cela va générer des émeutes de la faim : 16 % de la population française saute des repas, entre 4 millions et 8 millions de personnes dépendent de l’aide alimentaire et plus de la moitié de la population se nourrit mal. Pourtant, nous sommes l’un des pays les plus riches au monde : une telle situation me rend fou.
« La Sécurité sociale de l’alimentation est une solution qui permet au plus grand nombre de se reconnecter »
En 2019, un étudiant s’est immolé devant le Crous à Lyon, vous vous rendez compte ? Même si nous avons réussi en janvier à l’Assemblée à adopter le repas à 1 euro pour tous les étudiants — à voir si ce sera validé au Sénat — on voit bien le désengagement de l’État à ce propos. Il faut le pousser à reprendre la main et j’essaie de porter cette voix-là.
Depuis la création des Restos du cœur en 1985, la situation a-t-elle empiré ?
Elle empire chaque année : on l’a encore vu avec l’inflation, qui a contraint des personnes à se tourner vers l’aide alimentaire. Sachant que 50 % des personnes qui y ont droit n’y ont pas recours, parce que ça n’existe pas sur leur territoire, parce qu’elles ont honte… Et après, certains politiques disent que les pauvres abusent de l’aide alimentaire ! Encore une fois, cela me rend fou. Ce n’est pas possible qu’il y ait autant d’inégalités, qu’il y ait autant de gens qui souffrent et ne peuvent pas se nourrir dans le pays de la gastronomie.
Comment expliquer une telle augmentation des inégalités ?
Cela est lié au fait que certaines personnes, qui sont de plus en plus riches, accaparent tout. Par ricochet, il y a de plus en plus de pauvres et la situation semble insoluble, car il n’y a pas de volonté politique. Nous devons changer ça et appliquer le Pacte international signé par la France en 1980 et qui prévoit un droit à l’alimentation. En 2023, le Conseil de l’Europe a encore poussé la France à garantir ce droit, ce qu’elle ne fait pas. Voilà pourquoi je porte une résolution transpartisane à l’Assemblée afin que ce droit soit respecté — et je ne parle pas ici de simplement nourrir les gens, la question est beaucoup plus vaste que cela.
L’industrie agroalimentaire est-elle le cœur du problème ?
Cette industrie et la grande distribution ont totalement leur part là-dedans, mais aussi l’État, qui ne fait rien pour changer les choses et culpabilise les gens en disant qu’ils mangent mal et qu’il faut « manger bouger ». Dans le même temps, les maladies cardiovasculaires explosent, le coût du diabète est de plusieurs milliards d’euros tous les ans. Nous nous dirigeons vers une crise sanitaire liée à notre alimentation.
Comment imaginez-vous le monde post-capitaliste ?
Soyons honnête : nous n’en prenons pas le chemin. J’ai eu dix ans d’expérience en entreprise, dix ans dans le milieu associatif et j’ai voulu devenir député pour voir comment je pouvais changer les choses au niveau politique, avec pour priorité absolue de réduire les inégalités. J’ai vraiment du mal à l’avouer, mais tout ce que je vis et entends depuis six mois dans cet hémicycle va à l’encontre de cet objectif. Après, bien sûr, j’ai envie de plus de solidarité, que ces alternatives autour de l’alimentation deviennent la norme, que les paysans vivent bien, que la politique agricole commune soit réorientée sur l’emploi et non plus sur l’hectare.
Bien sûr, j’aimerais que nos chefs d’entreprise cessent de se gaver en dividendes, que l’on relocalise notre économie. Bien sûr, j’aimerais que les réseaux sociaux soient moins violents, de même que notre politique. Enfin, j’aimerais surtout que le mépris de classe disparaisse au sein de l’Assemblée. Mais la SSA est déjà une solution qui permet au plus grand nombre de se reconnecter et de refaire ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble mais, moi, je privilégie le faire ensemble. Et quand on fait ensemble, tout est possible.
Eskoziako Lur Garaietan otsoa sartzea klima-larrialdirako onuragarria izango dela iradoki dute
Ana Galarraga
www.argia.eus/albistea/eskoziako-lur-garaietan-otsoa-sartzea-klima-larrialdirako-onuragarria-izango-dela-iradoki-dute
Article
Eskoziako Lur Garaietara otsoak itzularazteak basoak bere onera ekartzen lagunduko lukeela adierazi dute Leeds unibertsitateko ikertzaileek.. Horrek, era berean, klima-larrialdiari aurre egiteko balioko lukeela baieztatu dute, basoek atmosferako karbono-dioxidoa xurgatuko luketelako.
Eredu konputazionalak erabili dituzte ondorio horietara iristeko, eta ikerketa aitzindaria da, orain arteko ikerketetan baino urrutiago joan baitira: otso bakoitzak konponbide klimatikoetan zenbat diru aurrezten lagunduko zukeen kalkulatzera iritsi dira.
Azaldu dutenez, otsoa duela 250 urte desagerrarazi zuten Eskoziako Lur Garaietan. Geroztik, oreinak asko ugaritu dira, predatzaile handirik gabe geratu baitira. Zehazki, Eskozian, gaur egun, 400.000 orein daudela kalkulatu dute, eta haiek dira basoak desagertu izanaren erantzuleak, ez baitiete zuhaitz berriei hazten uzten.
140-190 otso inguru sartuz gero, orein-populazioa orekatu egingo litzateke, eta, hala, basoak sortuko lirateke berriro. Ikertzaileek kalkulatu dutenez, baso horiek milioi bat tona karbono dioxido xurgatuko lukete, hau da, Erresuma Batuak 2050erako planifikatu duen karbono-jaitsieraren % 5.
Ecological Solutions and Evidence aldizkarian argitaratu dute ikerketa, irekian. Haien esanean, gero eta argiago dago klimaren eta biodibertsitatearen krisiak ezin direla bereizita aztertu eta tratatu. Aitzitik, biak aintzat hartzen dituzten irtenbideak behar direla uste dute, eraginkorragoak eta onuragarriagoak direlakoan. Egin duten azterketan, adibide hauek eman dituzte: ekoturismoa sustatzea, oreinek eragindako trafiko-istripuak jaistea eta Lyme gaitzaren kontrola.
Hala ere, onartu dute ideiak kontrako jarrerak ere piztuko dituela. Hain zuzen, Europan eztabaida bizia dago otsoaren babes-mailaren gainean.