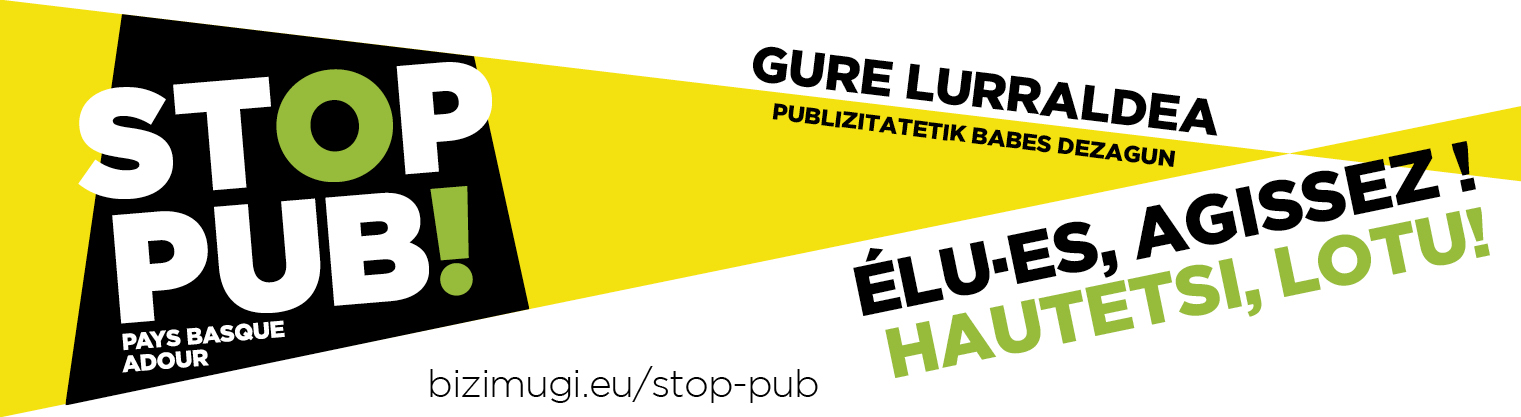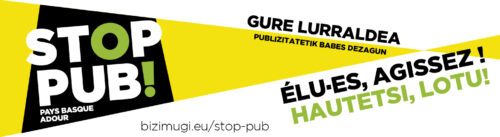Norabidea aldatu
Hodei Rodriguez Arrutia
www.berria.eus/iritzia/artikuluak/norabidea-aldatu_2144919_102.html
Article
Garraioaren sektorea da gaur egun Euskal Herrian berotegi efektuko isurketen erantzule nagusia (%35), energia gehien kontsumitzen duena (%47) eta petrolio kantitate handiena erretzen duena (%74). Gainera beste sektore batzuetan isuriak apurka-apurka murrizten diren bitartean, garraioan ia hirukoiztu egin dira 90eko hamarkadatik hona. 1987an garraioak 726 kto energia kontsumitzen zituen, 2023an, berriz, 2.133 kto. Denbora tarte berean industrian 2.450 kto-etik 1.500era pasa da.
Baina hauek ez dira kotxe pribatua oinarri duen garraio eredu honek dakartzan arazo bakarrak. Alde batetik, gorago aipaturikoari osasun publikoarentzat dituen kalteak gehitu behar dizkiogu, airearen kutsaduraren arduradun nagusietako bat izateaz gain, milaka hildako eragiten baititu istripuetan, eta bizi eredu sedentario bat sustatzen baitu, bihotzeko gaixotasunen intzidentzia handituz.
Beste aldetik, hartzen duen espazio guztia ere aipatu behar dugu. Hirien espazio publikoaren zati handi bat hartzen du (%68 Espainiako hirietan), eta bestelako erabilerak eragotzi. Imajina dezagun zelako hiriak izango genituzkeen asfaltoa kendu eta berdeguneak jarriko bagenitu. Klima aldaketari aurre egiteko hobeto prestatuta egongo ginateke, adibidez, uholdeei zein bero olatuei aurre egiteko askoz ere egokiagoak izango lirateke eta.
Landa gunean hartzen duen lurren ehunekoa dezente txikiagoa izan arren, kalte handiak eragin ditzakete hor ere, balio handiko eremu naturalak suntsituz (Bolintxu ibarra adibidez) eta faunarentzako harresi gaindiezina izanez, biodibertsitatearen galera bultzatuz.
Gainera eredu autozentriko honek gizartearen hainbat talde kanpo uzten ditu: umeak, agureak, migranteak, langile klasearen sektore pobretuenak…, ezin baitute garraio politikaren zentroan dagoen kotxea erabili. Argi dago, beraz, garraio eredu honi buelta eman behar diogula trantsizio ekologiko bat martxan jarri nahi badugu; baina gaur egungo politikak norabide okerrean doaz.
Garraio publikoaren deskontuak mantentzea albiste pozgarria bada ere, garraio publikoa urteetako inbertsio falta sufritzen dabil. Aldi berean, gainera, errepide berriak eraikitzea ere hizpide da, bertan milioiak eta milioiak xahutzeko intentzioa adieraziz, horrek kotxe pribatua are gehiago bultzatuko dutela txosten ofizialetan ere onartu arren.
Eta hori gutxi balitz bezala, hirigintza kotxean oinarrituta dago oraindik ere, eta, horrek, merkatuaren menpeko etxebizitza politikarekin batera, milaka pertsona behartzen ditu egunero kotxea hartzera.
Finean, larrialdi ekologikoari aurre egiteko politikak sustatu beharrean, automobilgintzaren eta eraikuntza enpresen interesak defendatzeko diseinaturiko politikak bultzatzen dira.
Beraz, ezinbestekoa da herritarrok martxan jar gaitezen garraio politikaren norabidea aldatzeko, interes handiak baitaude norabide okerrerantz bultzatzen.
Zeintzuk dira orduan martxan ipini behar ditugun politikak garraio sektorean trantsizio ekologikoa martxan ipintzeko? Bada, bi helburu nagusi izan behar dituzte: garraiobideetan aldaketa modala (autoaren erabiltzaileak beste garraiobide batzuetara bideratu), eta joan-etorrien kopuru eta distantziak murriztea (garraioaren desazkundea).
Hainbat dira norabide horretan har daitezkeen neurriak: hirietan auto pribatuentzako espazioa murriztea, beste garraiobideei edo berdeguneei eskainiz; garraio publikoaren maiztasunak hobetzea; garraio publikoari lehentasuna ematea…
Baina aldaketa are sakonagoak egin behar dira; izan ere, soluzioa ez da soilik autoz mugitzeko aukerak mugatzea, baizik eta egunerokoan autorik behar ez izateko bizitzak eduki ahal izatea. Horretarako, gure herri eta auzoak autorik gabeko paradigman eraiki behar ditugu.
Beraz, asko dugu borrokatzeko. Borroka gaitezen autobide proiektu berrien aurka, borroka gaitezen garraio publikoa indartzearen alde, borroka gaitezen gure hiriak pertsonentzat diseinatuta egon daitezen… Borroka gaitezen, finean, etorkizun bizigarriago baten alde.
La CIJ estime que la « violation » des obligations climatiques constitue « un fait internationalement illicite engageant la responsabilité » des Etats
Le Monde avec AFP
www.lemonde.fr/planete/article/2025/07/23/le-changement-climatique-est-une-menace-urgente-et-existentielle-declare-la-cij-dans-un-avis-historique_6623222_3244.html
Article
Dans un avis historique, la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l’ONU, a ouvert la voie à une obligation de « réparations » pour les pays pollueurs.
Il s’agit d’un avis certes consultatif mais inédit, destiné à influencer la jurisprudence mondiale. Les Etats qui violent leurs obligations climatiques commettent un acte « illicite » et pourraient se voir réclamer des réparations par les pays les plus affectés, a conclu, mercredi 23 juillet, la Cour internationale de justice (CIJ).
La plus haute juridiction de l’ONU, basée à La Haye, établit à l’unanimité dans cet avis, initialement demandé par des étudiants sur l’archipel de Vanuatu, une interprétation juridique du droit international, dont des législateurs, avocats et juges du monde entier peuvent désormais se saisir pour changer les lois ou attaquer en justice les Etats pour leur inaction climatique.
L’avis est « un jalon historique pour l’action climatique », s’est félicité le ministre du climat de Vanuatu, Ralph Regenvanu, à l’issue de l’audience sur les marches du Palais de la paix, se disant convaincu qu’il inspirerait « de nouvelles actions judiciaires » dans le monde. George Bumseng, chef de l’île d’Ambrym au Vanuatu, s’est, lui, dit « très impressionné ». « Nous attendions cette décision depuis longtemps dans la mesure où nous sommes des victimes du changement climatique depuis une vingtaine d’années », a-t-il expliqué.
Le secrétaire général de l’ONU a aussi estimé qu’il s’agissait d’« une victoire pour [la] planète, pour la justice climatique et pour la capacité des jeunes à faire bouger les choses ». Selon Antonio Guterres, la décision signifie « clairement que tous les Etats sont tenus, en vertu du droit international, de protéger le système climatique mondial ».
Lien de causalité
La dégradation du climat, causé par les émissions de gaz à effet de serre, est une « menace urgente et existentielle », a déclaré le juge Yuji Iwasawa, président de la Cour, lors d’un discours de deux heures.
La Cour a rejeté l’idée, défendue par les grands pays pollueurs, que les traités climatiques existants – et notamment le processus de négociation des COP annuelles – étaient suffisants. Les Etats ont « des obligations strictes de protéger le système climatique », a-t-il argué. En accord avec les petits pays insulaires, il a confirmé que le climat devait être « protégé pour les générations présentes et futures » – alors que les grands pays pollueurs refusaient absolument de reconnaître légalement les droits d’individus pas encore nés.
La partie la plus conséquente de l’avis, et qui suscitera le plus de résistance chez les pays riches, découle selon la Cour de ces obligations : les compensations dues aux pays ravagés par le climat. La « violation » des obligations climatiques par un Etat constitue « un fait internationalement illicite engageant sa responsabilité », a déclaré Yuji Iwasawa. « Les conséquences juridiques résultant de la commission d’un fait internationalement illicite peuvent inclure (…) la réparation intégrale du préjudice subi par les Etats lésés sous forme de restitution, de compensation et de satisfaction », a également dit le président de la CIJ.
Mais la Cour place la barre haut : un lien de causalité direct et certain doit être établi « entre le fait illicite et le préjudice » ; un lien certes difficile à établir devant une juridiction, mais « pas impossible » pour autant, concluent les quinze juges de la CIJ. Il s’agit du cinquième avis unanime de la Cour en quatre-vingts ans, selon l’ONU. Il faudra du temps pour que les juristes digèrent pleinement l’avis de 140 pages, et encore plus pour voir si des tribunaux nationaux s’en emparent. Mais d’ores et déjà de nombreuses voix, expertes et militantes, soulignent le caractère historique du texte.
La France a salué, par la voix de la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, une « victoire pour le climat ». C’est « une victoire historique pour la justice climatique », a également réagi, auprès de l’Agence France-Presse (AFP), l’ancien rapporteur spécial de l’ONU pour les droits humains et l’environnement, David Boyd. L’interprétation par la Cour des obligations des Etats « sera un catalyseur pour accélérer l’action ».
« Pour la première fois, la plus haute cour du monde a établi que les Etats avaient une obligation légale de prévenir tout préjudice climatique, mais aussi de le réparer pleinement », a commenté l’une des juristes les plus expertes du sujet à la London School of Economics, Joana Setzer. L’avis, selon elle, « renforce la base juridique de la justice climatique ».
« Décision majeure »
Les climatologues les plus déçus par l’action politique mondiale sont du même avis. « C’est une décision majeure », dit, à l’AFP, Johan Rockström, directeur d’un des instituts européens les plus reconnus sur le climat, le Potsdam Institute for Climate Impact Research. Chaque pays peut « être tenu pour responsable » devant les tribunaux, même s’il n’est pas signataire des traités de l’ONU, ajoute-t-il.
Pour le climatologue américain Michael Mann, l’avis tombe à pic alors que Donald Trump continue à démanteler l’édifice construit par ses prédécesseurs démocrates pour réduire les gaz à effet de serre. L’avis de la Cour « fait des Etats-Unis, et de quelques pétro-Etats comme l’Arabie saoudite et la Russie, un pays hors-la-loi qui menace nos peuples et notre planète au nom des profits des énergies fossiles », dit-il à l’AFP
L’avis sera certainement « testé » en justice aux Etats-Unis, prédit pour l’AFP le professeur à l’école de droit du Vermont, Pat Parenteau. « Cela ne réussira pas avec la Cour suprême actuelle, mais ce n’est pas permanent ».
Nombre d’ONG et militants attendaient avec impatience cet avis, frustrés par l’inaction ou la lenteur des grands pays pollueurs à réduire leur combustion de pétrole, de charbon et de gaz.
Deux questions
La Cour a dû organiser les plus grandes audiences de son histoire, avec plus de 100 nations et groupes prenant la parole, en décembre au Palais de la paix.
La bataille du climat investit de plus en plus les tribunaux, qu’ils soient nationaux ou internationaux, pour forcer une action climatique d’une ampleur que les négociations au niveau politique n’arrivent pas à déclencher – a fortiori dans une période où Europe et Etats-Unis ralentissent ou reculent sur leurs engagements.
Les COP annuelles ont certes permis d’infléchir les prévisions de réchauffement, mais encore très insuffisamment pour tenir l’objectif limite de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle, fixé par l’accord de Paris de 2015. Le monde en est déjà à au moins 1,3 °C de réchauffement.
Le droit international se construit avec de tels avis, a expliqué à l’Agence France-Presse (AFP) Andrew Raine, du département juridique du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). « Ils clarifient la manière dont le droit international s’applique à la crise climatique, ce qui a des répercussions sur les tribunaux nationaux, les processus législatifs et les débats publics. »
Graphisme, messagerie, cloud… des acteurs du logiciel libre offrent des alternatives aux Gafam
Rachel Knaebel
https://basta.media/Graphisme-messagerie-cloud-acteurs-logiciel-libre-offrent-alternatives-aux-Gafam
Article
Des associations proposent des services pour dire au revoir à Google ; des entreprises choisissent de ne travailler qu’avec des logiciels libres. L’écosystème du numérique libre se développe en France. Focus sur des initiatives bretonnes.
« C’était la première fois que je voyais des informaticiens de gauche. » Aurore Denis est développeuse informatique. Avant, le logiciel libre, elle ne connaissait que « de loin ». Tout cet univers fait de logiciels au code ouvert, que les utilisateurs ont la liberté d’utiliser, de copier, de modifier et de distribuer, n’était pas vraiment au programme dans sa formation. « Dans mes études d’informatiques, j’ai travaillé un peu sur Linux [un système d’exploitation open source, ndlr], mais pas beaucoup plus. »
Et puis, il y a trois ans, Aurore a rejoint le collectif breton Kaz, une association qui propose des services numériques basés sur des logiciels libres et hébergés en Bretagne. À Kaz, « la moitié de gens sont des informaticiens du logiciel libre, l’autre moitié ne viennent ni de l’informatique ni du logiciel libre, mais plutôt du monde militant, et ont des années d’engagement derrière eux, explique Fañch, un autre bénévole de l’association. Kaz, c’est la rencontre de ces deux mondes, qui résonnent vachement bien ensemble. » Bruno Perera, par exemple, n’est pas informaticien. Il est entré à Kaz, « pour le projet politique », celui d’un numérique libéré de Google et des autres multinationales qui ont installé un oligopole sur les outils numériques.
« On a commencé à se réunir pour réfléchir à comment résister aux Gafam », résume Alain Rivat, ancien responsable informatique dans l’Éducation nationale, aujourd’hui retraité. C’est comme ça que Kaz est né en 2020 à Vannes (Morbihan), sur la promesse de proposer à prix réduit du « numérique sobre, libre, éthique et local ».
Alternative à Google Drive
On parle à Aurore, Bruno, Fañch, Alain, et cinq autres membres de la collégiale de l’association bretonne sur BigBlueButton, une solution de visioconférence basée, justement, sur du logiciel libre. Kaz offre de son côté des services d’hébergement de sites web, comme celui du média breton Splann !, de messageries mails, d’espaces de travail en commun en ligne (alternatifs aux Google Doc et Drive), de messageries instantanées d’équipe (sur Mattermost, solution alternative à Slack notamment), de formulaires en ligne… « On offre aussi de nouveaux services quand les associations expriment un besoin, par exemple PeerTube [alternative à YouTube, ndlr], parce qu’il y avait des associations qui avaient besoin de diffuser des vidéos », détaille Alain.
L’association Kaz compte aujourd’hui 560 abonnés à l’offre gratuite, plus de 130 abonnés particuliers à une offre à 10 euros par an, et près de 300 organisations qui profitent d’une offre à 30 euros annuels. Ce sont de très petites entreprises, des syndicats, des associations. « On s’est dit que le bon vecteur pour sortir des Gafam, ce sont les associations, parce que quand une association s’abonne à nos services, derrière, il y a tous leurs adhérents. On peut penser que ces personnes-là vont prendre l’habitude de côtoyer le libre », poursuit l’homme.
« Nous voulons donner aux associations la possibilité d’avoir une solution alternative à Google Drive et Google Doc avec Nextcloud », un logiciel libre, précise François Merciol, qui est enseignant-chercheur en informatique. Kaz a aussi à cœur de respecter les données personnelles des utilisateurs, contrairement aux Gafam. « Il y a beaucoup d’utilisateurs de Kaz qu’on ne connaît pas, plus de 1000 sur notre Mattermost. Ils sont totalement anonymes », ajoute l’universitaire.
Le sens de la sobriété
Le troisième pilier de Kaz, c’est la sobriété. « Le sens de la sobriété, c’est que si vous n’utilisez pas certains services, on les désactive, et on les réactive à la demande. Mais ainsi, ça consomme moins, explique François. Et dès le départ, on a bien dit que la messagerie, ce n’était pas un lieu de stockage. Tous les messages qu’on envoie passent dans une moulinette qui en extrait les pièces jointes, qui vont dans un dépôt provisoire de manière automatique.
On voit l’image ou la pièce jointe dans le message, mais au bout d’un mois, elle est supprimée. On veut par là changer les comportements. La messagerie n’est pas une base de données. »
Et puis, « dans le monde du libre, on a la culture de faire durer le matériel, ajoute Fañch. Nos solutions restent compatibles avec du matériel ancien. » Quand, au contraire, une mise à jour de Windows peut obliger les utilisateurs à acheter un nouvel ordinateur.
L’association ne fonctionne qu’avec des bénévoles et sans subvention. Les abonnements annuels financent les cinq serveurs indispensables pour les services proposés. « Nous n’avons pas l’objectif de multiplier les utilisateurs. Quand on arrivera à nos limites, d’autres devront prendre le relais », souligne Didier, informaticien.
« C’est local »
Des initiatives comme Kaz, il y en a beaucoup à travers le pays. Framasoft, association d’éducation populaire consacrée au logiciel libre dénombre des dizaines de structures proposant des services en ligne « libres, éthiques et décentralisés » qui permettent de trouver rapidement des alternatives aux Gafam respectueuses de nos données et de la vie privée. Framasoft nomme ces alternatives « chatons » pour « collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires ».
À Brest, un des chatons s’appelle Infini. C’est une association qui propose elle aussi des services numériques basés sur des logiciels libres. Elle existe depuis… 1995. Infini héberge des sites web, offre des services de messageries, de listes de diffusion… et accompagne et forme ses adhérents. « On a autour de 400 adhérents, pour moitié des particuliers, pour moitié des associations ou des collectivités », précise Romain, salarié de l’association depuis octobre.
L’homme de 31 ans est ingénieur informatique de formation. « Il faut admettre qu’en tant qu’association avec une équipe technique de bénévoles, on ne peut pas assurer la même qualité de service qu’une entreprise privée. Mais il y a toujours des gens qui viennent chez nous, car c’est local. Nos serveurs sont à Brest, et nos services sont gratuits contre une adhésion à prix libre. On a une bonne réputation, plein de sites brestois sont hébergés en infini.fr. »
Des logiciels d’animation 3D à zéro euro
En plus d’associations, il existe aussi des entreprises privées lucratives engagées pour le logiciel libre. À Rennes, Activ Design, créée en 2011, est un centre de formation au graphisme et un studio graphique qui ne travaille qu’avec des logiciels libres.
« On est militant depuis des années sur le sujet du logiciel libre, ça nous semblait important d’essayer de faire quelque chose pour valoriser professionnellement ces outils, dit Elisa de Castro, l’une des fondatrices d’Activ Design. Les logiciels libres et l’open source sont très utilisés dans certains secteurs, typiquement dans le web, par exemple pour le CMS WordPress [Un CMS, Content Management System, est un logiciel qui permet de créer, gérer et modifier le contenu d’un site web]. Mais les gens ne le savent pas forcément, ce qui fait qu’ils ont souvent une image un peu négative du logiciel libre et de l’open source, ils disent que c’est moins ergonomique, que c’est moche. Alors que, finalement, l’essentiel de ce qu’ils font au quotidien repose dessus. »
Dans le domaine du graphisme, Activ Design utilise et forme par exemple aux logiciels libres Blender, pour l’animation en 3D, à Krita pour la peinture numérique, Gimp pour la retouche d’images, Scribus pour la mise en page, Godot Engine, pour créer des médias interactifs en 3D ou en réalité virtuelle, ou encore Inkscape, pour le dessin vectoriel, réaliser des illustrations ou schémas.
« Inkscape est beaucoup utilisé dans l’industrie. Nous avons formé Météo France à la création de cartes météo avec Inkscape, ou la compagnie aérienne Hop pour réaliser des plans de vol, explique Cédric Gémy, développeur 3D et chef de projet à Activ Design. Il y a des entreprises qui s’y mettent. Mais ce ne sont pas forcément des entreprises qui se revendiquent du milieu du graphisme. Dans le milieu du graphisme, il y a toujours l’idée que si on veut être “vraiment” graphiste, il faut d’autres logiciels. » Qui peuvent coûter très cher.
Utiliser le logiciel d’animation 3D Blender coûte zéro euro, alors pour que l’outil Autodesk Maya, la licence coûte plus de 2200 euros par an. « De plus en plus d’entreprises voient le gain financier qu’il y a à utiliser des logiciels libres, constate la formatrice. Entre un outil libre et un logiciel dont la licence coûte même quelques centaines d’euros, pour une petite association qui veut produire quelques documents graphiques, ça fait une différence. »
Dans le centre de formation d’Activ Design, des graphistes viennent se former à ces logiciels libres souvent ignorés dans les écoles, et des non-graphistes s’initient aux bases du métier avec des outils accessibles. « Il y a des graphistes de profession qui n’ont pas appris à se servir de ces logiciels, ou des personnes qui peuvent être chargées de com et ont besoin de se former en graphisme pour leur travail. Leurs entreprises peuvent soit être intéressées par le libre, soit elles ne veulent pas investir dans des licences et cherchent es outils gratuits, note la fondatrice de l’entreprise. Ce qui caractérise un logiciel libre, c’est le contrat d’utilisation. Un logiciel est libre puisqu’il a une licence libre, non privatisée, qui va à l’encontre de la réduction de libertés imposées par la plupart des licences des entreprises commerciales. »
« Où veut-on mettre son argent ? »
Un autre modèle pour une entreprise active dans le logiciel libre peut être d’accompagner les utilisateurs dans la mise en place des outils. Toujours à Rennes, une coopérative, la Scop Ézéo, s’est créée en 2023 pour aider associations et petites entreprises à passer à des solutions libres, comme l’espace de travail collaboratif Nextcloud.
« Le secteur des logiciels d’espaces de travail est dominé par le duopole de Microsoft, avec Office 365, et Google avec sa suite », pointe Samuel Louvel, fondateur d’Ézéo. La structure compte aujourd’hui trois salariés. « Nous travaillons avec des personnes qui ont souvent une vision politique de ce qu’est le numérique et veulent que leurs usages s’accordent avec leurs valeurs. C’est pour cela qu’elles se tournent vers des outils comme Nextcloud. »
Nextcloud propose certes une version gratuite pour les particuliers, mais payante pour les entreprises. Alors, quel est l’avantage ? « Le coût d’une solution Nextcloud est au final relativement équivalent pour les entreprises à celui de la Google suite ou de Microsoft. La question, c’est où est-ce que je veux mettre mon argent ? » Chez les Gafam ou dans l’écosystème du libre ?
Dans cette commune, la transition écologique est en marche depuis 30 ans
Mehdi Laïdouni
https://reporterre.net/Dans-l-ancien-bassin-minier-cette-commune-a-reussi-a-faire-aimer-l-ecologie
Article
Dans la commune de Loos-en-Gohelle, le modèle de participation citoyenne qui combine chantiers participatifs, monnaie locale et sécurité sociale alimentaire est rentré dans les mœurs. Un succès basé sur l’accessibilité populaire.
Les maisons en brique, les terrils jumeaux à l’horizon, l’odeur des frites et la « ducasse » — fête foraine — sur la place principale ne mentent pas : à Loos-en-Gohelle, on est plus que jamais « dins ch’Nord ». Pourtant, au Ménadel & Saint-Hubert, un restaurant situé face à la mairie, on fait aussi du très bon couscous, avec des légumes ultralocaux. D’ailleurs, Christiane, 94 ans — ou « mamie Christiane » comme l’appellent les habitués — ne manque pas de quitter son assiette pour venir nous tapoter l’épaule lorsqu’elle prend connaissance de notre qualité de journaliste : « Surtout, n’en dites que du bien ! »
Si Reporterre s’est rendu au Ménadel & Saint-Hubert, ça n’est pas — que — pour son couscous. Cet endroit, ouvert en 2020, est l’un des cœurs de la participation citoyenne et de la vie de la petite cité minière de 6 850 âmes, connue depuis longtemps pour sa qualité de laboratoire en matière d’écologie et de démocratie participative.
On vous l’accorde : l’expression « démocratie participative » est peu ragoûtante. À la place, ce tiers-lieu propose une porte d’entrée bien plus alléchante : la bonne nourriture, celle qui permet de rassembler. Une initiative concrète, à l’image de cette autre manière de faire de la politique depuis de nombreuses années.
Dans le contexte de chaos ayant suivi, dans les années 1980, la fermeture des mines et la fin du système paternaliste des houillères, qui assurait un logement gratuit à vie et un système de Sécurité sociale, la ville a dû se réinventer. Geoffrey Mathon, maire de Loos-en-Gohelle et enfant du pays, s’en souvient. « Marcel Caron [maire (PS) de 1977 à 2001] s’est dit : “On est au fond du trou, c’est une catastrophe sociale. Comment on va s’en sortir ? Par la solidarité.” »
Créer un « archipel nourricier »
Association d’éducation populaire originaire de Vieille-Église, près de Calais, les Anges Gardins se sont alliés à la mairie de Loos-en-Gohelle pour reprendre le local, et le transformer en tiers-lieu tourné vers la participation citoyenne à travers l’alimentation. Des salariés en contrat d’insertion et des habitants — environ 150 adhérents — font vivre le Ménadel & Saint-Hubert et sa philosophie du « bien-manger ».
« On travaille particulièrement la cuisine nourricière, la cuisine des restes, la cuisine à base de légumineuses. C’est du sain, du local, du bio », explique Florence Bobot, membre de l’association d’insertion Les Anges Gardins, chargée du lieu géré en concertation avec les adhérents. L’association achète des terrains dans le bassin minier pour cultiver des fruits et légumes et créer ainsi un « archipel nourricier ».
Au Ménadel, les adhérents donnent de leur temps pour faire vivre le lieu. Notamment en prenant part à des ateliers — de cuisine, par exemple — et des chantiers coopératifs sur les terrains possédés par l’association, où poussent les légumes cuisinés au restaurant ou proposés dans des paniers solidaires et des colis alimentaires.
Dans une société où l’engagement bénévole est parfois difficile, il fallait trouver un moyen de faire participer les gens. « Notre but est de travailler l’émancipation et l’engagement. Comment travailler l’engagement ? En le reconnaissant », dit Florence Bobot.
C’est pourquoi, en échange du temps donné sur les chantiers et les activités, les adhérents reçoivent de la « manne », une monnaie créée spécialement pour l’occasion. Cette monnaie est utilisable dans de nombreux commerces de Loos-en-Gohelle : le comité des usagers du Ménadel — composé d’adhérents — a recensé les envies, puis monté des partenariats avec des commerces de la commune.
Ainsi, la manne permet d’acheter de la nourriture bio à la Biocoop et sur le tiers-lieu, mais aussi dans des lieux plus accessibles pour des adhérents souvent précaires. « Avec la manne, on peut aller au Carrefour, on peut aller à la friterie », explique Florence Bobot.
La monnaie locale a connu un réel succès. « Il y a des gens qui ne viennent qu’aux ateliers où ils peuvent toucher de la manne, raconte Laurane Jouault, membre des Anges Gardins et coordinatrice du lieu de vie. Et ce n’est pas grave, parce que ça nous permet de toucher des gens, et au fur et à mesure, de les impliquer. »
Fort de cette dynamique, le Ménadel & Saint-Hubert vient de lancer son système de Sécurité sociale de l’alimentation : la caisse de l’alimentation locale et de l’engagement (Calien). Les plus précaires donnent 25 euros par mois pour avoir accès à un panier de courses de 50 euros.
Là encore, les adhérents ont le pouvoir de choisir vers quels commerces ils veulent se tourner pour dépenser leurs bons, avec un pragmatisme rendu nécessaire par la pauvreté existante dans le bassin minier. « Pour les adhérents, l’idée n’est pas d’aller vers le tout-bio, parce que ça a un coût. Le comité de gestion a réfléchi à des compromis », explique Laurane Jouault, membre de l’association des Anges Gardins, et coordinatrice du lieu de vie.
L’exemple du Ménadel & Saint-Hubert illustre comment des habitants, souvent peu familiers avec l’engagement, ont pu s’emparer d’une politique publique de l’alimentation. « Ce lieu est complètement dans l’ADN de Loos-en-Gohelle, dit Geoffrey Mathon, maire de la commune. On s’appuie sur les habitants pour avoir une vie plus équilibrée. »
40 ans de tradition participative
Si le Ménadel est l’un des exemples les plus récents et réussis, son succès s’appuie sur cette tradition locale de participation citoyenne mise en place depuis quatre décennies à Loos-en-Gohelle. En 2001, avec Jean-François Caron — maire écologiste et fils de Marcel Caron — le système participatif s’est renforcé avec la mise en place du « fifty-fifty », un système où la mairie et les habitants construisent les projets politiques en commun, souvent à l’initiative de ces derniers.
« Ils peuvent me dire “Monsieur le maire, on a un problème“, mais ils vont pas me demander de le faire à leur place. Ils vont proposer leur idée », explique Geoffrey Mathon, présent depuis 2000 en tant qu’agent de mairie, et maire depuis 2023.
« On est dans une société où on a perdu du pouvoir d’agir : au lieu d’être des citoyens, on est des consommateurs, dit Geoffrey Mathon. À chaque fois, on cherche un messie, un leader, quelqu’un qui va trouver des solutions à nos problèmes. Ici, on essaie d’éviter ça depuis de nombreuses années. »
Connaître ses forces
Si l’expérience loosoise réussit à se maintenir dans le temps, elle possède aussi ses propres limites : il faut mobiliser des moyens financiers et humains sur le long terme — et pas juste sur un coup de com’ — et réussir à aller chercher les publics très précaires, plus éloignés de l’action publique.
Mais surtout, maintenir cet élan collectif demande énormément d’énergie, chez les décideurs comme chez les habitants. « On peut pas s’impliquer sur tout, tout le temps, conclut Geoffrey Mathon. Des habitants nous ont dit : “Nous, on n’arrive plus à vous suivre.” Aujourd’hui, avec notre expérience, on est capable de voir que 5-6 projets par an — où il y a un vrai enjeu, c’est suffisant. »
Une autre caractéristique de Loos-en-Gohelle réside dans le savant mélange entre démocratie participative et écologie populaire… sans arriver bille en tête avec le mot « écologie », souvent mal perçu et associé à une élite condescendante.
« On a constaté que la porte d’entrée ne peut pas être l’écologie, ça ne marche pas, raconte Geoffrey Mathon. Il faut partir de l’énergie des gens. Si quelqu’un nous dit qu’il veut plus de fleurs dans la ville, on va pouvoir expliquer que l’effondrement de la biodiversité est une catastrophe. Alors, les gens vont comprendre que si l’on met tel type de fleurs, ça va permettre la pollinisation. »
C’est ainsi que cette année, sur une initiative des parents d’élèves et des élèves de l’école Basly, les habitants aidés par les services techniques ont enlevé le bitume de la cour de récréation, et végétalisé l’espace.
Autres exemples : la pose de panneaux photovoltaïques et la création d’une société par action simplifiée réunissant une centaine d’habitants de la commune volontaires, ou encore la rénovation thermique des logements. « Les gens, au début, l’écologie, ils s’en fichaient. Mais, quand ça leur permet de passer d’une facture de 3 000 euros à 300 euros, là, ça les intéresse ! » s’exclame le premier édile.