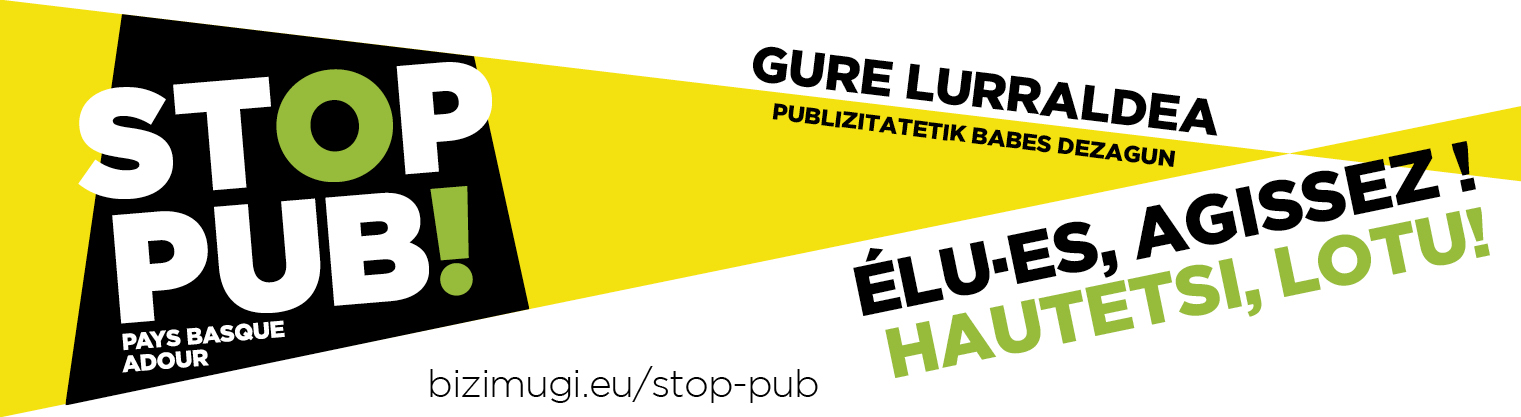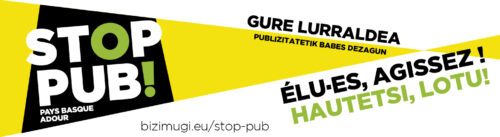Egunero 600 futbol zelaiko natura-azalera hormigoi bihurtzen dute Europan
Ekain Carrasco Tellaetxe
www.argia.eus/albistea/egunero-600-futbol-zelaiko-natura-azalera-hormigoi-bihurtzen-dute-europan?mtm_campaign=HariaBuletina
Article
2018tik 2023ra kolore berdea izatetik grisa izatera pasa den lur eremua 9.000 kilometro koadro ingurukoa da, Zipreren adinako azalera. The Guardian-ek argitaratu duen ikerketaren arabera, etxebizitzen eta errepideen eraikuntzara ez ezik, luxuzko turismo, kontsumo eta aisialdira bideratutako lurrak dira.
The Guardian eta bere bazkide diren Arena for Journalism in Europe (Arena), Norvegiako Natura Ikertzeko Institutua (Nina), Norvegiako NRK irratia eta 11 herrialdetako beste hedabide batzuek eginiko ikerketan ondorioztatu dute 2018tik 2023ra artean 9.000 kilometro koadro naturgune galdu direla gizakion esku hartzeengatik, alegia, egunero 600 futbol zelaien azalerako natura galera da.
Natura lurretan ez ezik, landa guneko soroak ere hormigoiz ordezkatzen ari dira, eta horrek elikadura segurtasunari mehatxu egiten dio, txostenaren arabera. Eraikuntzen gehiengoa errepide eta etxebizitzak dira, baina aberatsen probetxurako diren luxuzko turismo, kontsumo eta industriak ere lekua hartu dio naturari. Natura galera handiena izan duten herrialdeak Turkia (1.800 kilometro koadrotik gora, Europa osoko galeraren bostena), Polonia (1.000 kilometro koadrotik gora), Frantzia (950 kilometro koadro), Alemania (720 kilometro koadro) eta Erresuma Batua (604 kilometro koadro) dira.
Besteak beste, Turkian, Ezmir probintziako hezegunea, Egeoko kostaldean, hormigoizko zimenduen azpian lurperatu dute, luxuzko yateak izatera bideratutako kirol portu baterako, ikerketaren arabera. Portugalgo kosta ere luxuagatik bereziki zigortua izaten ari da. Algarveko kostan babestutako eremu batean 300 hektarea galduko dira golf zelaia duen konplexu baten eraikuntzan, zeinak mantenurako egunero 800.000 litro ur behar dituen. Turkiako proiektua aurrera daraman Yatek bezalako enpresek legearen barruan jarduten dutela argudiatzen badute ere, hainbat GKEk salatu dute Europan gertatzen ari den “kalte naturala”.
Euskal Herrian ere ez gaude prozesu honetatik salbuetsita. Besteak beste, Baztango lurretan eraikitzekoa den Aroztegia luxuzko proiektua bertan daukagu. Luxuzko hotela, golf zelaia eta 228 etxebizitza eraikiko dira natura lurretan, herritarrak proiektua oztopatzen saiatu diren arren.
La France dans le top 3 des pays européens où l’on bétonne le plus
AFP
www.liberation.fr/environnement/la-france-dans-le-top-3-des-pays-europeens-ou-lon-betonne-le-plus-20251001_QLUCVEGYKJCD5OCAVIIBM2H4MU/#mailmunch-pop-1146266
Article
Une enquête basée sur des photos satellites révèle, ce mercredi 1er octobre, que 1 500 km² d’espaces naturels et agricoles sont artificialisés chaque année en Europe, bien plus que les objectifs fixés pour atteindre l’objectif zéro artificialisation nette en 2050.
Chaque jour l’équivalent de 600 terrains de football est artificialisé sur le continent européen. Et la France n’est pas en reste : entre 2018 et 2023, 950 km² d’espaces naturels ont été bétonnés, soit neuf fois la superficie de Paris, révèle ce mercredi 1er octobre une enquête de journalistes et de scientifiques publiée par plusieurs médias européens et portant sur onze pays dont la Turquie. L’Hexagone se classe parmi ceux où le phénomène est le plus inquiétant, derrière la Turquie (1 860 km²) et la Pologne (1 040 km²).
Partout, l’artificialisation des terres va bon train. «Entre janvier 2018 et décembre 2023, nous avons perdu environ 9 000 km²» bruts de terres au profit de la construction, «une surface équivalente à la taille de Chypre», indiquent les auteurs de la publication, coordonnée par le réseau Arena for Journalism in Europe et intitulée «Du vert au gris». Chaque année, en moyenne, 1 500 km² d’espaces naturels et agricoles sont bétonnés en Europe.
Ces résultats suggèrent que les données de l’Agence européenne pour l’environnement «sous-estiment probablement l’ampleur de l’artificialisation en Europe», en réalité au moins 1,5 fois plus importante selon l’enquête, qui s’appuie sur une analyse d’images satellitaires à résolution fine et sur de l’IA.
En 2019, l’agence européenne avait montré que si «une zone considérable», d’une superficie légèrement plus petite que celle de la Slovénie, a été asphaltée entre 2000 et 2018 en Europe, le rythme de l’artificialisation avait ralenti, passant de quelque 1 090 km² par an (2000 et 2006) à 710 km² par an (2012 et 2018).
«On entend souvent dire : “Oh, on a accordé ce permis de construire parce qu’il ne faisait que 2 000 m², et alors ?“ Mais si on additionne tous ces permis à travers l’Europe, c’est énorme», fait remarquer Peter Verburg, professeur d’analyse spatiale environnementale à l’Université libre d’Amsterdam. L’artificialisation, pour construire des hébergements, usines ou routes mais aussi parfois des activités touristiques, se fait d’abord sur les espaces naturels – forêts, prairies zones humides, dont 900 km² sont détruits chaque année. 600 km² de terres agricoles sont elles aussi grignotées annuellement, avec de «graves conséquences sur la sécurité alimentaire et sanitaire».
«Nous sommes en train de bétonner notre avenir»
Ces pratiques accélèrent la disparition de la nature, essentielle à la survie de l’humanité. «Pendant des années, l’Europe a promis d’être un leader en matière de préservation du climat et de la nature, mais ce que montre cette enquête, c’est que nous sommes littéralement en train de bétonner notre propre avenir», dénonce Lena Schilling, eurodéputée et militante écologiste autrichienne.
En 2011, Bruxelles s’était donné pour objectif non contraignant de réduire l’artificialisation à 800 km² par an. Elle vise le zéro artificialisation nette des sols sur le continent d’ici 2050. Mais les tensions politiques internes à l’Union européenne ont conduit à détricoter ou amoindrir la portée de certains textes environnementaux. En France aussi, l’objectif de «zéro artificialisation nette» a été fortement assoupli par la loi de simplification de l’économie. Le pays pourrait donc peiner à sortir du top 3 des mauvais élèves européens.
Donald Trump attaqué en justice par de jeunes Américains pour son recul climatique
AFP
www.liberation.fr/international/amerique/donald-trump-attaque-en-justice-par-de-jeunes-americains-pour-son-recul-climatique-20250916_4NI5HPRN5ZH4BBTS4MXCGZGXKQ/
Article
Le groupe de plaignants, dont plusieurs mineurs, accuse ce mardi l’administration républicaine de bafouer leurs droits fondamentaux en promouvant le pétrole et le gaz. L’action est portée devant un tribunal fédéral à Missoula, dans le Montana.
Politique ou judiciaire ? Le combat climatique s’installe progressivement sur le terrain des tribunaux. Ce mardi, de jeunes plaignants vont pouvoir témoigner pour la première fois directement face au gouvernement républicain. En cause ? La manière dont la politique de Trump «provoque la crise climatique et porte préjudice aux jeunes» explique Andrea Rogers, avocate de l’association Our Children’s Trust. Décrets qui facilitent la production de pétrole et de gaz et qui entravent celle d’énergies renouvelables, décisions qui occultent le suivi des effets du changement climatique, autant d’arguments portés par le groupe de militants qui s’inquiètent des répercussions sur la santé. «Cela m’angoisse beaucoup de penser à mon avenir», explique Eva Lighthiser – la plaignante principale de 19 ans –, dont la famille a été contrainte de déménager pour motifs climatiques. «C’est très difficile à accepter pour quelqu’un qui entre tout juste dans l’âge adulte», poursuit-elle.
Aux côtés de cette vingtaine de jeunes, l’initiative est appuyée par des climatologues, un pédiatre ainsi que l’ancien émissaire climatique démocrate, John Podesta, qui témoigneront.
Ce n’est pas la première fois que des jeunes s’emparent de la justice pour faire valoir leurs droits climatiques. Cet été, des étudiants de l’archipel du Vanuatu (océan Pacifique) ont obtenu une victoire retentissante devant la Cour internationale de justice – plus haute juridiction de l’ONU. De même, en 2023, un juge du Montana avait donné raison à de jeunes plaignants qui contestaient l’absence de prise en compte du climat dans la délivrance de permis pétroliers et gaziers, estimant que cela violait leur droit constitutionnel à un environnement sain. Un an plus tard, ce sont de jeunes militants hawaïens qui avaient obtenu à leur tour un accord obligeant leur Etat à accélérer la décarbonation du secteur des transports.
Si l’action reste pour le moment au stade procédural et vise à obtenir du juge qu’il ordonne la tenue d’un procès, le combat n’est pas gagné pour les plaignants. Le gouvernement fédéral, rejoint par 19 Etats conservateurs et le territoire de Guam, réclame un classement sans suite. De plus, l’absence de jurisprudence fédérale forte sur un «droit constitutionnel à un environnement propre» ne joue pas en faveur du mouvement, selon Michael Gerrard, professeur de droit environnemental à l’université de Columbia.
En cas de procès, la procédure devrait se tenir devant de la Cour suprême – à majorité conservatrice. Or, Michael Gerrard est cynique et clair : «Cette cour suprême est plutôt encline à retirer des droits qu’à en accorder, à moins que vous n’ayez une arme à feu.» Au niveau fédéral en effet, la balance penche rarement du côté des militants. L’affaire la plus connue, datant de 2015, a été close en 2023 par ladite Cour suprême. Mais alors existe-t-il un droit à un futur viable ? Le gouvernement Trump pourrait faire valoir que la question climatique relève du politique et non des tribunaux.
Retour des marches climat : « C’est un refus de la résignation »
Gaspard d’Allens
https://reporterre.net/Retour-des-marches-climat-C-est-un-refus-de-la-resignation
Article
Inutiles, les marches pour le climat ? Pas pour les chercheurs auteurs du livre « Greenbacklash — Qui veut la peau de l’écologie ? ». Pour eux, « l’espoir est un impératif moral » et ils saluent la convergence des luttes.
Laure Teulières, Steve Hagimont et Jean-Michel Hupé sont chercheurs à Toulouse et membres de l’Atécopol (L’Atelier d’écologie politique). Depuis 2018, ce collectif s’attelle à construire une communauté pluridisciplinaire de scientifiques réfléchissant aux bouleversements écologiques. Ces trois chercheurs ont coordonné le livre Greenbacklash — Qui veut la peau de l’écologie ? à paraître le 10 octobre au Seuil.
Reporterre — Le 28 septembre, de nouvelles marches climat vont se dérouler en France pour réclamer plus de justice sociale et environnementale, que faut-il attendre de ces manifestations dans le contexte actuel ?
Laure Teulières, Steve Hagimont, Jean-Michel Hupé — C’est une action qui s’inscrit dans une série de mobilisations partout dans le mondesous l’impulsion de peuples autochtones à l’approche de la COP30 : « Fixons les limites, sauvons le climat ! »
On comprend très bien que l’on puisse éprouver de la lassitude. C’est encore une autre manifestation qui n’aura évidemment pas d’effet immédiat sur une politique gouvernementale qui méprise les mouvements sociaux depuis des années, qui plus est dans un contexte de régression très forte, un backlash [retour de bâton], sur les questions écologiques.
Cette marche est d’autant plus importante dans ce contexte : c’est le refus de la résignation. La dimension internationale, la mise en avant des limites et l’origine autochtone de l’appel en font une initiative prometteuse. Une marche est une interpellation symbolique, un rappel vital que les questions écologiques doivent être portées plus largement.
Il est aussi remarquable que la fausse alternative « fin du monde, fin du mois » semble bien dépassée, avec les liens fortement exprimés avec Gaza, l’antifascisme et le mouvement social en cours — les syndicats parlant désormais de transition écologique en première place de leur discours.
Comment expliquer le backlash en cours ? Qu’est-ce qui a cassé l’élan des marches climat de 2019 ?
C’est le Covid qui a cassé la dynamique des marches climat de 2019, en empêchant les gens de se réunir et de se mobiliser. L’élan écologique s’est prolongé un peu d’une autre façon, avec les discussions autour des travailleuses et travailleurs essentiels : repartir des besoins fondamentaux, de ce à quoi l’on tient vraiment est la base pour transformer le modèle socioéconomique. Et la démonstration était faite qu’on pouvait « arrêter l’économie » ! C’est le « retour à la normale » qui a fini de casser l’élan des marches climat.
Le backlash antiécologique actuel a plusieurs ressorts. C’est l’aboutissement de dynamiques historiques de fond : par exemple, les logiques matérielles de production industrielle, de commerce mondial et d’adaptation à la compétition internationale, soutenues par quasi tous les gouvernements en place, sont incompatibles avec la sortie des énergies fossiles et la réduction nécessaire de la production et de la consommation.
Après des années de greenwashing, de discours politiques et économiques prétendant à l’écologisation de la société tout en continuant le business as usual, il semble que les masques tombent.
Dix ans après l’Accord de Paris qui actait la volonté mondiale de réduire chaque année davantage les émissions de gaz à effet de serre, celles-ci continuent globalement à augmenter. Car leur diminution à la hauteur des enjeux nécessite de remettre en cause des pouvoirs, des dominations et des hiérarchies très puissantes, portées par des acteurs prêts à tout pour garder leur place, quitte à sacrifier une grande partie de l’humanité et des écosystèmes.
En France, la non-application des propositions de la Convention citoyenne pour le climat était un signe flagrant de refus de tout changement significatif, ainsi qu’un déni de démocratie.
Déni et manque d’intérêt des décideurs, fascisation en cours, dénigrement de la science, trumpisation des esprits… Marcher pour le climat a-t-il encore du sens ?
Contre de tels ennemis, contre ces forces en guerre contre toute écologisation menaçant leurs intérêts, cela peut paraitre dérisoire. Néanmoins, dans des luttes au long court, c’est une richesse que d’avoir un répertoire d’actions diversifié, pour que chacun puisse trouver sa place, et que la large communauté qui s’inquiète de l’inaction climatique puisse trouver des espaces communs de rencontre.
« N’hésitons pas à célébrer celles et ceux qui essaient »
Aucune lutte n’a de chance de succès si elle n’est collective. Il faut bien se connaître et se reconnaître : marcher pour le climat en est un moyen. Personne ne pense que c’est suffisant, bien sûr, mais c’est important.
Ne faudrait-il pas imaginer d’autres manières d’agir et interpeller la société ?
Il existe déjà une effervescence de modes d’action et d’interpellation ! Extinction Rebellion, [le mouvement de désobéissance civile allemand] Ende Gelände, Les Soulèvements de la Terre…
Ou même plus modestement dans notre milieu académique, Scientifiques en rébellion, les Atécopols, et même Labos 1point5 et l’engagement des universitaires dans la formation des étudiantes et étudiants aux enjeux écologiques !
Tous ces mouvements font travailler leur imagination, expérimentent et sont prêts à changer de stratégie face à des échecs. Rien n’est la hauteur des enjeux actuels, qui dépassent notre capacité même d’imagination, pour paraphraser Günther Anders [1]. Mais n’hésitons pas à célébrer celles et ceux qui essaient et à multiplier les moments d’indignation, de joie, d’échange et de rencontre.
La répression du mouvement écologiste se durcit. Encore le 20 septembre, plus de 900 gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes et désencerclantes sur les antinucléaires à Bure. Les autorités tentent de cantonner les écologistes à la sidération et l’impuissance : comment en sortir ?
La réponse est dans votre question : refuser la sidération, lutter contre le sentiment d’impuissance en rejoignant des actions collectives. En adaptant les pratiques, aussi : il s’agit de se protéger. Les marches climat restent des lieux autorisés de rassemblement et de pratique joyeuse et familiale. Il est important de garder cet espace préservé des violences policières comme lieu de rencontre et d’empuissantement.
Contrairement à 2019 où les marches climat semblaient plus ou moins en phase avec la volonté gouvernementale, dans la continuation du consensus de l’Accord de Paris, on peut s’attendre, encore une fois, à ce que le gouvernement cherche la confrontation et à criminaliser les marches.
Comment les marches du 28 septembre pourraient-elles être plus subversives, plus populaires ?
La question dépasse bien sûr nos compétences, nous ne connaissons pas de formule scientifique pour faire que tout cela advienne. On voit s’affirmer une convergence entre la marche climat et le mouvement social pour une revendication transformative d’un nouveau modèle social et productif. Ceci en tenant compte des limites planétaires — y compris en intégrant nos consommations importées — et des moyens les plus justes pour y parvenir en intégrant pleinement les enjeux décoloniaux par exemple.
Ces rapprochements sont en cours, mais sans doute pas encore assez visibles ni systématisés. Il s’agit moins d’élargir le public des marches climat que d’élargir les liens et les moyens d’interpellation, d’implication et d’action parce que ces enjeux touchent déjà tout le monde, et qu’il faut choisir la façon d’y faire face dans le futur.
Il y a toujours un risque à ce que la « convergence des luttes » tende à dissoudre et égaliser chaque revendication, mais la question environnementale, systémique et englobante, peut être le trait d’union entre une diversité de luttes. Une sorte de matrice commune dans laquelle penser un avenir désirable et situer tous les combats soucieux de la dignité humaine et de la beauté du monde — des valeurs menacées de toutes parts.
Quelles sont les mutations qui vous donnent de l’espoir et qui seraient capables d’enclencher des transformations sociales et écologiques au sein de la société ?
L’espoir est un impératif moral quand bien même tout nous rendrait pessimiste. Car l’enjeu est la survie d’une humanité digne de ce nom. Le rapport de force semble très défavorable avec l’arrivée au pouvoir partout dans le monde de régimes de plus en plus autoritaires voire fascisants, au service d’une toute petite minorité. Ils ont à disposition des technologies de plus en plus puissantes à la fois de contrôle, de manipulation et de destruction.
Et même si beaucoup trop de monde soutient cette minorité en dépit de son intérêt (que l’on pense aux électrices et électeurs de Trump), en France, au moins, nous semblons moins naïfs, si l’on suit le sondage publié le 24 septembre par Odoxa pour Ici (Radio France).
9 Français sur 10 constatent le réchauffement climatique et s’en inquiètent, beaucoup sont prêts à changer certains aspects de leur mode de vie, mais seulement 15 % font confiance à l’État pour les protéger des conséquences du changement climatique.
Cela fait écho au sursaut de mobilisation citoyenne lors de la pétition contre la loi Duplomb. Il a démontré un immense ras-le-bol contre la façon déplorable dont une partie de la classe politique instrumentalise les questions écologiques, appuie les intérêts de lobbies et rabaisse le débat en maltraitant des sujets aussi cruciaux que l’agriculture, la santé environnementale, les effets des pesticides, etc.
« La non-reconnaissance du racisme fragilise les luttes »
Alexandre-Reza Kokabi
https://reporterre.net/La-charge-raciale-est-la-peur-de-mourir-prematurement-dans-une-societe-raciste
Article
Dans cet entretien, Douce Dibondo, autrice de « La charge raciale », revient sur les tensions traversant le milieu écologiste et sur comment la parole antiraciste peut y trouver sa place.
Les luttes écologistes ne sont pas imperméables aux inégalités raciales et aux tensions qu’elles charrient. Plusieurs évènements l’ont rappelé ces derniers temps. Au festival des Résistantes, des activistes écologistes racisés ont dénoncé la reproduction de rapports de domination au sein du monde de l’écologie ; le capitaine Paul Watson a suscité la controverse, notamment pour ses liens avec des personnalités aux positions notoirement racistes, tandis que le philosophe Malcom Ferdinand s’émouvait, lors d’un évènement organisé par Reporterre en 2024, d’être « l’un des seuls Noirs de la salle ».
Pour éclairer ces enjeux, Reporterre a interrogé Douce Dibondo, autrice et poétesse, cofondatrice du podcast « Extimité » et autrice de l’essai La Charge raciale (Fayard, 2024).
Dans ce livre, elle décrit le poids invisible, mais permanent, qui accompagne les personnes racisées, y compris dans des espaces militants.
Reporterre — Ces derniers mois, plusieurs tensions ont traversé le mouvement écologiste autour de la question raciale. Est-ce le signe que l’écologie peut devenir un espace où la parole et des pratiques antiracistes peuvent s’exprimer et s’ancrer durablement ?
Douce Dibondo — Je crois qu’il faut se méfier de l’idée d’un progrès linéaire. Pour moi, le temps est cyclique : on avance, on recule. Chaque victoire arrachée est le fruit de luttes acharnées, et les personnes blanches ne mesurent pas ce que cela coûte d’imposer ces agendas-là. Monter sur scène, comme aux Résistantes, pour dire « vous êtes tous racistes », c’est un moment de vulnérabilité immense. Cela demande du courage, mais aussi une énergie considérable, invisible pour la plupart.
Alors oui, il y a des prises de conscience. Mais, qu’est-ce qui change réellement dans la pratique ? Trop souvent, des collectifs écologistes viennent nous chercher au dernier moment, parfois même en demandant à des autrices précaires comme moi de « trouver » des intervenantes noires ou arabes, sans rémunération ni lien construit en amont. Cela dit beaucoup : cela signifie que ces mouvements n’ont pas su, en interne, créer de relations solides avec des personnes racisées, par des preuves concrètes, de la réciprocité, du travail préparatoire.
Dans votre essai « La charge raciale », vous décrivez un poids constant et souvent invisible qui pèse sur les personnes racisées. Comment définiriez-vous ce concept à quelqu’un qui n’en a jamais entendu parler ?
La charge raciale, c’est la peur de mourir prématurément dans une société raciste. Anticiper sa mort sociale : devoir correspondre à certaines attentes pour accéder à une vie digne, à un logement décent, à des soins qui considèrent notre humanité.
Anticiper aussi la mort physique : se demander si un enfant noir, un cousin, un père pourrait être tué par la police, organe de l’État racial. C’est même planifier ses vacances ou ses projets de vie en fonction des risques de vivre des agressions raciales et racistes, en tant que femme noire seule, en Italie, à la campagne française… Lors des législatives, des personnes qui vivent en province ont vu leurs voisins se révéler. Ils ont subi des attaques, des insultes…
C’est une charge historique, héritée de l’esclavage et du colonialisme. Une charge institutionnelle, qui traverse le logement, le travail, la santé. Une charge interpersonnelle, qui « effracte » les individus. Pour « naviguer » dans ce monde raciste, il faut effacer une part de soi, s’adapter pour tenter d’être acceptée.
La charge raciale est une affaire psychopolitique : elle use les corps et les esprits, installe une vigilance permanente. Réfléchir avant de parler, évaluer si l’on sera entendu ou caricaturé, se préparer à l’hostilité. Ce sont des compétences acquises malgré nous, une adaptation très fine. Les femmes, les personnes queers peuvent en saisir quelque chose, parce qu’elles connaissent aussi cette obligation d’une lecture permanente de l’atmosphère.
Quelles conséquences la charge raciale a-t-elle sur l’engagement militant et sur la santé des personnes qui la subissent ?
La première conséquence, c’est l’usure. Militer est exigeant pour tout le monde. Mais quand on est racisé, il faut en plus porter cette hypervigilance, ce travail de pédagogie, cette peur d’être instrumentalisé. Beaucoup finissent par se mettre en retrait, non pas parce qu’ils ne croient plus aux luttes, mais parce que l’espace militant ne leur permet pas de respirer.
Sur la santé, les effets sont réels : stress chronique, anxiété, isolement. On intériorise qu’il faudra toujours se battre deux fois plus, que rien ne sera jamais simple. Cette tension permanente mène à l’épuisement, au burn-out militant, voire à des atteintes physiques. Ça joue sur la santé mentale et somatique, qui est éminemment politique.
Et, il y a la menace plus radicale, évoquée précédemment : celle de la mort prématurée. Dans une société qui nous déshumanise, nos corps sont rendus tuables. On le voit notamment dans la manière dont les médias nous enferment dans une grammaire de la souffrance ou du divertissement, en nous silenciant, en nous imposant leur islamophobie. C’est pourquoi il est vital de nommer la charge raciale. Tant qu’elle reste invisible, elle continue d’opérer en silence, tout en creusant les inégalités.
Pourquoi est-il si difficile pour de nombreux espaces militants, y compris écologistes, de reconnaître et d’intégrer pleinement la question raciale ?
Parce que cela exige un décentrement radical. Beaucoup de collectifs blancs continuent de se penser comme la norme universelle, parlant « au nom de tous », sans voir que leur point de vue est situé, façonné par des privilèges. Reconnaitre la dimension raciale, c’est admettre que son regard n’est pas neutre. Et ça, c’est une rupture qui demande beaucoup d’humilité.
Il y a aussi une histoire politique. En France, l’écologie s’est construite comme un mouvement centré sur la planète, la biodiversité, le climat, en laissant de côté les rapports de domination. On parlait d’espèces à sauver, mais pas de colonialisme, pas de racisme, pas toujours de capitalisme. C’est cette déconnexion originelle qui rend aujourd’hui si difficile l’intégration de la question raciale. L’écologie décoloniale, à mon sens, est décisive : elle relie ces enjeux.
On entend parfois que « parler de racisme divise les luttes ». Comment répondez-vous à cet argument ?
C’est un déni, une forme de silenciation. Dire que parler de racisme divise, c’est maintenir le statu quo, c’est demander que l’unité se fasse toujours autour de la norme blanche. Mais quelle unité est-ce, si elle repose sur l’invisibilisation de celles et ceux qui subissent les discriminations ?
En réalité, c’est l’absence de reconnaissance du racisme qui fragilise les luttes. Tant que les personnes racisées doivent taire leur expérience pour ne pas « gêner », il n’y a pas d’unité véritable. La domination, elle, unit déjà : la suprématie blanche, capitaliste, bourgeoise est soudée. Donc si nous voulons construire un vrai rapport de force, il faut prendre la question raciale au sérieux.
Dans les manifs climat, on entendait souvent « il faudrait plus d’Arabes, plus de Noirs ». Mais qu’attend-on exactement ? Leur simple présence, sans qu’ils parlent du racisme ? Comme si leur rôle était d’ajouter du nombre, pas de voix. C’est ça l’universalisme à la française : un poison. Tant qu’on ne prend pas en compte les différences, les gens ne se reconnaissent pas.
Quels signes montrent, selon vous, qu’un collectif ou une organisation a réellement considéré la dimension raciale dans son fonctionnement ?
Ce n’est pas un atelier ponctuel ou une parole tokenisée [le tokenisme, c’est inclure une minorité uniquement pour cocher une case]. C’est dans les coulisses que cela se voit. Qui prend les décisions, qui s’occupe des tâches administratives ou de soin, qui a droit à la parole ? Ce sont ces détails quotidiens qui révèlent la réalité, pas une performance de diversité sur scène.
Un autre signe, c’est l’humilité : reconnaitre publiquement ses erreurs, dire « nous avons exclu malgré nous, et nous voulons faire autrement », et revenir régulièrement sur ces sujets. Pas un coup d’éclat isolé, mais un travail inscrit dans la durée.
Enfin, cela se reflète dans des choix très concrets : la composition des équipes, les intervenants, et même dans des détails, comme la nourriture qu’on partage.
Quelles stratégies ou pratiques permettent de créer des espaces militants plus sûrs et plus inclusifs pour les personnes racisées ?
Je ne crois pas à l’inclusivité. Parce que l’inclusion suppose un centre qui inclut les marges. Or les marges n’ont aucun besoin d’être avalées par un centre phagocyte. L’enjeu n’est pas d’intégrer, mais d’éclater tous les centres et de lutter en multiplicités, hors concentration du pouvoir, dans ses dissolutions.
Ce en quoi je crois, ce sont les alliances. Pas une grande convergence abstraite, mais des alliances ponctuelles, concrètes, sur des objectifs précis : le chlordécone, la spoliation des terres, les violences policières. On se rejoint pour une action politique, puis chacun reprend son chemin. C’est en multipliant ces ponts que la confiance se construit.
« L’enjeu n’est pas d’intégrer, mais d’éclater tous les centres »
Et puis il y a la lenteur : on ne répare pas des décennies d’exclusion avec une invitation. La confiance se bâtit par des actes répétés, dans la durée. Enfin, créer des espaces sûrs, c’est reconnaitre la charge raciale et son coût : rémunérer les interventions, ne pas réduire les personnes racisées à des témoins, leur reconnaitre une expertise politique.
Que se passe-t-il quand la question raciale n’est pas suffisamment prise au sérieux ?
Au bout d’un moment, il faut déserter. Parce que c’est trop épuisant, pour toutes les raisons que j’ai évoquées. Nous, les personnes racisées, sommes les héritières et héritiers du silence de nos parents, venus en France pour une vie digne. Nous dénonçons ce silence, nous le brisons. Est-ce que ça change vraiment les choses ? Est-ce qu’il existe une ouverture politique consciente dans la blanchité ? Je n’en suis pas sûre.
On ne peut pas parler de racisme sans parler d’intériorité. Ce travail-là, les personnes blanches doivent le faire individuellement. Tant qu’elles détournent les yeux, rien n’avance. Alors, il peut être stratégique de se mettre en retrait, d’invoquer un silence politique, de créer nos propres collectifs en non-mixité raciale. Nos propres îlots. Quitte à se rejoindre ponctuellement pour des actions communes. Mais il ne faut pas que notre agenda soit d’intégrer à tout prix ces espaces blancs pour exister.
La blanchité se croit sans ego, sans identité, « a-identité ». C’est cela le problème : se penser hors de toute racialisation. Ce regard blanc qui nous est imposé nous renvoie sans cesse qui nous sommes, qui nous ne sommes pas, qui nous voudrions être. Et c’est à ce miroir-là que nous devons apprendre à nous soustraire.