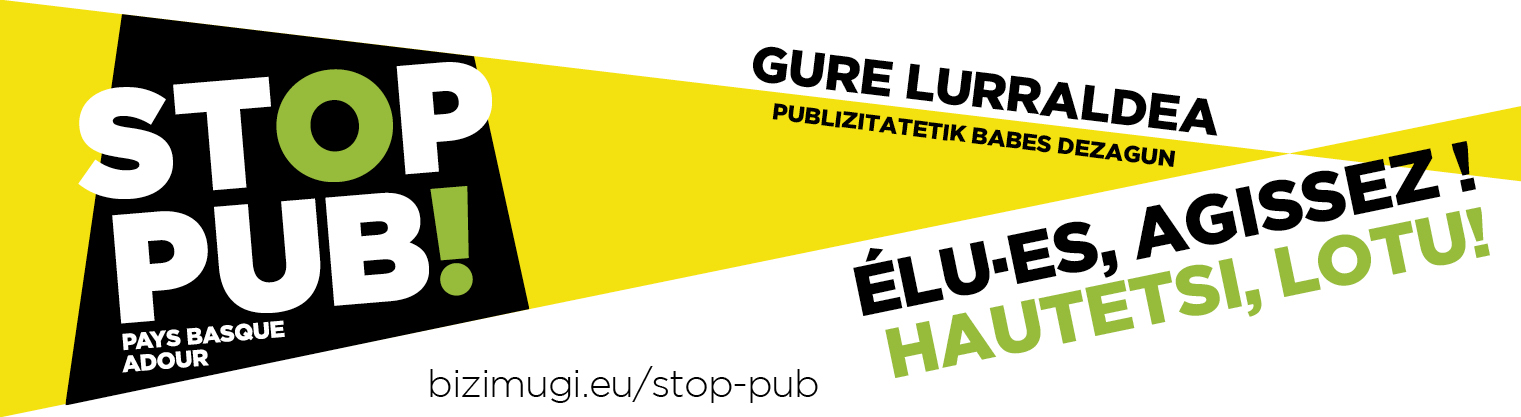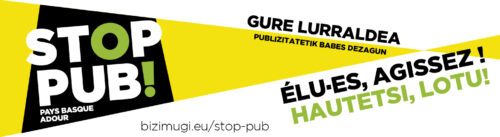Climat : une échéance cruciale ignorée par 95 % des pays
Emmanuel Clévenot
https://reporterre.net/Climat-une-echeance-cruciale-ignoree-par-95-des-pays
Article
Seulement 5 % des signataires de l’Accord de Paris ont rendu leur plan pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ceux qui l’ont fait n’ont rien présenté d’ambitieux.
À peine plus de 5 %. Telle est la proportion des pays signataires de l’Accord de Paris sur le climat à avoir rendu leur copie à temps. Ils avaient jusqu’au 10 février pour publier leur nouveau plan de réduction des émissions, baptisé « contributions déterminées au niveau national » dans le jargon des diplomates. Malheureusement, faute de caractère contraignant, seuls 10 des 195 signataires ont respecté cette échéance.
En signant le traité international parisien, lors de la COP21 en 2015, les États s’étaient engagés à soumettre tous les cinq ans une feuille de route détaillant leurs objectifs climatiques à l’horizon 2035. Une première série a ainsi été dévoilée en 2015. Une autre en 2020, la troisième étant attendue cette année. Si cette mise à jour tarde, la COP30 — prévue en novembre au Brésil — pourrait bien être chaotique.
Le pays de Lula da Silva a affiché l’ambition d’intensifier la lutte contre le changement climatique lors de ce grand raout. Objectif : que la Terre entre enfin dans les clous de l’Accord de Paris, autrement dit que la température mondiale soit maintenue à +1,5 °C ou 2°C maximum au-dessus des niveaux préindustriels. Seulement, tant que les nouveaux plans ne seront pas publiés, les gouvernements continueront de s’appuyer sur ceux établis il y a cinq ans. Or, d’après les Nations unies, ceux-ci nous mènent droit vers une hausse des températures de 2,6 à 2,8 °C d’ici la fin du siècle.
L’UE parmi les mauvais élèves
Parmi les dizaines de retardataires figurent notamment l’Union européenne (UE), le Japon, la Chine ou le Canada. Et chacun a son excuse : tantôt des difficultés techniques, tantôt des pressions économiques, tantôt des incertitudes diplomatiques. L’élection récente d’un climatodénialiste à la tête des États-Unis a poussé les diplomates à temporiser. Certains estiment, dans les colonnes du Guardian, qu’il est désormais préférable de reporter la publication une fois la tempête Trump calmée.
Première émettrice mondiale, la Chine n’a pas communiqué la date à laquelle elle entend sortir du silence. « Son plan est extrêmement important à surveiller, mais elle montre rarement ses cartes en avance », déplore à Reporterre Gaïa Febvre, du Réseau Action Climat (RAC). De leur côté, des sources officielles indiennes avancent, dans The Indian Express, une parution de la feuille de route de l’Inde entre juin et décembre. Celle-ci devrait refléter « la déception suscitée par […] la COP29 à Bakou [en Azerbaïdjan] » et son accord « néocolonialiste ». Traduction : l’Inde ne se foulera pas.
Du côté de l’Union européenne, on justifie le non-respect de l’échéance par la lenteur des processus d’approbation. « L’UE doit accélérer la cadence pour ne pas arriver les mains vides à Belém [à la COP30] », insiste Caroline François-Marsal, chargée des questions européennes au RAC. Qui regrette que ce dossier soit en attente depuis plus d’un an : « Alors que les attaques contre l’environnement s’intensifient de toutes parts, l’Europe doit tenir bon et constituer un rempart solide sur le climat en redevenant un pays moteur des négociations. »
Au total, d’après une analyse du média spécialisé Carbon Brief, les pays retardataires sont à l’origine de 83 % des émissions planétaires et pèsent pour près de 80 % de l’économie mondiale. Pas de quoi troubler le secrétaire exécutif de l’ONU pour le climat, Simon Stiell : « D’après les conversations que j’ai eues avec les pays, les gouvernements prennent cela très au sérieux, a-t-il déclaré le 6 février. Il est donc raisonnable de prendre un peu plus de temps pour s’assurer que ces plans soient de première qualité […] Au plus tard, l’équipe du secrétariat doit les avoir reçus d’ici septembre. » Il faut dire que l’ONU s’y est habituée : en 2020 déjà, seuls cinq États avaient tenu l’échéance de février.
Le travail de Biden balayé par Trump
Reste à savoir qui a rendu sa copie à l’heure. Du côté du G7, le Royaume-Uni a soumis son nouveau plan… tout comme les États-Unis. Baroud d’honneur climatique de Joe Biden, le texte dévoilé par le Démocrate juste avant de quitter ses fonctions est désormais symbolique. Si les États du pays peuvent s’en inspirer pour leurs politiques locales, Donald Trump a déjà amorcé le processus de retrait de son pays de l’Accord de Paris.
Ont aussi rendu leur plan : le Brésil, les Émirats arabes unis, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, l’Uruguay, Andorre, l’Équateur et Sainte-Lucie. Malheureusement, même dans ce lot, des pays sont réfractaires à se conformer à l’Accord de Paris.
Dans une étude menée par le projet scientifique indépendant Climate Action Tracker, les propositions brésiliennes, émiraties, étasuniennes et suisses sont « incompatibles » avec la trajectoire de +1,5 °C. Celles de la Nouvelle-Zélande n’ont pas encore été analysées, mais Carbon Brief précise qu’un expert climatique du pays les a décrites comme « incroyablement peu ambitieuses ». Des projections tracassantes à neuf mois de la COP30.
« La personnification juridique de la Seine n’apporterait aucune réponse aux véritables faiblesses de la protection environnementale »
Samir Zimé Yérima, Chercheur en droit public
www.lemonde.fr/idees/article/2025/02/13/la-personnification-juridique-de-la-seine-n-apporterait-aucune-reponse-aux-veritables-faiblesses-de-la-protection-environnementale_6545299_3232.html
Article
Dans une tribune au « Monde », le chercheur en droit public Samir Zimé Yérima juge « inopportune » la proposition, portée notamment par la maire de Paris, Anne Hidalgo, de reconnaître une personnalité juridique à la Seine.
« Je ne sais pourquoi on s’aime comme ça, la Seine et moi… » En déroulant ce couplet, la chanteuse Vanessa Paradis ne fait que poursuivre une longue tradition de personnification artistique de la Seine. Bien avant elle, Prévert, Hugo et tant d’autres ont magnifiquement subjectivé ce fleuve. Mais voilà qu’aujourd’hui ce jeu poétique menace de déborder dans le champ juridique.
Certaines organisations et autorités proposent, en effet, d’accorder la personnalité juridique à la Seine. La maire de Paris, Anne Hidalgo, annonçait ainsi, en décembre 2024, la mise en place prochaine d’une convention citoyenne « des droits de la Seine » devant aboutir à faire adopter par le législateur une loi reconnaissant à la Seine la personnalité juridique.
De quoi s’agit-il ? L’idée d’octroyer une personnalité juridique à la Seine vise à reconnaître des droits propres au fleuve et à le doter d’une capacité juridique lui permettant d’agir en justice, ou d’être représenté devant les juridictions. Cette idée n’est pas inédite. La Nouvelle-Zélande et l’Inde ont déjà franchi le Rubicon – ou plutôt respectivement le Whanganui et le Gange – en accordant la personnalité juridique à ces fleuves. En France, cette idée trouve un accueil favorable aussi bien auprès de certains militants que d’universitaires. Des initiatives ponctuelles ont déjà émergé et se sont renforcées dans le contexte des Jeux olympiques.
Des exigences constitutionnelles
Cette proposition est-elle juridiquement possible ? Sur le plan purement juridique, rien n’interdit d’accorder à la Seine la personnalité juridique. Néanmoins, certaines exigences constitutionnelles doivent être respectées. En premier lieu, seul le législateur est habilité à instituer une nouvelle catégorie de personne juridique. Ensuite, cette création ne doit pas entrer en conflit avec d’autres intérêts protégés par la Constitution, en particulier les droits fondamentaux. Somme toute, ces conditions apparaissent techniquement peu contraignantes.
Mais possibilité rime-t-elle nécessairement avec utilité ? Bien qu’elle se veuille progressiste, cette proposition paraît, à bien des égards, inopportune.
Premièrement, elle semble sous-estimer la richesse du dispositif juridique existant. Le code de l’environnement, dans ses articles L. 210-1 et suivants, offre déjà une protection étendue des eaux et milieux aquatiques. Il reconnaît l’eau comme « patrimoine commun de la nation » et établit un régime juridique complet : principes de gestion équilibrée, planification, police de l’eau, sanctions pénales et administratives. Quant à l’argument de la représentation, les associations environnementales bénéficient déjà en droit français d’un droit d’action en justice reconnu par l’article L. 142-1 du même code.
Le fleuve dispose donc, dans les faits, de « représentants » légaux capables de défendre ses intérêts devant les juridictions. En outre, ces associations peuvent agir même devant le juge constitutionnel, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a, en effet, reconnu la pleine invocabilité de certaines dispositions de la charte de l’environnement, en les rangeant parmi les droits et libertés que la Constitution garantit au titre de l’article 61-1 de la Constitution.
L’illusion d’une protection renforcée
Deuxièmement, la personnification juridique n’apporte aucune réponse aux véritables faiblesses de la protection environnementale. Les obstacles actuels sont éminemment d’ordre pratique : sous-effectifs des services d’inspection, manque de moyens techniques, engorgement des tribunaux, non-application des textes existants, etc. La création d’une nouvelle catégorie juridique n’augmentera pas les budgets, ne recrutera pas d’inspecteurs supplémentaires et n’accélérera pas les procédures. Elle risque même de détourner l’attention et les ressources des mesures véritablement nécessaires, tout en créant l’illusion d’une protection renforcée.
Troisièmement, cette innovation juridique risque d’introduire plus de confusion juridique que de protection. Quand l’on songe un instant à la condition de mise en œuvre d’une telle idée, c’est-à-dire la nécessaire adoption d’une loi, un paradoxe révélateur apparaît soudain. En tentant de s’inspirer, de bon aloi, des expériences étrangères, on replonge dans un mal bien français et si bien nommé par le juriste Guy Carcassonne, la « démangeaison législative ». Il s’agit de cette tendance délétère à légiférer sur tout, et donc à confondre la réponse avec la solution. Ainsi prospère l’inflation législative, au détriment de solutions pérennes.
Derrière cette proposition se cache, enfin, un dernier paradoxe philosophique et idéologique. En dénonçant le caractère anthropocentré du droit, les partisans de cette idée défendent eux-mêmes un anthropocentrisme inversé en forçant la nature à entrer dans nos catégories humaines. Plutôt que des réponses normatives, la protection de la Seine appelle des solutions factuelles.
Cet article est lauréat de la 10e édition du prix Guy Carcassonne. Organisé par le Club des juristes en partenariat avec Le Monde et la revue Pouvoirs depuis 2014, il récompense, chaque année, un article inédit portant sur une question constitutionnelle liée à l’actualité française ou étrangère.
Samir Zimé Yérima est attaché temporaire d’enseignement et de recherche en droit public à l’Ecole de droit de la Sorbonne.
Les cantines des collèges de Dordogne passent aux 100 % produits locaux, bio et fait maison
Lisa Damiano, Rozenn Le Carboulec
https://basta.media/cantines-colleges-Dordogne-transition-cent-pourcent-produits-locaux-bio-fait-maison
Article
Les restaurants scolaires de Dordogne opèrent une transition vers une alimentation bio et locale. Reportage à Montignac-Lascaux, où la cantine d’un collège se fournit désormais majoritairement chez les producteurs alentours.
Ce mercredi de janvier, peu avant 8h30, les élèves de Montignac-Lascaux, en Dordogne, affrontent le froid pour rejoindre leur collège. Ils ne pensent sûrement pas à la petite équipe qui s’affaire en cuisine depuis plus de deux heures déjà pour les nourrir. Dans cette cantine labellisée depuis peu « 100 % bio, local et fait maison », les onze agent·es sont à leur poste depuis 6 heures.
Au menu ce midi, plusieurs entrées au choix, parmi lesquelles de la betterave rouge, des poireaux vinaigrette et du radis violet – « moins fort que le radis noir », précise la cheffe Cécile Beau – accompagné d’une mayonnaise végétarienne sans œufs, montée au lait de soja, et du potage. En plat : pizza maison tout fromage ou avec jambon, faite sur place. Et pour le dessert, une compote de pommes cuites ce matin, ou les restes de salade de fruits de la veille : « Ici, c’est zéro gâchis. »
De la salade verte est en libre-service et le pain vient de la boulangerie d’à côté, qui livre chaque matin. Le tout en coordination avec la diététicienne Aurélie Mansard, qui veille à l’équilibre des menus. Car ce qui se trame au collège Yvon Delbos est bien plus qu’une transition alimentaire : « C’est un projet politique », proclame Nicolas Lamstaes, qui, depuis quatre ans, forme le personnel des cantines du département à ce grand chamboulement. L’objectif assumé : parvenir à dix-neuf établissements labellisés à la fin de l’année scolaire, et 30 d’ici la fin du mandat (sur la quarantaine de collèges publics du département).
Remplacer les surgelés et les conserves
Jusqu’à il y a un peu plus d’un an, les plats du restaurant scolaire étaient composés d’environ 20 % de produits locaux, le reste provenant d’ailleurs, y compris de l’étranger. « On avait quelques producteurs bio en démarchage libre, sinon on travaillait sous la houlette des grossistes et on faisait en fonction des promotions », décrit Cécile Beau. Elle a pris la tête de la cantine quand son chef est parti à la retraite, à l’été 2023. « On ne connaissait pas l’origine des produits. Il y avait beaucoup de légumes préparés ou semi-préparés, de surgelés, des steaks qu’il fallait servir très cuits… Aujourd’hui, notre travail est davantage valorisé », estime-t-elle.
La responsable nous montre les restes de trognons de pommes, qui ont servi à faire du jus pour la salade de fruits, tandis que la soupe du jour est accompagnée de croûtons réalisés avec le reste de pain : « Les enfants aiment ça. Ils kiffent, comme ils disent ! » commente-t-elle avec un sourire malicieux. À ses côtés, ses collègues servent dans des ramequins en verre le riz au lait encore chaud, tout juste cuisiné par Valérie pour le déjeuner du lendemain. « Avant, c’était des conserves et des pots de yaourt, ça n’a rien à voir », commente-t-elle avec fierté. Cela réduit aussi considérablement les déchets.
70 à 80 % de produits locaux
Depuis l’obtention du label « 3 carottes » correspondant au niveau excellence remis par l’organisme de certification bio Ecocert, placardé fièrement dans la cantine, les ratios se sont inversés. Les agent·es travaillent désormais avec 70 à 80 % de produits locaux, fournis par une dizaine d’agriculteur·ices situé·es dans un rayon de 30 kilomètres.
Si ce n’est pas possible, le complément est livré par la structure Manger bio Périgord, créée en 2017 pour alimenter la restauration collective en produits locaux et bio. Dans la commande du jour, livrée à 11h30 : de l’ail provenant de Saint-Vincent-Jalmoutiers ou encore des patates douces de Port-Sainte-Foy, communes situées à une centaine de kilomètres.
« Ici on travaille les mêmes produits que dans les restaurants gastronomiques », signale Nicolas Lamstaes. Le formateur sait de quoi il parle : après un apprentissage avec le très médiatique chef Philippe Etchebest, il a travaillé pour Alain Ducasse à Paris et Monaco, avant d’ouvrir son propre restaurant à Périgueux. « J’avais le manque du Périgord, j’ai dit au chef que je voulais rentrer chez moi », raconte-t-il. Alors qu’il souffrait de problèmes de santé l’obligeant à ralentir le rythme, il a fait la rencontre de Jean-Marc Mouillac.
Cet artisan de la première cantine 100 % bio de France, à Marsaneix, au sud de Périgueux, a cofondé il y a 10 ansle collectif Les Pieds dans le plat, regroupant des professionnel·les engagé·es pour une alimentation bio, locale et faite maison. Lui-même formateur pour les cantines du département, il a embarqué Nicolas Lamstaes dans le projet, qui a eu « un flash ». « Faire à manger pour les ados, c’est le plus beau métier du monde », se réjouit-il. Et de lancer : « Avant, je nourrissais mon ego, maintenant je nourris l’avenir ! » Le tout sans aucune frustration ni nostalgie, assure-t-il : « Je mets au défi Alain Ducasse de venir faire à manger pour 500 personnes ! Au début j’ai dû cuire 25 kilos de riz, je me suis planté. Ce n’est pas la même technique que pour 50 personnes. »
Des anciens élèves devenus producteurs
Pour nourrir les 400 élèves du collège Yvon Delbos avec du 100 % fait maison, y compris carné, un nouvel agent a été intégré à l’équipe : Anthony, formé en boucherie-charcuterie. « Depuis septembre, on fait rentrer des bêtes entières, principalement des agneaux et des cochons, avec lesquels on fait nos saucisses, nos pâtés… » explique-t-il. Et le jambon du jour, donc. « On fait beaucoup de cuisson de nuit. On a remis au cœur le métier de cuisinier », estime Anthony.
Parmi les fournisseurs de viande, la ferme familiale Biobeef, située à une dizaine de kilomètres, qui vend également des vaches entières à un restaurant gastronomique. « Les établissements scolaires nous prennent en général une cinquantaine de kilos, soit 5 à 10 % des ventes. On leur propose du bourguignon, de la viande hachée, des saucisses… » décrit Louis Deltreuil, qui élève avec son père une centaine de vaches limousines et produit 20 tonnes de blé, transformé en farine pour six boulangeries.
Au départ producteur de lait en agriculture intensive, le père Deltreuil s’est converti au bio il y a plus de 20 ans. « Les gens n’y croyaient pas du tout, personne ne voulait lui vendre des terres, il a fallu batailler », raconte Louis. Aujourd’hui, plus d’intermédiaire : « C’est nous qui fixons le prix. Ceux à qui ça ne convient pas n’achètent pas. » Un cercle économique vertueux dans lequel se retrouvent aussi les établissements : au collège Yvon Delbos, le coût par plateau serait de 2,10 euros, ce qui correspond à la moyenne de la région et reste même inférieur au prix précédemment en vigueur dans l’établissement, selon Nicolas Lamstaes.
Des investissements conséquents ont toutefois dû être réalisés dans chacune de ces cantines, où le département (à majorité de gauche, présidé par le PS) a financé 100 000 euros de travaux pour adapter le matériel, et pouvoir cuisiner les produits bruts. « Quand les producteurs tuent une bête, ils nous appellent. Pareil si l’un d’eux doit ramasser ses salades car il va geler », décrit Cécile Beau, qui fait le lien avec des agriculteurs qu’elle a parfois vu grandir. Louis Deltreuil est un ancien élève de Montignac, comme l’ensemble de ses frères, dont un est encore au collège : « Il est content de pouvoir dire à ses copains que la viande qu’ils mangent vient d’ici ! »
Les parents invités à manger à la cantine
Pour impliquer au maximum les élèves et leurs parents dans cette transition, l’équipe a redoublé d’efforts : il existe une instance de représentation des élèves et une « commission menu » a notamment été créée pour les faire intervenir dans les choix. Cela passe aussi beaucoup par l’éducation au goût : « Demain, on fait du potimarron grillé. Je vais en garder un entier et l’exposer sur le self pour montrer aux élèves à quoi ça ressemble », explique Cécile Beau.
Un travail de pédagogie et de communication plus que nécessaire, si l’on en croit la principale du collège, Marie-Pierrre Leclère-Guillomo. « Il y a quand même eu des résistances que je n’avais pas anticipées. Il y a des préjugés qui ont la peau dure et on est sur un territoire rural, avec des agriculteurs en conventionnel qui rencontrent des difficultés et se sentent exclus », rapporte-t-elle.
Les parents ont été invités à manger à la cantine et ont récemment été conviés à un marché de producteurs. « Ça se passe mieux, mais les élèves, eux, ne sont pas toujours satisfaits », reconnaît la principale. « Les élèves sont pires que le Guide Michelin. Au niveau des critiques, ils se lâchent ! », s’amuse Nicolas Lamstaes. Cécile Beau ajoute : « Si vous leur dites que dans la sauce tomate de la pizza de ce midi il y a des lentilles corail et du vert de poireau, ils ne vont pas la manger. »
Le scandale de l’année dernière ? La disparition des frites, à cause d’un anti-moussant potentiellement cancérigène dans les huiles. Elles ont été remplacées par des potatoes au four et des pommes de terre sarladaises, grande spécialité du coin. Pas sûr que cela suffise à convaincre l’ensemble des élèves. Alors que pas mal de plateaux reviennent à moitié remplis, un élève de 4e s’étrangle toutefois : « On n’a plus de frites ! C’était meilleur avant. » Pire : « Un jour, on a même eu de la pizza avec des lentilles ! »
D’autres sont très satisfait·es. En 4e, Naël et Romuald, qui font partie de la quarantaine d’élèves végétariens à qui il est quotidiennement proposé un plat adapté, se réjouissent de la variété des aliments. Pareil pour Larra, Marylou et Lucie, qui finissent leurs assiettes.
Aroztegiaren silogismoa
Iñaki Barcena
www.argia.eus/argia-astekaria/2905/aroztegiaren-silogismoa
Article
Silogismo baten argumentuak hiru proposizio ditu, eta horietatik azkena nahitaez ondorioztatzen da beste bietatik. Logika deduktibo horrekin aztertu daiteke, nire aburuz, Nafarroan gertatzen ari den Aroztegiako gatazka sozioekologiko luze eta traumatikoa.
Tesia: Baztango Lekaroz herri txikian (289 biztanle, 2022an) Palacio de Arosteguia SL enpresak (Hilton multinazionalaren atala) makroproiektu urbanistiko bat egin nahi du. 228 txalet, hotel bat 129 gelarekin eta golf zelai bat. Horretarako 45 nekazaritza hektarearen birkalifikazioa lortu zuen eta obrak 2021ean, pandemia garaian, hasteko asmoa zuen. Proiektu horren alde agertu dira UPN, PSN eta Geroa Bai.
Antitesia: baztandar ugari agertu da proiektuaren aurka. Epaitegietan, Udalean, Mankomunitatean eta kalean. Pare bat erreferendumek (Lekarozen 2009an eta Baztanen 2016an) argi utzi dute bertoko herritarren borondatea eta iritzia. Baina 2021eko apirilean obrak hastear zirenean, zuhaitzen mozketak eta hondeamakinen lanak geldiarazteko desobedientzia zibila antolatu behar izan zuen Aroztak taldeak, ehunka lagun gazteekin batera. Eta obrak bertan behera gelditu ziren.
Euskal ekologismoaren eta beste herri mugimenduen erantzun bateratua inoiz baino beharrezkoagoa da. Aroztegia dugu adibidea
Sintesia: merkatu askatasuna eta estatuaren autoritatea desobeditzen eta errefusatzen direnean… errepresioa eta zigorrak dira botika arrunta. Eta ohikoa da buru batzuk bereiztea ere, kalteak ereduzko moduan ordaintzeko. Enpresak 43 milioi euroko kalte-ordaina exijitzen du eta Nafarroako Auzitegi Gorenak hogei urteko kartzela eta 56.000 euroko isuna eskatzen ditu zazpi auzipetuentzat.
Joan den otsailaren 1ean Iruñean egon ginenok mezu sendo bat jaso genuen: “Ez dira zazpi, herri bat gara”. Eta kalean milaka lagunen giza-gorputz-luze horrek ez zuen duda izpirik ematen: herri baten erantzun sendoa eta zuzena, enpresarentzat eta administrazioarentzat. Aspaldiko partez, ohikoak izan dira euskaldunon erantzun kolektibo anti-errepresiboak, gure aktibisten kontrako erasoen aurrean. Horrek herri bizidun egiten gaitu.
Krisi ekosozialaren garai gogorrean bizi gara eta estatu kapitalistaren eta merkatuaren kolpeak ez dira baretuko, aldiz, bizitzaren aurkako proiektu zerrenda handitzen ari da euren agenda nekropolitikoan, azken egitasmoak armagintzan eta energia nuklearrean (Zedarriak txostena).
Euskal ekologismoaren eta beste herri mugimenduen erantzun bateratua inoiz baino beharrezkoagoa da. Aroztegia dugu adibidea.