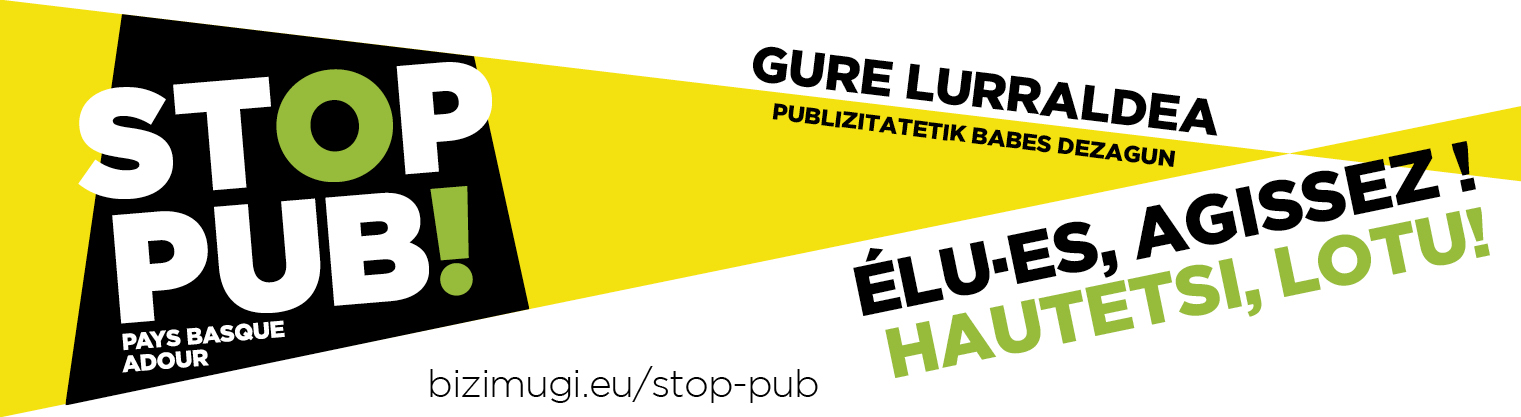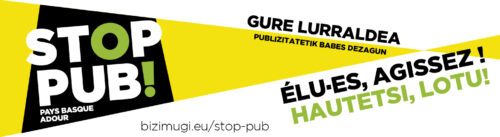Europa, azkarren berotzen ari den kontinentea
Jon Torner Zabala
www.argia.eus/albistea/klima-europa
Article
Berotegi gasen emisioak eta atmosferaren kutsadura murriztu egin diren arren, ingurumenaren egoera ez da ona Europan, kontuan harturik naturaren degradazioak, gehiegizko ustiapenak eta biodibertsitatearen galerak dakartzaten ondorioak, Europako Ingurumen Agentziak bost urtean behin lantzen duen txostenean jaso duenez.
Europa da, hain justu, azkarren berotzen ari den kontinentea, batez bestekoa baino bi bider azkarrago, txostenean bildutako datuen arabera. « Klima erritmo kezkagarrian ari da aldatzen, eta hori arriskua da segurtasunerako, osasun publikorako, ekosistemetarako, azpiegituretarako eta ekonomiarako », azaldu du Ingurumen Agentziak. 38 herrialdetan bildutako datuak aztertu dituzte, eta ondorioztatu dute biodibertsitate galerak harremana duela ustiapen ez jasangarriak eta kontsumo ereduek egiten duten presioarekin. Hori horrela, agentziak uste du nekez beteko direla 2030erako jarritako helburuak.
Halaber, nabarmendu du prezipitazioen larritasuna areagotzen ari dela, azken urteotako uholdeek erakusten duten moduan. Besteak beste, 2023an Eslovenian eta iaz Valentzian gertatutakoak ekarri ditu gogora txostenak. Baliabide hidrikoei dagokienez, Europako lurraldearen eta biztanleen herenak ur falta dutela azaldu du agentziak, eta laborantza eredua dela horren eragile nagusia: « Pestizidek uraren kalitatea okertzen dute, algen gehiegizko hazkundea sustatu, oxigenoa agortu eta uretako bizitzan eragin ».
Datu mordoa jaso dute bost urtean behin plazaratzen den txostenean. Esaterako, muturreko tenperaturen gorakadagatik gutxienez 70.000 pertsona hil ziren 2022an, Europa hegoaldean sute ugari gertatzen ari diren bitartean. Gainera, lehorteek geroz eta kalte handiagoak eragiten dituzte elikagaien produkzioan, energia-sarean edota ur hornidura publikoan. Bestalde, klimarekin lotutakoek 738.000 milioi euroko galerak eragin dituzte 1980 eta 2023 artean –eta kopuru horretatik %22, 2021 eta 2023 artean–.
Proposatutako konponbideen artean daude, bestalde, habitatak biziberritzea, garraioena bezalako sektoreak deskarbonizatzea, laborantzako emisioak murriztea, trantsizio berde eta digitalean inbertsioak egitea eta ekonomia zirkularra bultzatzea, hori guztia Europako Itun Berdeak jasotakoak ardatz hartuta.
Au lieu de baisser, les émissions de gaz à effet de serre stagnent en France
Mickaël Correia
www.mediapart.fr/journal/ecologie/101025/au-lieu-de-baisser-les-emissions-de-gaz-effet-de-serre-stagnent-en-france
Article
L’organisme chargé de mesurer les rejets carbonés estime qu’au premier semestre, les émissions françaises sont restées stables. Elles pourraient diminuer d’à peine 0,8 % en 2025. Ces chiffres sont très en deçà des engagements climatiques du pays, des objectifs contraignants que l’État doit respecter.
Ce sont des chiffres qui incarnent l’inaction climatique du gouvernement. Et qui résonnent terriblement après les canicules et les mégafeux qu’a subis la France cet été.
Ce 10 octobre, le Citepa, association chargée par le ministère de l’écologie de mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays, a publié ses pré-estimations pour le premier semestre 2025. L’organisme estime que, durant les six premiers mois de cette année, nos rejets carbonés sont « relativement stables », en comparaison du même semestre 2024. Après une hausse de 0,9 % au premier trimestre, nos émissions ont diminué de 2,5 % au deuxième trimestre.
Sur l’ensemble de l’année 2025, le Citepa consolide une première estimation livrée en juillet dernier, à savoir une réduction de nos émissions annuelles d’à peine 0,8 % par rapport à 2024.
Ce ralentissement inquiétant fait suite à une baisse de notre rythme de décarbonation qui avait débuté en 2024 avec une diminution de nos émissions de 1,8 % en 2024, contre 6,8 % en 2023 et 3,9 % en 2022. Cette estimation pour l’année 2025, est, selon le Citepa, « très en deçà » du rythme nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques d’ici à 2030, fixés à environ − 5 % par an. Si ce chiffre se confirme, la France devra multiplier par six ses efforts de décarbonation pour maintenir sa trajectoire climat sur les rails.
En juillet dernier, le Haut Conseil pour le climat (HCC) pointait déjà dans son septième rapport annuel un fort ralentissement de la baisse de nos émissions et s’alarmait que ces mauvais résultats soient concomitants avec l’intensification des catastrophes climatiques en France – le réchauffement mesuré dans l’Hexagone a déjà atteint les + 2,2 °C sur la période 2015-2024.
« Nous avions déjà noté entre 2023 et 2024 un affaiblissement du pilotage de nos politiques climatiques et indiqué que, sur la baisse de 1,8 %, environ 70 % étaient dus à des facteurs conjoncturels et non à des effets de politiques climatiques structurelles. La situation pour 2025 n’est donc pas une surprise », indique auprès de Mediapart Valérie Masson-Delmotte, climatologue et membre du HCC.
Le déni climatique du gouvernement
D’après le Citepa, au premier semestre 2025, l’industrie manufacturière et de construction a diminué ses émissions de 4,33 %, et le secteur des transports, de 1,3 %, par rapport à la même période en 2024.
Les rejets carbonés liés à l’usage des bâtiments ont eux augmenté de 1,5 % (contre − 5 % sur le premier semestre 2024), et dans l’agriculture de 1,3 %. Les émissions dues à la production d’énergie sont, de leur côté, quasiment stables.
« La production d’énergie a déjà réalisé des baisses record ces deux dernières années (− 7 % entre 2022 et 2023 et − 4 % entre 2023 et 2024) qui s’expliquent principalement par l’évolution du mix énergétique et donc par des évolutions structurelles, a précisé à Mediapart le Citepa. Il demeure des secteurs prépondérants en termes d’émissions, comme le secteur des transports (qui représente environ un tiers aux émissions au plan national), qui constitue ainsi le principal levier de décarbonation. »
Alors que l’Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite au monde et que Paris est la capitale européenne la plus mortelle en cas de vague de chaleur, ce décrochage alerte aussi sur la procrastination climatique du gouvernement. Le budget 2025, qui a été construit par les gouvernements Attal à l’été 2024, Barnier à l’automne et Bayrou cet hiver, a sabré dans les dépenses publiques vectrices de transition écologique. Le Parlement a quant à lui, ces derniers mois, attaqué des mesures environnementales phares comme les zones à faibles émissions et le « zéro artificialisation nette ».
« On voit qu’il y a un réel enjeu à relancer une action climatique structurante et efficace ainsi qu’un cap tenu dans la durée. C’est un enjeu pour la réputation et la crédibilité de l’action de la France : le pays hôte de l’accord de Paris sur le climat de 2015 risque de ne pas respecter ses propres engagements climatiques », se désole Valérie Masson-Delmotte.
Contacté par Mediapart, le cabinet de la ministre démissionnaire de l’écologie Agnès Pannier-Runacher a répondu que cette dernière s’exprimerait à ce sujet vendredi 10 octobre en début de journée.
Le 23 juillet, la Cour internationale de justice a rendu un avis consultatif sans précédent soulignant que les pays sont juridiquement responsables de leurs émissions de gaz à effet de serre. En somme, depuis cet été, le non-respect par un État de ses engagements climatiques peut constituer un fait internationalement illicite.
Compenser ses émissions de CO₂ est inefficace pour réduire le réchauffement climatique
Audrey Garric
www.lemonde.fr/planete/article/2025/10/10/les-credits-carbone-inefficaces-pour-reduire-le-rechauffement-climatique_6645549_3244.html
Article
Une vaste revue de littérature montre que l’impact climatique des projets financés par les crédits carbone est très largement surestimé.
Les uns y voient une solution pour le climat, les autres un outil de greenwashing. En réalité, la compensation carbone n’est, pour l’instant, pas parvenue à réduire le réchauffement climatique. Cet échec est moins dû à « quelques brebis galeuses » qu’à des « problèmes systémiques profondément enracinés », que des changements progressifs ne suffiront pas à résoudre. Des failles « probablement insolubles », conclut la plus vaste revue de littérature sur le sujet, publiée dans le numéro d’octobre de la revue Annual Review of Environment and Resources.
« Les crédits carbone ne constituent pas un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre mondiales à l’échelle et à la vitesse nécessaires pour éviter les pires effets du changement climatique », explique le climatologue Joseph Romm (université de Pennsylvanie), premier auteur de l’étude, qui a passé en revue plus de 200 études, ouvrages ou rapports portant sur les vingt-cinq dernières années. « Ils risquent, en outre, de retarder les véritables mesures climatiques en promettant une fausse solution qui maintient le statu quo », ajoute-t-il.
Sur le papier, l’idée de la compensation carbone est simple : des pays, souvent développés, et des entreprises cherchent à compenser une partie de leurs émissions en achetant des crédits carbone à d’autres Etats, souvent en développement, où l’action climatique est moins onéreuse. Avec l’argent économisé, les pays riches peuvent, en théorie, rehausser leur ambition. Et ces transactions drainent des revenus dans les pays du Sud.
Forte croissance
Les crédits carbone sont générés par des activités qui réduisent ou évitent les émissions de gaz à effet de serre, ou encore retirent le CO2 déjà présent dans l’atmosphère. Il s’agit par exemple de plantation d’arbres ou de remplacement d’énergies polluantes (à l’instar du charbon) par des énergies renouvelables (l’éolien ou le solaire). Chaque quota équivaut à une tonne de CO2 en moins.
Ces crédits ont connu une très forte croissance depuis le milieu des années 2000, devenant ensuite incontournables lorsque nombre de pays et d’entreprises se sont engagés à atteindre la neutralité carbone. Au total, plus de 5,2 milliards d’entre eux ont été émis, sur des marchés réglementaires, qui permettent aux pays de tenir leurs objectifs climatiques, ou sur un marché volontaire, notamment pour les entreprises. Sur ce dernier, les échanges de crédits ont atteint le record de 2 milliards de dollars en 2021 (1,7 milliard d’euros actuels), avant une chute massive liée à la révélation, par des scientifiques et des médias, de scandales sur la compensation.
Les crédits carbone de mauvaise qualité sont « endémiques » sur tous les marchés, préviennent les auteurs de l’étude. De nombreuses recherches ont montré que les impacts climatiques des projets sont surestimés par un facteur de cinq à dix, voire plus. Une méta-analyse publiée en 2024 dans Nature montrait par exemple que seuls 16 % des crédits carbone étudiés engendraient réellement une réduction des émissions.
« D’importantes fuites »
Dans la majorité des cas, il est également impossible de prouver que le projet générant un crédit carbone est additionnel, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas eu lieu dans tous les cas. La compensation carbone provoque aussi d’importantes « fuites » ou déplacements d’émissions. Par exemple, si un propriétaire se voit payé pour ne pas couper ses arbres, les entreprises locales de bois déforesteront ailleurs.
Un autre enjeu réside dans la permanence du stockage du carbone : comment s’assurer que le CO2 évité ou éliminé le sera bien sur une période assez longue pour ne pas contribuer au réchauffement, entre cent et mille ans ? Le risque est grand, notamment pour la plantation d’arbres, menacés par les ravageurs, incendies ou sécheresses. Une étude réalisée en 2021 auprès de 174 organisations ayant mis en terre plus de 1 milliard d’arbres a révélé que seulement 18 % d’entre elles réalisaient un suivi postplantation, et 5 % évoquaient le taux de survie de leurs arbres.
Les crédits carbone peuvent générer des bénéfices (emplois, sources de revenus, etc.) pour les communautés locales. Mais nombre d’études montrent que les projets voient leurs impacts positifs surestimés, et peuvent s’accompagner de violations des droits humains, comme des déplacements forcés de populations, un accès à l’eau compromis ou des conflits fonciers.
Assainir le marché
Des efforts sont actuellement fournis pour assainir le marché. Des exigences et méthodologies plus strictes ont été édictées par des experts. Mais elles sont encore peu respectées et les gros acheteurs privilégient souvent les crédits carbone de moindre qualité, car moins chers.
En 2024, à la COP29, les pays ont arrêté de nouvelles règles régissant les échanges d’émissions de CO2 entre pays et entreprises. L’idée était d’éviter de reproduire ces écueils grâce à des garde-fous, par exemple pour éviter le double comptage des réductions d’émissions par l’Etat vendeur et l’acheteur. « Mais les nouveaux mécanismes conservent bon nombre des caractéristiques très problématiques de leurs prédécesseurs, note l’étude. Parmi celles-ci figure l’absence relative de mécanismes d’application ou de sanctions qui dissuaderaient les parties de vendre ou d’acheter des crédits douteux ou frauduleux. »
« Cette étude fournit un aperçu général précieux des problèmes affectant les projets de crédits carbone », réagit Benedict Probst, chercheur au Max Planck Institute for Innovation and Competition, qui n’a pas participé à cette publication. Il regrette toutefois qu’elle ne comprenne pas d’évaluation critique des « forces et des faiblesses » des études analysées.
Les scientifiques de la revue de littérature appellent à maintenir des crédits carbone pour les quelques actions climatiques qui y sont adaptées, comme la fourniture de cuisinières plus propres ou la capture du méthane provenant des décharges. « De nombreux autres projets, tels que la construction d’énergies renouvelables, la protection et la restauration des forêts ou l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, devraient être financés autrement », assure Stephen Lezak (université de Californie à Berkeley), l’un des auteurs.
Ils encouragent également les Etats et les entreprises qui achètent encore des crédits carbone à ne pas prétendre qu’ils annulent leurs propres émissions, mais plutôt parler de contribution à la lutte contre le réchauffement climatique.
Climat : « Le socle ayant permis l’existence de nos civilisations s’effondre »
Vincent Lucchese
https://reporterre.net/Climat-Le-socle-ayant-permis-l-existence-de-nos-civilisations-s-effondre
Article
Les discours politiques sont imperméables aux idées de rupture, alors que la Terre atteint ses points de bascule, selon le chercheur Nathanaël Wallenhorst. Il en va pourtant de notre survie, explique-t-il.
Dans un livre publié le 19 septembre, intitulé 2049 — Ce que le climat va faire à l’Europe (éditions du Seuil), Nathanaël Wallenhorst présente une synthèse scientifique alarmante des nombreuses menaces qui pèsent sur le système Terre et du risque de voir « les sociétés humaines explosées par les ruptures que nous créons sur la Terre ».
Il souligne à quel point nous sous-estimons le danger que représentent les points de bascule. Ces changements drastiques et irréversibles dans les équilibres climatiques, provoqués par le dépassement d’un certain seuil de température, pourraient remettre en question jusqu’à la viabilité même de nos sociétés.
Chercheur en sciences de l’environnement et doyen de la faculté d’éducation de l’Université catholique de l’Ouest, à Angers, Nathanaël Wallenhorst est également membre de l’Anthropocene Working Group, un groupe international de chercheurs interdisciplinaire chargé de déterminer si, et quand, l’Anthropocène a débuté, en tant qu’époque géologique.
Reporterre — En quoi la menace des points de bascule remet-elle, selon vous, radicalement en cause toutes les approches néolibérales et capitalistes des politiques climatiques ?
Nathanaël Wallenhorst — Il suffit de s’en tenir aux faits, de regarder les études scientifiques. Les politiques de transition actuelles sont totalement inefficientes pour contenir l’emballement du système Terre. Si l’on adopte un point de vue systémique, il devient évident qu’espérer ou promouvoir la croissance économique est complètement irrationnel. La décroissance n’est pas une orientation idéologique ou politique, c’est une évidence biogéophysique.
La plupart des économistes ont construit des modèles complètement déconnectés du réel. Même lorsque des économistes ont cherché à intégrer l’impact des points de bascule climatiques à leurs modèles, comme dans les travaux de Simon Dietz, de la London School of Economics, et ses collègues, ils arrivent à la conclusion que ces basculements réduiraient la consommation d’environ 1 %. Alors que l’on parle de choses capables de déstabiliser les fondements mêmes de notre civilisation.
Un tel niveau d’incompréhension et de décalage est dingue. Les modélisations économistes orthodoxes sont imperméables aux idées de rupture, de limitation et de fracassement qui nous attendent.
À quel point sommes-nous au bord du gouffre, d’après vous ?
La mère de toutes les menaces, c’est la question de l’eau. Beaucoup de points de bascule menacent le cycle de l’eau et la cryosphère. Or, l’eau irrigue tous les fondements de nos sociétés. L’agriculture, l’hygiène, l’économie : les pénuries d’eau à venir peuvent gripper toute la machine. Les conséquences des pénuries d’eau sont immédiates avec la faim, la peur, l’accaparement, les déstabilisations politiques et géopolitiques, les risques de guerre, etc.
Les risques de point de bascule sont multiples, de nombreuses dimensions doivent être articulées en même temps. L’étude de 2018 de Will Steffen et son équipe évoque un seuil vers 2 °C de réchauffement, voire dès 1,5 °C, avec un emballement possible vers une « Terre-serre » ou « Terre-étuve » difficilement vivable. On ne sait pas exactement où est le seuil, mais on se situe à ce moment de bifurcation du système Terre.
Comment appréhender la part d’incertitude qui entoure notre compréhension de ces phénomènes, et éviter que celle-ci serve de prétexte à l’inaction ?
Chaque phénomène, pris isolément, comprend des incertitudes quant à la chronologie précise à venir. Il n’y a pourtant aucun doute sur la dynamique globale. C’est un peu comme le lait sur le feu : si l’on allume le gaz sous la casserole et que l’on oublie de la surveiller, il existera une incertitude sur le moment où le lait débordera. Pour autant, on est certain qu’il finira par déborder.
Si l’on regarde le tableau général : la perturbation du cycle de l’eau, la désoxygénation des océans, la fragilisation de la pompe océanique du carbone et du plancton, la fonte du pergélisol, les menaces de bascule des systèmes forestiers septentrionaux, de toute l’Amazonie, la destruction des coraux, la fonte des glaciers du « troisième pôle » himalayen, les menaces d’effondrement en Antarctique, l’effondrement de la biodiversité, etc., on voit bien se dessiner une dynamique très forte.
Vous écrivez que l’existence même de notre civilisation pourrait être menacée.
La civilisation s’est développée alors que nous vivions, depuis environ 12 000 ans, dans l’Holocène, une période caractérisée par sa stabilité et sa prévisibilité. Il y avait quelques variations climatiques, d’environ 1 °C en plus ou en moins maximum, mais cette stabilité et cette prévisibilité générales sont une des explications du développement des civilisations : elles ont permis la maîtrise des écosystèmes, le développement de l’agriculture puis d’excédents agricoles, le commerce, etc.
L’Anthropocène décrit la sortie de cette stabilité et, surtout, l’entrée dans un régime climatique de plus en plus imprévisible, avec des extrêmes exacerbés. Cela n’a rien à voir avec les causes de l’effondrement de certaines civilisations par le passé. Aujourd’hui, c’est le socle même ayant permis l’existence de toutes les civilisations qui s’effondre.
Votre analyse vous rapproche-t-elle de celle des collapsologues ? On a beaucoup reproché à ce courant d’être fataliste et dépolitisant…
Je ne suis pas collapsologue. Par ailleurs, je ne me retrouve pas du tout dans certaines approches fascinées par le morbide et la fin du monde. Mon approche est scientifique. Elle repose sur un savoir pluridisciplinaire et une base de données de plusieurs milliers d’articles que j’articule entre eux. Comme, par exemple, celui publié dans le journal de l’Académie des sciences des États-Unis en 2022 qui pose concrètement sur la table la question de l’extinction possible de l’humanité.
Ce que nous dit la recherche, c’est que nous sortons de la niche climatique ayant permis l’existence des civilisations. Nos sociétés sont présentes partout sur le globe, mais dans des lieux où la température moyenne reste comprise entre 11 et 15 °C. Ce sont les conditions qui permettent de produire une agriculture capable de nourrir le monde. D’ici 2070, 3 milliards de personnes risquent de sortir de cette niche climatique et devront migrer, avec le lot de déstabilisation que cela implique.
Ce sont les sciences du système Terre, sur la base de données rigoureuses, qui démontrent l’impossibilité pour nos sociétés de perdurer si l’on continue sur notre trajectoire actuelle, sans changement radical. Ce sont à l’inverse les récits technosolutionnistes, ou les idées selon lesquelles « l’Homme s’est toujours adapté », qui relèvent de la croyance sans fondement.
Qu’entendez-vous par « changement radical » ?
Il est nécessaire de décarboner extrêmement rapidement nos modes de vie. En France, il faut passer de 9 à 2 tonnes d’émissions de CO2 par personne. En simplifiant, cela signifie de diviser par cinq notre consommation et notre production, c’est-à-dire notre salaire. Il faut créer un monde où l’on peut vivre de manière digne avec l’équivalent de 500 euros par mois. Il faut absolument tout réinventer dans la manière de se nourrir, se loger, faire société. Et si l’on souhaite rester dans un cadre démocratique, ce qui est mon cas, il faut rendre désirable une telle limitation. Nous n’avons pas le choix : nos démocraties doivent s’encastrer dans les limites planétaires.
Les gens ne sont pas idiots. Nous avons en ce moment un réel problème avec nos élites et dirigeants, des Trump, Musk, Bolloré et même Macron. Il faut à la fois esquiver les récits mensongers ou pervers, comme ceux de Macron qui dit une chose et fait l’inverse, les récits technosolutionnistes californiens, les récits autoritaires comme en Chine et les récits bisounours du « chacun doit faire sa part ». Et inventer des récits alternatifs pluriels et radicaux.
Nous suivons une trajectoire antinomique à celle que vous préconisez. Une bifurcation radicale de la société est-elle encore possible dans les temps impartis ?
Les climatologues, comme Valérie Masson-Delmotte, répètent souvent que chaque dixième de degré compte. C’est très important pour les points de bascule. Certains sont franchis sur une temporalité très longue. Si le réchauffement est un peu ralenti, on conserve davantage de chance d’inverser certains phénomènes avant qu’ils ne deviennent irréversibles.
Mon état d’esprit est de continuer à me battre jusqu’au bout. Je veux croire qu’une bascule est possible, bien que je quitte ici le domaine des sciences et entre dans celui de la croyance que je critique par ailleurs. Mon espoir et qu’il puisse y avoir une bascule sociale soudaine et imprévue comme cela peut arriver dans l’Histoire, un peu comme lorsque le mur de Berlin est tombé.
Beaucoup de choses bougent dans la société sans, pour l’instant, faire système. La littérature scientifique se penche sur cette notion de point de bascule social. Il y a du mouvement dans la société, des acteurs dont les actions pourraient se mailler les unes aux autres pour finir par entraver la marche des choses. C’est pourquoi je crois encore à la possibilité de transformations radicales et démocratiques.
Délia Delanne, accord terre-mer
Malika Peyraut
www.enbata.info/articles/delia-delanne-accord-terre-mer/
Article
Izena duenak izana du, ce qui se nomme existe. Elles assurent la logistique en base arrière ou sont en tête de proue, s’occupent des enfants ou d’une entreprise, suivent le collectif ou s’en émancipent, et parfois tout à la fois. Enbata a voulu, par une série de portraits, contribuer à rendre visible le rôle des femmes dans le mouvement abertzale. Chacune aborde son parcours personnel, entremêlé avec le combat collectif, sa vision de l’abertzalisme, la place des femmes dans le militantisme : chaque portrait est un point de vue, aussi subjectif qu’universel.
Cette série de portraits est illustrée par Sabina Hourcade.
Elle se doutait qu’on allait lui faire le coup du cliché de “la biarrote qui vit à Garazi”. En même temps, le parcours de Délia Delanne, née en 1996 dans une famille de surfeurs francophones de Biarritz et partie s’installer à Garazi, où elle vit en euskara et coordonne Lurrama, est un véritable trait d’union, qui relie les éléments, les milieux, les langues, et raconte probablement quelque chose du futur d’Euskal Herri. Une bonne façon de conclure cette série de portraits.
Laisser passer la vague
Chaque famille a ses marottes : dans celle de Délia, il semblerait que ce soit le sport. Sa grand-mère paternelle (une Hiriart de Sare) l’enseigne. Ses parents, surfeurs, ont choisi de vivre quartier Milady à Biarritz, face à la plage, pour mettre la fratrie des 3 enfants à l’eau. Entre la filière sport-étude surf où elle est inscrite dès le collège, les surfs trips à travers le monde en famille et les compétitions, il aurait été facile de croire la ligne de la benjamine toute tracée. “Pourtant j’ai su rapidement que je ne voulais pas en faire mon projet professionnel. C’est compliqué pour une femme de vivre du surf. Souvent on attend d’elles qu’elles travaillent leur image tout autant que leur technique parce qu’on a le cliché de la surfeuse en maillot de bain.” Pas de cliché, donc. Délia est résolue : “Je n’avais pas envie de faire ma vie en fonction des vagues.” Elle s’essaye aux études d’architecture, comme son père, se réoriente vers la géographie, à Bordeaux, et lorsque le covid gèle le monde, elle achève son M2 par un stage à la CCI de Bayonne. Une certitude : elle veut rester en Euskal Herri, près de la famille et de la mer. La période d’entre-deux du covid coïncide avec l’entre-deux de la fin des études : qui sait si, sans cet alignement, elle aurait réussi à partir en barnetegi ? Alors qu’elle n’entend pas l’euskara à la maison, elle décide d’entamer une formation immersive à Lazkao. “Mon amatxi était euskaldun, elle m’avait transmis certaines valeurs liées à cette terre. Mais vivre ici au Pays Basque, sans parler l’euskara, me donnait l’impression de passer à côté de quelque chose.”
Appartenance
Maîtriser l’euskara lui ouvre de nouvelles portes. Maintenant, elle comprend les chants, les spectacles. “En août, j’ai été à la pastorale de Barcus, qui raconte l’histoire militante des dernières décennies. C’est passionnant de voir que plein de gens se sont mouillés pour faire avancer les choses.”
Délia non plus ne restera pas longtemps au sec : sortie de l’océan, elle se retrouve plongée dans le grand bain du militantisme. Si l’euskara est un sésame vers la culture, elle découvre que ça l’est également pour le travail. Elle à qui aucun employeur n’avait répondu se retrouve retenue pour trois entretiens dès sa sortie de barnetegi. Elle découvre alors EHLG et le monde paysan. Elle s’installe à Garazi, nage entre les sigles, se forme aux enjeux.
À tout juste 25 ans, elle se retrouve coordinatrice de Lurrama : 1000 bénévoles, une soixantaine de responsables, 25 000 visiteurs par an. “Je ne me rends pas toujours compte de la responsabilité qui vient avec ce poste, parce qu’on n’est jamais seuls pour l’organisation et la prise de décision. J’ai découvert le monde militant, où les gens se donnent à fond, mais avec l’esprit gai. Ils apportent au collectif, et le collectif leur apporte de la joie. Militer, c’est faire partie de quelque chose.”
C’est amusant comme l’abertzalisme se définit souvent par l’altérité : on lui dit “bien sûr que tu es abertzale”. Délia, elle, se méfie des étiquettes, et préfère juger sur pièce. La “patrie” ? Des idées, surtout : l’importance de décider à l’échelle locale, par les gens du territoires; un modèle agricole, l’agriculture paysanne; la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes; la langue.
Renouveau
“Une fois qu’on est tombés dans le militantisme, on n’en ressort pas, de toute façon, non ?” Délia est de la nouvelle génération, celle où on milite autrement. Les postures sacrificielles, très peu pour elle. Celle qui fait des infidélités au surf en allant courir dans la montagne sait que, pour que la course soit longue, il faut gérer son rythme. Elle apprécie la gestion d’EHLG, où les heures sont comptées et celles qui dépassent, récupérées. “C’est peut-être lié à la mobilité ou à l’information. Aujourd’hui, les gens revalorisent le temps libre, la vie personnelle. C’est un sujet qui monte, même dans le monde paysan : à ELB gazte par exemple, ils abordent les questions des services de remplacement pour essayer de dégager du temps libre dans un travail qui demande beaucoup d’astreinte.”
La 20e édition de Lurrama se tiendra les 7, 8 et 9 novembre à la halle Iraty à Biarritz.
Elle garde de son stage en Corée le souvenir oppressant de ce logement au 16e étage d’un énorme immeuble, dans des chambres étriquées où la salle de bains partagée ne fermait pas à clé pour éviter les suicides. Que ce soit l’océan ou la montagne, Délia veut de l’espace. Quand elle retourne sur la côte, elle est saisie par le contraste : le rythme, les prix, la saturation. “Aller à la plage n’est plus du tout l’activité populaire qu’elle était autrefois. Si tu n’es pas blindé, tu restes chez toi. Et encore faut-il que tu aies un chez-toi…”
Terre mère
Délia est de la nouvelle génération donc, celle qui se demande quels défis il faudra affronter en Euskal Herri. Elle se questionne sur la mobilité (“En moins de cent ans, on s’est tous mis à avoir une voiture individuelle. L’enjeu maintenant, c’est de faire évoluer la mobilité, et ça n’est pas simple puisqu’on s’est habitués à faire de grandes distances, tout le temps.”), le surtourisme, le féminisme, le climat. Mais son sujet principal, c’est l’agriculture.
Elle fait sienne cette remarque selon laquelle le monde paysan ne peut pas fonctionner juste avec les paysans. “À Garazi, c’est plus simple d’avoir accès aux circuits courts. On est moins tentés par la surconsommation : c’est plus rapide parfois d’aller à la ferme que d’aller au supermarché. Il y a une forme de sobriété imposée. Un des enjeux de demain, c’est l’accès à une alimentation saine. Ce qui est vital, c’est boire et manger, et pourtant les gens mangent mal, sont malades. On le voit avec les débats sur la loi Duplomb. Or si on permettait aux gens de manger sainement, il y aurait plus de paysans. L’agriculture paysanne est un sacré levier pour améliorer le monde de demain, parce qu’elle touche à tout le reste : la langue, l’économie, la place des femmes, etc.”
Une langue, une terre, ses paysans. Lorsqu’elle a passé six mois dans la réserve de biosphère mapuche du nord de la Patagonie, pendant ses études, elle a été frappée par les résonances avec le Pays Basque. “Le mapudungun, la langue mapuche, est très liée à la terre. Comme au Pays Basque, où d’une certaine façon l’euskara est liée au monde paysan, est plus parlé dans l’intérieur. Défendre l’un, c’est défendre l’autre.”
Pour sa 20e édition, Lurrama met à l’honneur Euskal Herri et les paysannes et paysans de demain. Difficile de trouver un thème qui reflète mieux Délia, qui s’attache à tisser ce trait d’union entre différentes facettes d’un même territoire.