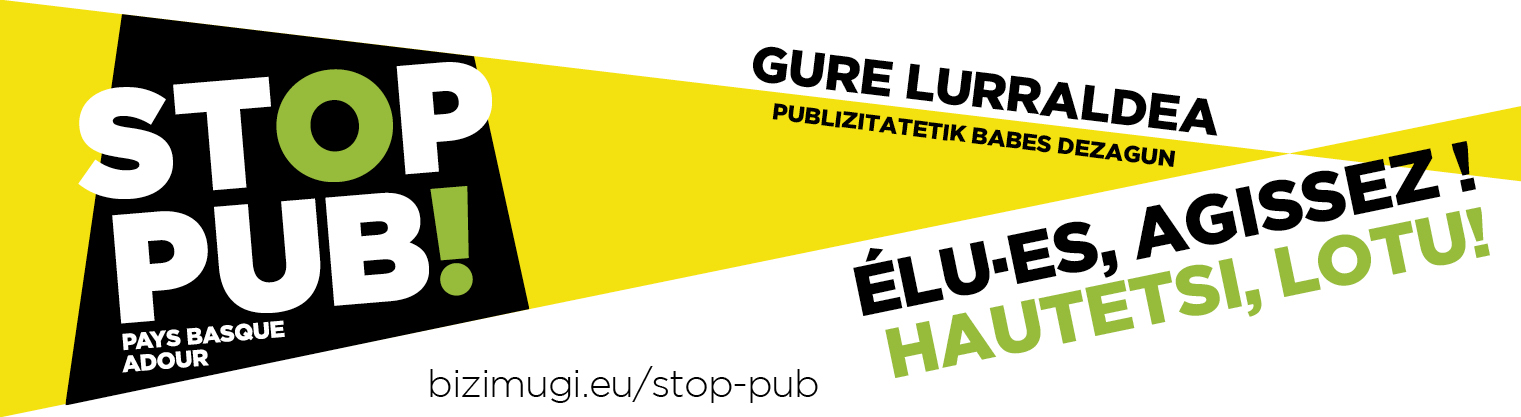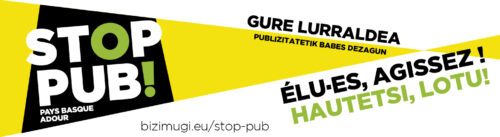COP30a hasi berri da eta dagoeneko porrot usaina dario
ELA INGURUMENA
wwww.ela.eus/eu/ingurumena/albisteak/cop30a-hasi-berri-da-eta-dagoeneko-porrot-usaina-dario
Article
Urtero bezala klima aldaketa geldiarazteko negoziaketak helburu dituen COP gailurra hasi berria da, oraingoan Brasilgo Belem hirian. Non eta Amazonian, planetaren birika deiturikoan, larrialdi klimatikoak esanahi berezia duen tokian. Eta munduko emisio handienen arduradun diren EEBB eta Txina gabe.
Aurtengo helburu nagusien artean larrialdiari aurre egiteko finantziazio handiagoa lortzea eta herrialde bakoitzak bere emisio murrizketak areagotzea daude. Hauez gain klima aldaketara egokitzeko neurriak adostea eta trantsizioa justua, hau da, pertsonak erdigunean jartzea, dira beste helburuetako batzuk.
Finantziazioaren puntua urterokoa izaten da. Klima aldaketa geldiarazteko eta bere eraginetara egokitzeko neurriak urtero milioika euro exijitzen ditu eta herrialde denek ez dutenez gaitasun bera, ezta klima aldaketan erantzukizun bera ere, herrialde bakoitzak zenbat diru jarri behar duen urtero negoziatu behar da. Aurretik esana doa ez dela sekula nahikoa diru biltzen eta herrialde aberatsenek ez dutela beraien arduraren pareko finantziaziorik mahai gainean jartzen. Aurten ere bide beretik joango direnaren susmoa dugu.
Bestalde, berotegi efektuko gasen isurien murrizketa konpromezuak areagotu behar dituzte mundu osoko estatuek. Parisko Akordioan 2015ean ezarri ziren murrizketa konpromezuak bost urtero eguneratu behar dira eta aurten egin beharra dago. 2025 urtean zehar ezagutarazi behar ziren konpromezu berriak, baina herrialde askok oraindik ez dituzte eguneratu. Europar Batasunaren kasuan, herrialde kide guztientzat helburu bera ezartzen da herrialde kide guztien artean adostuta.
EBren konpromezua 2030erako emisioak %55 murriztea (oinarri urtea 1990 izanik) zen orain arte. Orain 2040rako emisioak %90 murriztea (oinarri urtea 1990 izanik) adostu dute. Baina tranpa batekin. Murrizketaren %10 karbono merkatuan erositako isuri eskubideekin konpentsatu ahal izango dute, beraz, benetako murrizketa %80koa litzateke gehienez ere, eta konpromezuak betez gero beti ere. EBk Europako Klimaren Legean sartuko ditu murrizketa hauek orain, Europar Parlamentuan onartu ondoren.
Beti bezala, emisio murrizketak tartean direnean herrialde guztiek ahoz aipatutako anbizio eta konpromezuak paperean ez dituzte isladatzen. Hau da klima aldaketaren aurkako borrokan lidergoa omen duen Europaren jarrera. Beharrezkoa da mundu mailako negoziaketa bat ematea klima larrialdia bezalako arazo global bati aurre egiteko, baina negoziaketa hauek herrialde bakoitzak bere interesak bakarrik defentatuz egiten dituen bitartean ez da benetako soluziorik ahalbidetuko. Ez COP honetan, ezta hurrengoetan ere.
Au GIEC, une bataille très politique autour des dates de publication du prochain rapport d’évaluation
Audrey Garric
www.lemonde.fr/planete/article/2025/11/15/au-giec-une-bataille-tres-politique-autour-des-dates-de-publication-du-prochain-rapport-d-evaluation_6653549_3244.html
Article
Pour la quatrième fois en deux ans, les pays n’ont pas réussi à s’accorder sur le calendrier du rapport phare du groupe d’experts du climat. Certains pays veulent repousser sa parution pour amoindrir l’action climatique.
Alors que la conférence internationale sur le climat (COP30) se tient à Belem (Brésil) jusqu’au 21 novembre dans un contexte géopolitique tendu, la science du climat doit, elle aussi, composer avec les divergences stratégiques des Etats.
Fin octobre, les Etats membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui étaient réunis à Lima (Pérou), n’ont pas réussi à s’accorder sur les dates de publication du prochain rapport d’évaluation. Un point de procédure d’apparence banal, qui masque en réalité d’importants enjeux.
C’est la quatrième réunion en deux ans qui voit les discussions enlisées autour du calendrier du rapport phare de l’institution onusienne, l’état le plus complet de la science climatique. Une impasse qui souligne les tentatives politiques croissantes pour influencer l’expertise scientifique.
Les débats, du 27 au 30 octobre, ont été marqués par des « délibérations tendues » où des questions qui relevaient autrefois de la formalité sont devenues « profondément controversées », raconte le Earth Negotiations Bulletin, seul média autorisé à suivre les délibérations à huis clos. « Ce débat sur le calendrier est sans précédent dans l’histoire du GIEC », souligne la publication.
L’enjeu paraît, sur le papier, purement technique : il s’agit de fixer les dates de production, d’examen et d’approbation des trois volumes du septième rapport d’évaluation du GIEC. Ce calendrier doit être validé par consensus par les Etats, qui sont les membres du GIEC. Les coprésidents des trois groupes de travail de l’instance ont proposé que les rapports soient approuvés en mai, en juin et en juillet-août 2028, juste avant le deuxième bilan mondial de l’action climatique, fin 2028. Ce rendez-vous quinquennal prévu par l’accord de Paris est crucial : il évalue les progrès collectifs des Etats face au réchauffement climatique afin de faire avancer l’action.
« Affaiblir le sentiment d’urgence »
Mais cette articulation entre le calendrier scientifique du GIEC et celui de la diplomatie climatique divise profondément les pays. Une majorité – dont la France, l’Australie, Antigua-et-Barbuda ou les Bahamas – plaide pour une publication alignée sur le bilan mondial, afin d’éclairer les négociations climatiques avec des données scientifiques les plus à jour. C’est en effet le rôle du GIEC, une instance à l’interface entre science et politique.
A l’inverse, un groupe plus restreint mais croissant, mené par l’Inde et l’Arabie saoudite, demande un délai supplémentaire, jusqu’en 2029. Ces pays, qui comptent également la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud, la Libye et l’Algérie, ne souhaitent pas que le rythme de l’accord de Paris – des cycles de cinq ans – conditionne la production du GIEC, dont les rapports d’évaluation sont publiés tous les cinq à sept ans. Ils invoquent la charge de travail des délégations, le risque de nuire à la qualité des évaluations et l’enjeu de l’« inclusivité » – s’assurer notamment que les pays du Sud aient le temps et les moyens d’examiner les rapports.
En réalité, cet argument est surtout utilisé pour repousser ou amoindrir l’action climatique. Le prochain rapport d’évaluation s’annonce encore plus sévère que le précédent ; il paraîtra à un moment où l’humanité sera en train de franchir le seuil de + 1,5 °C de réchauffement, l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris.
« Certains pays tentent de saboter le GIEC non pas en contestant la science, mais en ralentissant son rythme », dénonce Valérie Masson-Delmotte, ancienne coprésidente du groupe 1 de l’organisation. Elle dresse un parallèle avec la situation aux Etats-Unis, où l’administration Trump s’emploie à détruire la place de l’expertise scientifique dans la prise de décision politique pour protéger les intérêts de l’industrie fossile. « La feuille de route de cette industrie est connue : affaiblir le sentiment d’urgence, décrédibiliser les alternatives », deux éléments très présents dans les rapports du GIEC, poursuit-elle.
« Deux visions difficilement réconciliables »
Ce blocage, inédit à ce stade du cycle d’évaluation, « porte atteinte à la légitimité du GIEC », a mis en garde la délégation népalaise, selon le Earth Negotiations Bulletin. « Alors qu’un ouragan de catégorie 5 [Melissa] balayait les Caraïbes, le GIEC délibérait sur des notes de bas de page », a regretté Jim Skea, le président du GIEC, lors de son discours de clôture, toujours d’après ce média. Une manière de souligner le décalage entre l’ampleur de la crise climatique et la lenteur des discussions.
La suite reste très incertaine. Les scientifiques ne savent pas quand l’approbation du calendrier sera remise à l’ordre du jour, ni comment sortir de l’impasse. « Les deux visions qui s’opposent sont diamétralement opposées et difficilement réconciliables », estime Robert Vautard, le coprésident du groupe 1 du GIEC.
En attendant, les 664 auteurs avancent sur la rédaction des rapports, mais « on repousse les problèmes, ajoute le climatologue. L’incertitude rend plus difficile l’organisation des réunions de travail et complique le travail des auteurs, qui sont bénévoles ».
Interrogé par Le Monde, Jim Skea veut rester optimiste : lors de la réunion de Lima, « toutes les activités prévues pour 2026 ont été approuvées ». Les auteurs principaux des trois groupes se réuniront début décembre à Paris, puis de nouveau l’année prochaine. « Les rapports commenceront à paraître à la mi-2028, le calendrier précis devant être fixé lors de sessions ultérieures », assure-t-il, sans donner de date. Le premier volet, sur les bases physiques du changement climatique, est le plus susceptible d’être publié à temps avant le bilan mondial. Mais le sort des autres, sur l’adaptation et sur les solutions, ainsi que le rapport de synthèse, est plus hasardeux.
Au Pérou, les Etats sont parvenus, en revanche, à adopter le sommaire d’un rapport méthodologique consacré aux technologies d’élimination du dioxyde de carbone – un sujet lui aussi sensible –, dont la publication est attendue en 2026. Ils ont également adopté le budget du GIEC pour 2025-2026, dans un contexte financier tendu : les contributions volontaires des pays sont en forte baisse, et les Etats-Unis, historiquement premier contributeur, n’ont rien versé cette année.
“Le premier outil contre la crise climatique est la prise de conscience”
Flora Etienne
www.mediabask.eus/fr/info_mbsk/20251113/le-premier-outil-contre-la-crise-climatique-est-la-prise-de-conscience
Article
À la veille des élections municipales et communautaires de mars 2026, le militant écologiste François Verdet décrypte les enjeux du dérèglement climatique et l’importance d’une action à l’échelle locale.
À quelques mois des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars prochains, MEDIABASK donne la parole à des acteurs de la société civile pour décrypter les enjeux d’une dizaine de grands thèmes d’actualité, et entendre leurs attentes pour 2026. Pour parler d’écologie, le militant écologiste François Verdet a répondu présent.
L’Océan est le théâtre de la crise climatique. Quelles sont ses principales conséquences au Pays Basque ?
François Verdet : La première, si j’en juge par mon expérience de surfeur, c’est la température de l’eau. Tous les gens qui vont dans l’eau vous le diront, elle est plus chaude, en été comme en hiver. Il y a d’autres marqueurs, par exemple l’Ostreopsis, qui est une micro-algue qui vient des eaux chaudes et qui s’est acclimatée. Avec les conséquences que l’on connaît, c’est-à-dire des symptômes grippaux sur les populations qui fréquentent non seulement l’eau, mais aussi le littoral.
Des pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz pêchent des daurades coryphènes, en 2022, une quarantaine de baigneurs ont été mordus par des balistes, deux poissons tropicaux. Il y a aussi énormément d’algues vertes, qui se développent avec le réchauffement climatique.
Vous êtes spécialisé dans la pollution aux biomédias. Comment avez-vous commencé à vous y intéresser ?
V. : Les biomédias sont des petits morceaux de plastique de forme circulaire, comme une petite roue, qui sont des supports de prolifération bactérienne. Dans toutes les stations d’épuration, on met des bactéries qui sont en fait des micro-organismes qui vont manger la pollution ou la matière organique en suspension dans l’eau.
On s’est aperçu que si ces bactéries s’accrochaient à quelque chose, elles étaient beaucoup plus efficaces. C’est pourquoi on a introduit ces morceaux de plastique dans certaines stations d’épuration. Malheureusement, ces rondelles en plastique ont tendance à s’échapper par dizaines, centaines, voire millions de pièces. En 2007 ou 2008, on a ramassé sur les plages des centaines de milliers de ces biomédias.
Cette pollution a-t-elle été prise en compte par les décideurs locaux ? Les collectivités locales peuvent-elles agir ?
V. : Bien sûr qu’elles peuvent agir. Les grandes entreprises d’assainissement qui installent les stations d’épuration sollicitent les collectivités pour les améliorer ou en installer de nouvelles.
C’est pour cela que nous avons fait un gros travail d’information auprès des élus pour leur dire : “Attention, on va vous proposer ce procédé. Sur le papier, il est très intéressant. Mais mal utilisé, c’est une nouvelle pollution”.
Le premier des outils est la prise de conscience. Il faut avoir conscience des problématiques pour avoir envie d’agir. Une fois qu’on a envie d’agir, il faut se donner les moyens d’agir. Ce sont effectivement des moyens financiers qui peuvent être soit les moyens de la commune, soit des dotations extérieures au niveau de la Région, de l’État français ou de l’Europe. Ce n’est pas toujours facile parce que des réductions des dotations des communes, ou des plans de financement qui avaient été mis en place par l’État français ont été annulés. On se souvient, l’année dernière, de l’arrêt du plan vélo, alors que nombre de communes avaient initié des projets autour du vélo, voire les avaient mis en place, et ces projets n’ont pas pu aller au bout.
Il y a aussi la question de la coordination entre les acteurs. Cela passe, par exemple, par l’adoption d’un plan climat. Il y a celui de l’Agglomération, mais il faut que chaque commune en développe un à son échelle. Et ensuite, il faut le réaliser. Pour cela, on a besoin d’un minimum de personnes qui vont le coordonner, qui soient formées.
En mars 2024, la Communauté d’agglomération Pays Basque a été la première agglo de l’État français à se doter d’un secrétariat général à la transition énergétique et à la planification écologique. Les collectivités locales ont-elles pris la mesure de l’importance de leur implication dans la décarbonation et le respect de l’Accord de Paris ?
V. : En un mot, non. Bizi! vient de publier sa Synthèse du mandat communal et de l’Agglomération 2020-2026, qui revient sur une trentaine de critères et l’observation de 56 communes pour savoir ce qu’elles ont fait en matière de métamorphose écologique. Il y a un barème de notes qui va de zéro à quatre, et la moyenne des notes des 56 communes observées, c’est 0,9. On ne peut pas dire que ce soit bon.
Une seule commune obtient deux sur quatre, c’est Saint-Étienne-de-Baïgorry, et 40 communes se trouvent à zéro sur quatre. Donc je suis peut-être dur, mais je suis réaliste : non, on n’est pas à la hauteur de l’enjeu du changement climatique. On sait désormais que l’on n’atteindra pas les 1,5°C d’augmentation de température par rapport à l’ère pré-industrielle. Il faut donner un coup d’accélérateur gigantesque. Cela passe par un changement de mentalités. On ne peut plus penser comme on pensait au XXe siècle. Un exemple : il y a quelques années, Saint-Jean-de-Luz, associé avec Boardriders, qui est une grande entreprise, avait pour projet de construire un surf-park, c’est-à-dire une piscine à vagues pour les surfeurs. On ne peut plus avoir des projets qui consomment autant d’eau, d’énergie, qui artificialisent.
Les associations dans lesquelles vous avez milité, comme Surfrider ou Bizi!, sont-elles entendues par les municipalités ?
V. : On s’aperçoit qu’on peut travailler avec les collectivités et qu’elles sont même demandeuses. C’est assez intéressant de travailler à cette échelle-là. L’échelon local est même sans doute l’un des meilleurs pour faire changer les choses. Dire “je vais sauver le monde contre le changement climatique”, c’est une parole strictement en l’air. Par contre, dire “je vais, à l’échelle de mon territoire, participer à des initiatives pour faire changer les choses pour le mieux”, c’est tout à fait possible.
Je pense que les organisations comme Surfrider ou Bizi! savent très bien, d’un côté, critiquer ce qu’il faut critiquer, mais de l’autre côté, proposer. Il me semble impératif de ne pas être toujours dans l’opposition, mais parmi les forces de proposition pour construire et travailler ensemble, et donc avec les élus.
Qu’est-ce qui freine alors les institutions locales à agir davantage ?
V. : Ce sont des questions d’argent, de volonté, de prise de conscience. Peut-être qu’avec les élections municipales et le renouvellement des équipes, on peut espérer que des gens avec des idées nouvelles ou une autre jeunesse fassent évoluer les choses.
Mais je ne fais pas partie de ceux qui critiquent d’emblée les élus. Je pense qu’au contraire, c’est une mission qu’ils se sont donnée, qui est très intéressante, et qu’il vaut mieux les accompagner dans la mesure du possible, et parfois, dire non quand les projets sont ridicules, décalés.
Selon vous, quels sont les enjeux de davantage de mobilisation ? Quel est le coût de l’action face au coût de l’inaction ?
V. : C’est difficile à chiffrer, mais ce qui est sûr et certain, c’est que si l’action a un coût, l’inaction a un coût encore plus grand. Le changement climatique a déjà des coûts, et va avoir des coûts plus importants qui se compteront en milliards. Donc mieux vaut investir des millions aujourd’hui que se trouver avec des milliards de dégâts demain. Anticipons et investissons, même si ce n’est pas toujours facile.
Comme à toutes les autres personnes interviewées dans cette série, MEDIABASK vous a proposé de formuler vos attentes pour ces élections municipales 2026. Quelles sont-elles ?
V. : J’ai retenu l’extrait d’un livre qui a été édité par Bizi! sur le territoire que l’on souhaite construire. Je voudrais demander aux élus et aux candidats aux prochaines municipales qu’ils construisent avec nous un territoire souverain, soutenable et solidaire, parce que le climat et l’air que l’on respire n’ont pas de frontières. Souverain, car capable de se prendre en main collectivement face au défi climatique, soutenable, parce que respectueux de la biodiversité et conscient des limites des ressources, et enfin solidaire, parce que connecté aux territoires voisins et en son sein-même pour assurer des conditions de vie dignes pour toutes et tous, quel que soit son genre, ses origines sociales et géographiques.
Élections municipales : « Comme les réseaux sociaux, la démocratie participative crée des bulles de confirmation »
Xavier Sota
www.sudouest.fr/politique/elections-municipales-les-citoyens-n-ont-pas-besoin-des-collectivites-pour-s-exprimer-26651189.php
Article
Avec l’ouvrage « Pour en finir avec la démocratie participative », Manon Loisel, coautrice, dévoile un titre volontairement provocateur pour pointer les écueils des dispositifs de consultation des citoyens et les points d’amélioration. Entretien
Manon Loisel, enseignante à Sciences Po Paris, consultante du cabinet Partie Prenante qui accompagne les collectivités locales, a cosigné avec Nicolas Rio (consultant en coopérations territoriales) l’ouvrage « Pour en finir avec la démocratie participative » (Éditions Textuel). Dans cet ouvrage, les auteurs dessinent de nouvelles pistes pour reconstruire la confiance démocratique à l’échelle locale.
Vous évoquez une « gueule de bois démocratique », les outils de démocraties participatives contribuent davantage à la défiance qu’à l’émergence d’une parole citoyenne ?
L‘émergence d’une parole citoyenne peut-être, d’une écoute de la part des institutions certainement pas. Quand on parle de la crise démocratique, la réponse c’est participation citoyenne. Cette équivalence « démocratie égale participation » ou « participation égale démocratie » n’est pas vraie. On donne aux citoyens la capacité de s’exprimer mais la démultiplication des dispositifs ne s’accompagne pas toujours d’un travail pour que cette parole soit transformatrice.
Les dispositifs ratent leur cible ?
La démocratie participative agit comme les réseaux sociaux, elle produit des bulles de confirmation. Il y a un acronyme qui a émergé : les TLM [toujours les mêmes, NDLR], des gens qui ressemblent à leurs élus, des personnes très insérées dans la société civile locale. Cela vient augmenter les inégalités de représentation. Au cours d’un mandat, on va entendre cinq, six, sept fois les mêmes personnes. Ces bulles éloignent les élus de ceux qu’ils entendent le moins.
Existe-t-il une demande à davantage de participation ? Ou faut-il aller chercher le citoyen pour cerner ses attentes ? Qui a besoin de quoi ?
On part du présupposé que les citoyens veulent s’exprimer. On aurait tendance à répondre le contraire.
Ce n’est pas tant les citoyens qui ont besoin de s’exprimer que les collectivités qui sont en quête de légitimité. Les taux d’abstention aux élections locales sont élevés. Les institutions sont en quête de légitimité, elles ont besoin de cette participation.
Elles pourraient l’assumer et le formuler en disant simplement : nous avons besoin de vous pour produire une action publique au plus près de vos besoins.
Ce n’est pas le cas ?
Ce n’est pas comme ça que c’est raconté. Quand le besoin, c’est produire des politiques publiques plus justes, plus efficaces, plus adaptées aux besoins quotidiens de la population.
Mais l’augmentation de l’abstention invite à aller chercher les citoyens ?
L’élection est une légitimité pour agir, mais ça ne suffit plus. Bien souvent, on part de l’augmentation de l’abstention pour justifier le besoin de démocratie participative. Le problème, c’est que ces dispositifs ne permettent pas d’écouter ceux qui se tiennent loin de l’action publique. Je mets au défi d’aller trouver des abstentionnistes dans les réunions publiques, dans les personnes qui participent aux budgets participatifs… In fine, la démocratie participative creuse le problème, en créant une « présentocratie » avec une prime à celles et ceux qui se mobilisent le plus.
Au local, à l’échelle nationale, cette démocratie participative est devenue une figure imposée…
C‘est un point de passage obligatoire. Pas un grand projet sans concertation, pas un programme de campagne électorale sans contribution des citoyens. Cette injonction est devenue une forme d’automatisme. C’est l’arbre qui cache la forêt de la crise démocratique. Nous sommes collectivement obnubilés par la place aux citoyens, ce qui nous empêche de prendre à bras-le-corps les dysfonctionnements de notre modèle représentatif.
Les maires échappent à cette crise démocratique ?
On a tendance à penser que la crise démocratique concerne le national. On érige l’échelle municipale comme ultime rempart démocratique. Or les ferments de la crise sont les mêmes en local. La centralisation du pouvoir : on a au total 500 000 élus municipaux, mais on ne souligne que le rôle des maires qui concentrent une bonne partie des pouvoirs. Ensuite, le déficit de représentativité sociologique des élus est aussi vrai à l’échelle locale. La proximité ne suffit pas à faire disparaître les plafonds de verre auxquels se heurtent les classes populaires, les femmes et les minorités dans l’accès aux responsabilités politiques. Enfin, la crise démocratique locale est aussi le fait d’une très grande technicisation de l’action publique conçue sur des registres d’experts, qui produit une forme de dépolitisation des choix et des priorités. La démocratie participative s’avère bien impuissante à enrayer ces phénomènes, quand elle ne vient pas les renforcer.
Votre livre s’appelle « Pour en finir avec la démocratie participative », comment l’oxygène-t-on ?
On plaide pour un effort de réorientation démocratique, à partir de plusieurs virages. Troquer les dispositifs censés « faire parler » les citoyens pour engager un vrai travail d’écoute de la part des acteurs publics. Passer de l’objectif de « faire venir les citoyens » à celui d’écouter en priorité celles et ceux qu’on entend le moins, pour corriger les inégalités de représentation. Ou encore cesser de recueillir des propositions pour travailler la prise en compte des revendications et les confrontations des désaccords qui émergent sur le territoire.
Concrètement…
Dans le livre, nous formulons une variété de propositions, des réflexes à intégrer à court terme dans le quotidien des élus ou des agents – comme des auditions de citoyens bien ciblés pour aider les collectivités à mieux penser la mise en œuvre de leurs politiques publiques (petite enfance, mobilités, accès au logement…) ou le travail avec des capteurs de terrain pour mieux entendre les inaudibles – à des mesures plus réformatrices, comme le tirage au sort pour transformer la composition des assemblées et faire rentrer des abstentionnistes en démocratie. On voit bien à quel point le décalage sociologique entre élus et populations devient problématique. Ce qui fait la preuve de la robustesse démocratique, c’est qu’on arrive à écouter celles et ceux qu’on entend le moins, réguler des conflits, assumer des divergences, faire dialoguer, se mettre d’accord… Sur nos désaccords.
Les alternatives aux néonicotinoïdes existent mais ne sont pas assez développées, selon l’Inrae
Lorene Lavocat
https://reporterre.net/Les-alternatives-aux-neonicotinoides-existent-mais-ne-sont-pas-assez-developpees-selon-l-Inrae
Article
Saisis lors des débats sur la loi Duplomb, des chercheurs de l’Inrae ont publié un rapport sur les alternatives aux néonicotinoïdes. Conclusion : elles existent mais doivent être davantage développées.
C’est un rapport qui va faire débat. Mardi 28 octobre, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) a remis à la ministre de l’Agriculture une évaluation très attendue sur « les alternatives existantes à l’usage des néonicotinoïdes pour protéger les cultures ». Principale conclusion des seize experts : les solutions fourmillent, mais elles ne sont pas encore suffisamment développées.
Un travail d’équilibriste, commandé en mai dernier par Annie Gennevard, en plein débat sur la loi Duplomb et la réintroduction de l’acétamipride, un insecticide tueur d’abeilles. Objectif, selon la ministre : « Identifier les situations dans lesquelles les alternatives [aux néonicotinoïdes] pourraient être considérées comme absentes ou manifestement insuffisantes. » Avec une autre question, en filigrane : faut-il réautoriser la substance chimique pour certaines filières qui sont « sans solution », comme le prônent les défenseurs de la loi ?
« Ça fait dix ans que les pouvoirs publics et les instituts de recherche auraient pu et dû diffuser les alternatives »
Après avoir analysé six productions — betterave, pomme, cerise, noisette notamment — les experts ont constaté que ces filières « sont fragilisées par le manque de solutions opérationnelles et disponibles pour la protection contre certains ravageurs ». Sans se prononcer sur l’acétamipride, l’Inrae plaide ainsi pour maintenir sur le marché certains pesticides disponibles, en attendant l’arrivée de solutions de substitution efficaces.
Pour l’institut, il s’agit ainsi de « laisser un temps nécessaire à la montée en puissance des stratégies alternatives » déjà existantes. Un constat qui fait bondir Jacques Caplat, chargé des dossiers agricoles au sein d’Agir pour l’environnement : « Je trouve cette position un peu hypocrite, explique-t-il à Reporterre, car ça fait presque dix ans que l’interdiction des néonicotinoïdes a été actée, et ça fait dix ans que les pouvoirs publics et les instituts de recherche auraient pu et dû diffuser les alternatives. »
Des interdictions essentielles pour « l’émergence de nouvelles solutions »
Pour lui, la ligne esquissée par le rapport de l’Inrae relève donc de la stratégie de l’autruche. « C’est un peu trop facile de dire à chaque fois “on n’est pas encore prêts, laissez-nous un peu de temps”, fustige-t-il. Souvent, c’est quand on a le couteau sous la gorge qu’on agit enfin. »
Autrement dit, tant que des pesticides seront massivement autorisés, la transition agroécologique n’aura pas lieu. Un avis partagé d’ailleurs par les chercheurs, qui affirment que « le retrait des produits les plus problématiques est une condition majeure pour l’émergence de nouvelles solutions ».
« Ce travail scientifique confirme l’existence de leviers efficaces pour réduire la dépendance aux pesticides de synthèse »
Du côté de Générations futures, on a choisi de voir le verre à moitié plein : « Ce travail scientifique confirme l’existence de leviers efficaces pour réduire la dépendance aux pesticides de synthèse et accompagner la transition agroécologique des filières concernées », estime l’ONG dans un communiqué.
De fait, le rapport identifie une série de pistes prometteuses : les approches préventives — aussi appelées de prophylaxie — pour diminuer la présence des ravageurs en amont, le biocontrôle, l’épidémiosurveillance pour anticiper les potentielles crises, le tout dans une démarche dite combinatoire, qui associe tous les leviers disponibles.
Une stratégie connue depuis longtemps, mais peu mise en œuvre. « Beaucoup de producteurs attendent qu’on remplace les néonicotinoïdes par un autre produit, pas plus cher et aussi efficace, alors que ça n’arrivera pas, dit François Veillerette, porte-parole de l’ONG, auprès de Reporterre. Ce que nous disons, et que dit le rapport, c’est que l’alternative passera pas une combinaison de solutions. »
Le casse-tête de la noisette
Malgré sa présentation nuancée, ce rapport pourrait bien être instrumentalisé par les défenseurs de l’acétamipride, craint également François Veillerette. Car si les seize experts concluent que la filière betterave, principale consommatrice de l’insecticide décrié, peut se débrouiller sans la substance, ils pointent en revanche la « pré-faillite » de la filière noisette, « touchée en pleine croissance par la coïncidence de l’arrêt des néonicotinoïdes et de l’arrivée de la punaise diabolique ».
Interrogé par la presse, le directeur de l’Inrae, Philippe Mauguin, glissait ainsi : « Si vous êtes observateur, professionnel, parlementaire, vous pouvez déduire que de toutes les filières qui ont été étudiées, [la noisette] est celle qui aurait probablement le plus d’arguments pour demander une dérogation [sur l’acétamipride », a-t-il indiqué, tout en précisant qu’il s’agissait là d’un « débat politique ».
Un casus belli pour François Veillerette : « La filière noisette, qui représente à peine 8 000 hectares en France, ne doit pas servir de cheval de Troie pour d’autres filières, notamment la betterave, qui couvre, elle, près de 400 000 ha », insiste-t-il.
De fait, la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), liée à la FNSEA a immédiatement salué la sortie du rapport, qui serait « sans ambiguïté sur l’absence de solution opérationnelle efficace et économiquement viable ». Et de réclamer au gouvernement un projet de loi pour réautoriser l’acétamipride.
« La solution n’est pas dans la chimie »
Pour Générations futures, « la sécurisation des filières ne peut se faire au détriment de la santé humaine et de l’environnement ». En clair, le problème des betteraviers comme des cultivateurs de noisettes serait avant tout économique, lié à la concurrence intra et extra-européenne, à la mainmise des industries agroalimentaires sur les filières…
« Plutôt que de chercher des rendements toujours plus élevés en détruisant l’environnement, il faudrait obtenir des prix plus rémunérateurs, souligne François Veillerette. La solution n’est pas dans la chimie, mais dans une réponse politique. »
Ce rapport ne devrait donc pas permettre d’apaiser les discussions à venir, bien au contraire. Début novembre, la loi Duplomb fera l’objet d’un débat dans l’hémicycle, suite à la pétition record en faveur de sa suppression. De leur côté, les coauteurs de la loi, Franck Menonville et Laurent Duplomb, ont annoncé vouloir rédiger un nouveau texte centré sur l’acétamipride, pour tenir compte de la censure du Conseil constitutionnel, en août dernier. La bataille est donc loin d’être terminée.